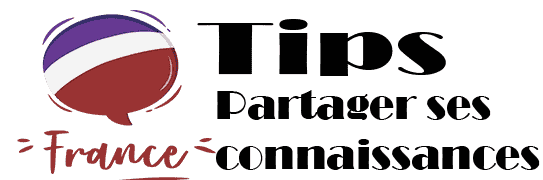Introduction à la linguistique fonctionnelle
O. Funke (sur Marty) : Innere Sprachform, 36 sv, 128 sv ; Satz u. Wort, 83 sv ; Studien zur Geschichte der Sprachphilosophie, 129 sv.
E. Goblot, Traité de Logique, chap. XV-XVI : « Le raisonnement téléologique ».
W. Havers, Die Unterscheidung von Bedingungen u. Triebkräften beim Studium der menschlichen Rede, Germ. Roman. Monatsschrift, 16 (1928), 13 sv.
O. Jespersen, Energetik der Sprache, Scientia 1914 ; Language, 324 sv.
A) Linguistique fonctionnelle contre grammaire normative
1) La fonction opposée à la norme
La distinction du correct et de l’incorrect est une des premières difficultés auxquelles s’achoppe le grammairien qui étudie un état de langue. Qu’appelle-t-on un fait de langage « correct » et, lorsqu’on parle d’une « faute », que veut-on dire par là ?
En somme, ces termes recouvrent des notions assez vagues. Il suffit de penser aux discussions souvent acharnées auxquelles se livrent puristes et grammairiens au sujet de la correction ou de l’incorrection de tel et tel cas litigieux.
Un grand nombre d’auteurs définissent le correct par la conformité avec la norme sociale : « On entend par langage 17correct le langage tel qu’il est exigé par la collectivité, et par fautes de langage les écarts à partir de cette norme — abstraction faite de toute valeur interne des mots ou des formes ». (Jespersen, Mankind, Nation and Individual from a linguistic point of view, 140). Cette conception du correct est la conception normative : est correct ce qui correspond à la norme établie par la collectivité ; et la grammaire qui constate et codifie les règles du commun usage, est dite grammaire normative (sans que d’ailleurs ce terme suppose qu’elle soit impérative, comme si elle cherchait nécessairement et toujours à exercer une pression en vue de leur observance).
Mais est-ce là le seul point de vue possible ? Une autre conception, que nous appellerons la conception fonctionnelle, fait dépendre la correction ou l’incorrection des faits de langage de leur degré de conformité à une fonction donnée qu’ils ont à remplir. Tandis que le point de vue normatif caractérise surtout l’école française (Durkheim) et l’école genevoise (De Saussure), le point de vue fonctionnel est mieux représenté par les Scandinaves : « le plus correct est ce qui, émis le plus aisément, est compris le plus aisément » (Tegnér : Jespersen, livre cité). M. Noreen a proposé une formule analogue : « ce qui, pouvant être compris le plus exactement et le plus rapidement par l’entendeur, peut être émis le plus aisément par le parleur » (ib.).
Il va sans dire — nous y reviendrons plus loin — que la compréhension aisée n’est qu’une des fonctions, multiples et souvent contradictoires, que le langage ait à remplir.
Selon qu’on se place au point de vue normatif ou au point de vue fonctionnel, on tablera donc aussi sur une définition différente de l’incorrect : 1. est incorrect ce qui transgresse la norme collective ; 2. est incorrect ce qui n’est pas adéquat à une fonction donnée (par exemple : clarté, économie, expressivité, etc.). Dans le premier cas, on parlera de fautes ; dans le second, de déficits.
Une des thèses de ce livre sera de montrer que dans un grand nombre de cas la faute, qui a passé jusqu’à présent pour un phénomène quasi-pathologique, sert à prévenir ou à réparer les déficits du langage correct. Partant de faits que le point de vue normatif taxe généralement de fautes, nous chercherons donc, en nous plaçant sur le terrain fonctionnel, à déterminer les fonctions que ces fautes ont à satisfaire. Au contraire, la question de savoir si, et dans quelle mesure, un fait 19donné est correct ou non, ne nous intéressera que d’une manière secondaire : les ouvrages de purisme abondent, sur ce point.
2) La finalité empirique
Les linguistes, hantés de la préoccupation de faire de leur discipline une science aussi rigoureuse que possible, ont toujours marqué une certaine réluctance à l’égard de la finalité. Ils n’osent pas l’aborder franchement ; elle leur semble insaisissable, antiscientifique et presque métaphysique.
Mais tous les savants ne sont pas également réfractaires à cette notion qui de toutes parts s’infiltre dans leur science. Le linguiste allemand Marty a beaucoup insisté sur le rôle joué par la finalité dans le langage (empirisch-teleologische Sprachbetrachtung, tastende Auslese ; v. Funke, livres et passages cités). Bien que ses vues s’appliquent à l’histoire du langage et spécialement à son origine, il ne semble pas difficile de montrer que les forces qui ont présidé à la naissance du langage se retrouvent, en vertu d’une sorte de « création continuée », et sans doute avec un dosage différent, dans le fonctionnement linguistique d’aujourd’hui.
Le dialectologue Gilliéron a orienté la linguistique vers l’étude du besoin de différenciation qui semble dominer dans les parlers populaires : « A tous les degrés, le langage est l’objet de préoccupations où se mêlent à la volonté d’être pleinement intelligible, la conscience de la diversité des parlers individuels ou locaux, le sentiment confus d’une hiérarchie des parlers et des formes, un désir obscur du mieux-dire. » (Etudes de Géographie linguistique, 73-4).
M. Millardet a admis et montré l’existence de cas « où la phonétique semble réagir elle-même, par ses propres moyens et sans sortir de son domaine, contre les dangers que les forces destructives d’assimilation font courir à la langue ». (Linguistique et Dialectologie romanes, 290). « Certaines innovations, qui ont le caractère le plus général et ne peuvent être considérées comme des applications de règles plus ou moins artificielles imposées par une élite ayant la prétention de parler correctement, dérivent, si l’on y regarde de près, d’une 20tendance collective en vertu de laquelle la langue répare instinctivement le trouble que les assimilations, les amuïssements et autres principes d’inertie ont introduit dans son système. » (ib. 300).
L’idée de finalité est donc bien « dans l’air ». Il reste à lui accorder la place exacte à laquelle elle a droit dans les théories linguistiques : Loin de s’ajouter au langage comme un facteur externe, elle en constitue le principe et la raison d’être. La définition même du langage (système de moyens d’expression « destinés à » transmettre la pensée), celle de la phrase (jugement « destiné à » être transmis à l’entendeur), celle du signe (procédé « destiné à » transmettre une signification donnée à un entendeur donné), relèvent du principe de finalité.
Une propriété d’un phénomène est dite fonction quand ce phénomène est agencé en vue de cette dernière ; inversement, un phénomène est dit procédé quand il sert de moyen destiné à satisfaire une fonction donnée. Le signe, la phrase, le langage ne sont pas des processus, engagés dans de simples rapports de cause à effet, mais des moyens, des procédés.
Examinée du point de vue des fautes et des innovations, la finalité apparaît sous deux aspects opposés, quoique solidaires :
a) La sélection.
La sélection se contente d’opérer un tri parmi les faits existants, laissant subsister ceux qui répondent à la fonction exigée, et éliminant les autres. De ce point de vue, les fautes et les innovations de la parole ne seraient que des « propositions individuelles », obéissant à des tendances individuelles, et que la sélection collective accepterait ou rejetterait après coup. Autrement dit, les fautes et les innovations ne passeraient que dans la mesure où elles se trouvent coïncider avec un besoin général, mais cette coïncidence ne serait pas voulue. C’est peut-être ainsi qu’il faut interpréter ce que F. de Saussure disait du caractère toujours fortuit d’un état de langue (CLG 125).
Les linguistes n’ont pas encore insisté suffisamment sur 21le rôle fonctionnel joué dans la vie du langage par l’oubli, qui est la face négative de la sélection. L’oubli ne frappe pas n’importe quel élément ; la mémoire laisse tomber les signes et les formules qui, pour une raison ou pour une autre, sont inaptes à une fonction donnée (élimination des monosyllabes homophones, oubli du sens correct par suite de l’absence de liens formels rattachant le signe à son ancienne famille, oubli de la forme correcte d’un signe par suite de son irrégularité, etc.).
De plus, l’élimination des inaptes peut être plus ou moins consciente et volontaire. Des faits parfaitement corrects autrefois tendent aujourd’hui, pour des raisons quelquefois précises, à être conçus comme incorrects, et sont refoulés (cf. Il a fait un voyage à la Chine ; Il est un avocat ; A cause que, en cas que, dans le cas que).
D’une manière générale, c’est l’oubli ou le refoulement qui donne le champ libre au choix et à la création des procédés destinés à mieux satisfaire une fonction. Car la sélection n’est qu’une des étapes de la finalité ; dans bien des cas, elle se contente de préparer ou d’accompagner
b) L’adaptation créatrice.
M. Goblot a montré (§§ 219, 228 sv) que la finalité comporte toujours un rapport d’au moins trois termes : un terme initial, un moyen ou une série de moyens, et une fin. Le terme, initial ou excitant, né sous l’influence des causes qui compromettent la fonction, fait apparaître le moyen destiné à satisfaire la fin : l’excitant crée la fonction, et la fonction l’organe.
Dans nombre de cas, le fonctionnement du langage relève de la même interprétation. Là aussi, le cycle fonctionnel est constitué par un excitant : les déficits ; un moyen : les procédés ; une fin : les besoins linguistiques. Et de même qu’en biologie l’excitant crée la fonction, et la fonction l’organe, en linguistique le déficit éveille le besoin (d’ailleurs toujours latent) et ce dernier déclenche le procédé qui doit le satisfaire. Nous avons cité plus haut l’équivoque de quila : c’est lui quila fait venir. Une faute assez fréquente aujourd’hui dans le langage populaire consiste à accorder l’auxiliaire faire 22lorsque l’objet est un féminin : c’est lui qui l’a faite venir. Ici, où le besoin de clarté a supprimé toute équivoque, l’incorrect peut être considéré comme un procédé servant à réparer un déficit du langage correct.
Terminologie. — Il va sans dire que de tels phénomènes s’opèrent généralement d’une façon ni consciente ni systématique. La finalité que nous postulons n’est, la plupart du temps, qu’une finalité inconsciente et empirique, agissant dans l’obscurité et comme à tâtons. Aussi le terme de besoin ne devra-t-il pas être pris trop à la lettre.
3) La loi opposée à la règle
Ces cycles fonctionnels (déficits — besoins — procédés) sont-ils impératifs et nécessaires ? Il ne s’agit sans doute que de possibilités. Mais entre ces possibilités, il est loisible d’établir des lois, énonçant que si l’une de celles-ci se produit telle autre se réalisera nécessairement aussi. La tâche de la linguistique est d’expliquer les phénomènes du langage à l’aide de lois constatant des rapports de mutuelle dépendance entre les faits.
Cette conception de la loi scientifique concorde avec les définitions qu’on en donne généralement : Une loi est une dépendance conditionnellement nécessaire entre deux termes (Naville, Classif. des sc., 22) ; Une loi naturelle ne peut être qu’un jugement hypothétique (Goblot § 218) ; Une loi n’est rien autre chose qu’une relation constante entre des faits (ib. § 182).
Formules. — La manière de formuler la loi varie : Si le fait A a le caractère M, le fait B a le caractère N ; Si A a le caractère M, il a aussi le caractère N ; Le degré de M varie avec le degré de N. On peut aussi se servir de la formule de la quatrième proportionnelle A : B = M : N.
Mais la loi ainsi conçue dans le sens constatatif où l’entendent les sciences naturelles, diffère radicalement de la règle grammaticale qui, elle, appartient à un tout autre plan (la conception saussurienne de la loi exposée dans le Cours, p. 133 sv, intéresse uniquement la règle grammaticale). 23Cette dernière est un principe impératif imposé par la contrainte de l’usage collectif et par le grammairien qui en est l’interprète. La règle grammaticale n’a rien de commun avec la loi linguistique ; la première est conventionnelle (θέσει ὄν), la seconde naturelle (φύσει ὄν).
La comparaison avec la vie sociale montre aisément la différence entre les deux ordres. La règle des grammairiens fait pendant aux lois juridico-parlementaires, aux usages et coutumes de la société ; la véritable loi linguistique, au contraire, est parallèle aux lois de la sociologie.
Tandis que le grammairien et le législateur prescrivent et codifient ce qui doit être, le linguiste et le sociologue constatent et enregistrent simplement les rapports de mutuelle dépendance reliant les faits : une Grammaire normative n’est pas un Traité de linguistique, de même que le Code civil n’est pas un Traité de sociologie ni le Code pénal un Traité de criminologie.
En outre, les règles grammaticales et les lois sociales sont limitées dans l’espace et dans le temps. Ne s’appliquant toujours qu’à une société donnée et à une époque donnée, elles changent de société à société et d’époque en époque. Les lois de la linguistique et de la sociologie, au contraire, doivent pouvoir se vérifier toujours et partout.
Enfin, les règles de la grammaire ou de la société peuvent être transgressées et comportent des sanctions plus ou moins rigoureuses et plus ou moins directes, tandis que les lois scientifiques sont intangibles. Cette dernière assertion, il est vrai, n’est exacte qu’en théorie ; mais les exceptions aux lois scientifiques proviennent en réalité de l’interférence des lois entre elles, c.à.d. de la difficulté qu’il y a de constater, à l’intérieur d’un système de valeurs, l’interdépendance de deux phénomènes abstraction faite des autres facteurs qui agissent sur eux.
Sciences normatives ou constatatives. — La dualité entre la règle (norme) et la loi (fonction) pourrait se poursuivre dans d’autres domaines. Ainsi la logique, dans sa définition ordinaire (théorie normative de l’entendement), s’oppose à la psychologie de l’entendement ; la morale s’oppose à la psychologie de réaction, 24la dogmatique à la science des religions, le canon esthétique à la science de l’art, etc.
L’opposition entre norme et fonction d’une part, règle et loi de l’autre, entraîne deux conséquences importantes pour le classement des disciplines.
D’une part, la grammaire normative est une science purement descriptive ; elle décrit les règles du système, sans les expliquer. La linguistique fonctionnelle est une science explicative ; elle prétend expliquer les phénomènes qui constituent le fonctionnement du langage, par les rapports de mutuelle dépendance qui les relient, et, du point de vue spécial qui nous occupe dans ce livre : par les rapports de mutuelle dépendance entre besoins, procédés et déficits. C’est la linguistique fonctionnelle qui devrait expliquer, en dernier ressort, l’existence, le maintien ou le remplacement des règles du système.
D’autre part, la grammaire normative est une discipline spéciale ; elle n’étudie toujours qu’une langue donnée, à une époque donnée : il n’y a pas de « grammaire générale ». La linguistique fonctionnelle, au contraire, est dans chacune de ses démarches une science générale.
B) Linguistique fonctionnelle contre linguistique historique
L’opposition entre description et explication est souvent présentée sous un autre angle particulièrement important. On prétend que l’histoire du langage est seule à constituer une véritable explication, tandis que la linguistique statique ne serait qu’une discipline descriptive.
1) L’explication fonctionnelle opposée à l’histoire
Chez les adeptes de la « méthode historique », expliquer veut dire : découvrir le fait ou la série des faits antérieurs. On « explique » le français père en disant qu’il vient du latin 25pater, on « explique » un tour comme pour l’amour de en le faisant remonter au latin per amorem ou pro amore. C’est le sempiternel raisonnement du « post hoc, ergo propter hoc ».
Grâce à cette méthode, la linguistique historique a sur la linguistique statique l’avantage de prédire à coup sûr, et d’annoncer toujours les événements après qu’ils sont arrivés ; cela fait que tout s’y sait assez bien, et ce n’est pas étonnant.
En réalité, description et statique d’une part, explication et évolution de l’autre, sont des termes qui ne se recouvrent pas. Qu’il s’agisse de phonétique, de syntagmatique ou de sémantique, une succession historique, loin de constituer une explication, est un fait qui demande lui-même à être expliqué. L’histoire n’est donc pas une méthode, mais une simple constatation ou reconstitution de faits.
Au lieu d’établir des successions historiques, la linguistique fonctionnelle, plus modeste, se place d’emblée sur le terrain statique et cherche à expliquer les faits en les ramenant aux fonctions (besoins, instincts, etc.) qu’ils sont censés satisfaire.
En principe, besoin et procédé sont asymétriques. Un procédé ne correspond pas nécessairement à un besoin donné, mais peut obéir à des tendances diverses ; inversement, un besoin peut utiliser plusieurs procédés. Il y a donc, par analogie avec ce qu’on appelle la polysémie du signe, un « polytélisme » du procédé, ce terme désignant la multiplicité des fins qu’un même moyen permet d’atteindre, et inversement (v. Lalande 1047).
Exposant les faits d’une manière déductive, nous partirons des besoins et diviserons notre étude en autant de parties que nous croyons reconnaître de besoins fondamentaux.
Cette méthode présente un double avantage. D’une part, allant du simple au composé, elle permet un exposé plus clair ; les procédés linguistiques sont en effet si variés que partir de ceux-ci pour rechercher les fonctions auxquelles ils répondent serait aboutir au chaos. D’autre part, descendant du principe à la conséquence, elle est aussi plus probante : la possibilité de reparcourir dans le même sens les phénomènes étudiés est l’indice qu’on les a compris.26
Les besoins fondamentaux qui commandent le fonctionnement du langage sont en nombre relativement restreint et varient en somme assez peu d’une langue à l’autre ou d’une époque à l’autre de la même langue. On pourrait les appeler les constantes du langage.
L’Analogie est un des premiers faits qui attirent l’attention de celui qui étudie le langage. F. de Saussure a admirablement montré comment son mécanisme se confond avec le mécanisme même de la parole. Nous verrons cependant que le procédé de l’analogie, ainsi compris, est encore plus vaste que ne le concevait le fondateur de la linguistique statique. Car, si la création analogique ou, ce qui revient au même, le jeu quotidien de la parole, « suppose un modèle et son imitation », les cas si variés qu’on appelle « étymologie populaire », « contamination », « contagion », etc., doivent également ressortir, d’une manière ou de l’autre, au principe général de l’analogie. Et même, prise au sens large, l’analogie est un fait qui dépasse la portée d’un simple procédé. Nous parlerons plutôt d’un besoin général qui tend à assimiler les uns aux autres les signes par leurs formes et par leurs significations pour les ordonner en un système — et nous dirons que ce besoin utilise des procédés variés, tels que l’analogie proprement dite, l’étymologie populaire, etc. (Chapitre I : Assimilation).
La réduction des signes en une masse homogène a sa contre-partie dans le besoin de Différenciation ou de Clarté (Chapitre II). Ce dernier nous fournira quelques-unes des meilleures illustrations de la finalité linguistique (v. l’exemple donné plus haut : c’est lui qui l’a faite venir).
Le besoin d’Economie exige que la parole soit rapide, qu’elle se déroule et soit comprise dans le minimum de temps. De là les abréviations, les raccourcis, les sous-entendus, les ellipses, etc., que la langue parlée présente en si grand nombre (Chapitre III : Brièveté). En outre, pour que les associations engagées dans le jeu de la parole puissent fonctionner avec le moindre effort de mémoire, il faut que le signe ne change 27pas ou change le moins possible de forme en passant d’une combinaison syntagmatique, respectivement d’une catégorie grammaticale à l’autre (Chapitre IV : Invariabilité). Les verbes irréguliers, par exemple, sont un défi à la mémoire (je vais, tu vas, vous all-ez, j’i-rai, que j’aille — en face de : je chante, tu chantes, vous chant-ez, je chante-rai, que je chante). Seules la haute fréquence d’emploi et la contrainte collective réussissent à maintenir de telles anomalies.
Un autre besoin, en grande partie opposé aux précédents, c’est l’Expressivité (Chapitre V). Le besoin d’agir sur l’entendeur soit pour le forcer à tenir compte de ce qu’on lui dit soit pour le ménager, domine tout l’usage de la conversation. Le déficit qui déclenche ordinairement les procédés expressifs est l’usure sémantique ou simplement l’absence de signes suffisamment frappants.
Il faut ajouter que ces besoins tantôt s’associent tantôt se heurtent les uns aux autres. L’harmonie et l’antinomie relatives entre les besoins est un fait dont on n’a pas encore tiré toutes les conséquences, mais qui constitue sans doute le facteur principal de la stabilité ou de l’instabilité des systèmes linguistiques. La stabilité d’une langue correspond à un état d’ « équilibre des besoins », dans lequel aucun de ceux-ci n’est assez fort pour modifier appréciablement le système ; tandis que la direction dans laquelle une langue évolue n’est en fin de compte que la résultante du « parallélogramme des besoins » qui agissent sur elle. S’il est permis de traduire une notion assez précise par un terme vague, cette proportion des besoins linguistiques est au fond ce qu’on appelle le « génie de la langue ».
En attendant des études plus détaillées, nous nous contenterons d’une première approximation pour considérer successivement chacun des besoins comme si son action était indépendante de celle des autres.28
2) Le changement opposé à l’évolution
On s’accorde aujourd’hui à reconnaître que c’est la linguistique du fonctionnement (« linguistique de la parole ») qui forme le pont reliant la linguistique statique ou science des états de langue, à la linguistique évolutive. Mais tandis que pour le système de la langue la distinction entre statique et évolutif tend, après les travaux de Marty en Allemagne et de Saussure à Genève, à être reconnue et admise de plus en plus universellement, son application à l’étude du fonctionnement rencontre des difficultés.
« En pratique, un état de langue n’est pas un point, mais un espace de temps plus ou moins long pendant lequel la somme des modifications survenues est minime. Cela peut être dix ans, une génération, un siècle, davantage même… Un état absolu se définit par l’absence de changements, et comme malgré tout la langue se transforme, si peu que ce soit, étudier un état de langue revient pratiquement à négliger les changements peu importants, de même que les mathématiciens négligent les quantités infinitésimales dans certaines opérations, telles que le calcul des logarithmes ». (Saussure CLG 146).
Il serait utile néanmoins pour étudier le fonctionnement du langage de disposer d’un critère précis permettant de dire dans chaque cas particulier si un rapport linguistique donné appartient au présent ou à l’histoire.
Nous appellerons changement statique, ou changement tout court, tout passage réversible, c.à.d. dont le terme initial peut être spontanément rétabli par les sujets. Dans le cas inverse, nous parlerons d’évolution.
Quelques exemples nous éclaireront. On sait que l’emploi fautif de fortuné au sens de « riche » est très courant aujourd’hui. Mais pour la majorité des sujets le passage de fortuné 1 à fortuné 2 reste réversible : « heureux » = « riche ». Pour un petit nombre d’entre eux, au contraire, le rapport de l’un à l’autre n’est plus saisi et forme par conséquent une évolution, 29c.à.d. le passage d’un fait du passé à un fait du présent : fortuné « heureux » → « riche ».
Lorsqu’une abréviation appartient au présent, le rapport entre le signe plein et le signe abrégé doit être senti spontanément. Ainsi des raccourcis comme perm’, prof’, math’, etc., relèvent de la statique, parce qu’ils se laissent immédiatement ramener aux originels correspondants : permission, professeur, mathématiques, etc. L’explication d’un mot comme dèche, par exemple (être dans la dèche « dans la misère »), appartient au contraire au passé ; les sujets ne savent plus instinctivement que dèche a été un jour l’abrégé de déchéance ou le substantif verbal de déchoir.
Il en va de même pour les figures. Toute figure conserve son caractère dans la mesure où le sens figuré est rattaché spontanément au sens propre, c.à.d. dans la mesure où elle reste statique ; dans le cas inverse, elle perd son caractère de figure pour devenir un signe plus ou moins arbitraire. Des mots comme étrange, stoïque, cynique, etc., ont été des figures : « qui a le caractère de ce qui est étranger, de celui qui appartient à l’école stoïcienne, à la secte des Cyniques » ; aujourd’hui, ces signes sont arbitraires, leur sens figuré n’étant plus compris que par les historiens de la langue.
Pour éviter tout malentendu, il convient d’ajouter que notre définition du statique et de l’évolutif dérive d’une interprétation uniquement psychique de ces faits, qu’il ne faut pas confondre avec la simultanéité et la succession proprement dites, qui sont des notions physiques. Car au point de vue physique tout fait linguistique — une phrase, un mot, un simple phonème — se déroule dans le temps : la statique linguistique n’a rien de commun avec la simultanéité physique. Dans ce sens, on pourrait donc appeler la statique un mode de l’esprit, c.à.d. une manière de concevoir les phénomènes, puisque l’esprit ne semble pouvoir saisir qu’en les immobilisant les faits qui physiquement se déroulent dans le temps.
La linguistique du fonctionnement ne peut être que statique. « La première chose qui frappe quand on étudie les faits de langue, c’est que pour le sujet parlant leur succession dans le temps est inexistante : il est devant un état. 30Aussi le linguiste qui veut comprendre cet état doit-il faire table rase de tout ce qui l’a produit et ignorer la diachronie. Il ne peut entrer dans la conscience des sujets parlants qu’en supprimant le passé. » (Saussure CLG 120). La tâche actuelle de la linguistique est de reprendre les problèmes qui ont longtemps paru comme le fief de la linguistique historique, pour les transposer sur le plan du fonctionnement statique ; car un fait d’évolution reste inexpliqué tant qu’il n’a pu être ramené à un rapport ou à une série de rapports statiques de mutuelle dépendance (= loi).
Rôle du latin. — Une objection souvent présentée par les historiens contre l’étude statique de la langue est qu’il est impossible de comprendre le français sans connaître le latin. Il s’agit naturellement des emprunts du français écrit au latin savant : « … Un Français qui ne sait pas le latin est hors d’état de comprendre les rapports que soutiennent les mots français entre eux. On peut parler, entendre, écrire le français sans savoir un mot de latin ; mais on ne peut se rendre compte des rapports des mots entre eux si l’on n est pas latiniste. » (Meillet, Les Langues dans l’Europe nouvelle, 164).
Cette constatation, d’ailleurs très juste, ne concerne qu’une variété d’un cas général : le rapport entre une langue qui reçoit et une autre qui fournit l’emprunt. Or ce rapport est loin d’être nécessairement d’ordre généalogique, comme entre le français et le latin. Il suffit de penser au grec, pourvoyeur du latin ; à l’arabe, fournisseur du persan et de l’ourdou, qui ne lui sont pas apparentés ; au chinois, réservoir lexical du japonais cultivé, etc.
Le rapport culturel (de langue classique à langue tributaire) ne doit pas être confondu avec le rapport généalogique : Une étude approfondie du français exige la connaissance du latin non pas en tant que ce dernier constitue une étape antérieure de la langue, mais simplement dans la mesure où il lui fournit ses emprunts.
C) Le choix des faits
Une conception linguistique comme celle que nous venons d’exposer oblige à tabler de préférence sur des matériaux qui n’appartiennent ni à la langue normalisée ni au passé de la langue.31
Nous avons donc procédé à une enquête sur le « français avancé », en comprenant sous ce terme tout ce qui détonne par rapport à la langue traditionnelle : fautes, innovations, langage populaire, argot, cas insolites ou litigieux, perplexités grammaticales, etc.
Si l’on admet en effet que la faute assume, dans le jeu de la parole, un rôle fonctionnel, elle aura par là même, pour le linguiste, une valeur documentaire de premier plan. Destinée à satisfaire certains besoins, elle devient par ricochet l’indice de ces besoins et comme l’écran sur lequel vient se projeter tout le film du fonctionnement linguistique.
1) Correct et incorrect
Une exagération courante consiste à croire qu’une innovation commence nécessairement par être une faute. Mais le langage avancé ne comprend pas seulement les faits dûment constatés comme incorrects.
Dans une langue de grande communication telle que le français, où la conscience linguistique est très sensible et où la contrainte collective réprime immédiatement les écarts trop hardis, les besoins se réalisent souvent d’une manière plus heureuse sous forme de procédés détournés — semi-corrects ou corrects — que sous forme de fautes brutales transgressant violemment les règles reçues. Le langage populaire manifeste par exemple une tendance très forte à unifier le radical du verbe. Mais tandis qu’il dit déjà je vas à la place de je vais (cf. je vas, tu vas, il va, on va), j’est pour je suis et j’a pour j’ai sont des formes encore très risquées. En revanche, il construit couramment : c’est moi qui est, c’est moi qui a (de même pour l’auxiliaire : c’est moi qui l’a vu), il n’y a que vous qui peut faire ça, c’est pas nous qui peut y aller, etc. On peut considérer dans ces exemples le tour c’est qui comme une ruse — façon de parler — permettant, là où la solution directe serait trop osée, l’unification du radical.
Comme, dans une langue, l’importance de ces procédés détournés semble croître en raison directe de l’impérativité de l’usage, il est nécessaire de donner à l’enquête une tournure 32aussi large que possible. Pour se faire une idée claire du langage incorrect, il faut non pas le distinguer du langage correct par des caractères arbitrairement choisis, mais l’en rapprocher au contraire, selon ce principe de Claude Bernard que le pathologique n’est que l’exagération du normal.
La sociologie connaît des distinctions analogues. Une innovation sociale ne commence pas nécessairement par une émeute ; la révolution n’est souvent qu’un feu de paille, auprès d’évolutions profondes qui passent inaperçues et dont on n’aperçoit le vrai sens que longtemps plus tard.
2) Mémoire et discours
Pour qu’un besoin linguistique soit général, il doit se manifester dans tous les compartiments du langage, à commencer par ce qu’on peut appeler les deux axes de son fonctionnement : les rapports mémoriels, contractés entre les éléments donnés dans la chaîne parlée et ceux logés dans la mémoire, et les rapports discursifs, que soutiennent les éléments enchaînés le long du discours (c’est ce que F. de Saussure a appelé, avec une terminologie moins précise, la différence entre rapports associatifs ou syntagmatiques : CLG 176 sv).
Nous verrons par exemple que la Brièveté (chap. III) et l’Invariabilité (chap. IV) ne sont pas autre chose que les deux faces du besoin d’Economie, selon qu’il se réalise dans le discours ou dans la mémoire. La même division s’impose pour l’étude d’autres besoins. Ainsi l’Instinct analogique, qui est un fait de mémoire (Assimilation mémorielle) a sa contre-partie dans la discours : l’Assimilation discursive — que nous appellerons le Conformisme — exige que les éléments qui se suivent dans la chaîne parlée s’adaptent étroitement les uns aux autres et varient par conséquent les uns en fonction des autres (et cela, nous le verrons, se manifeste aussi bien dans le Sandhi, ou conformisme phonique, que dans l’Accord entre catégories grammaticales, la Concordance des Temps, etc.).33
3) Grammaire et phonologie
Les besoins généraux qui sont à la base du fonctionnement linguistique ne se manifestent pas seulement dans la grammaire (science des rapports entre signes et significations) ; leur action se prolonge dans tout le domaine de la phonologie (science des phonèmes et de leur combinaison, abstraction faite des significations).
L’instinct analogique, par exemple, intéresse autant la phonologie que la grammaire. Le sandhi n’est que le pendant phonique de l’accord entre catégories grammaticales (accord de l’adjectif avec son substantif, du verbe avec son sujet ; concordance des temps et des modes, etc.). Les faits de différenciation grammaticale ont leur contre-partie dans les divers problèmes concernant la différenciation phonique : délimitation des unités et des sous-unités, dissimilation, netteté de syllabation, etc. La sous-entente d’éléments significatifs provoquée par le besoin de brièveté, et les mutilations de mots et amuissements de phonèmes qui caractérisent le langage populaire, ne diffèrent pas quant au principe. Le besoin d’invariabilité, qui se manifesta principalement dans le domaine des transpositions grammaticales (transpositions sémantiques et transpositions syntagmatiques), présente aussi un aspect phonique, problème délicat que nous effleurerons. De même, il y a une expressivité sémantique (= figures) et une expressivité formelle.
Phonologie et grammaire sont donc parallèles, en ce sens que les besoins qui atteignent les rapports entre signes et significations doivent également se réaliser dans les éléments matériels pris isolément. En outre, comme il est plus facile de constater l’action des besoins en grammaire qu’en phonologie, il y aura avantage à placer l’étude de cette dernière après celle des autres parties du langage. Agencée sur le modèle de la grammaire, elle n’en sera que moins rébarbative.
Bibliographie. — L’interdépendance de la grammaire et de la phonologie a été soulignée par M. Sapir (Language, 196-7). M. Sechehaye a insisté sur la nécessité de faire intervenir l’étude de la phonologie après celle de la grammaire (Programme et Méthodes de la Linguistique Théorique, 131 sv, 161 sv).34
La recherche, faite d’un point de vue fonctionnel, des coïncidences entre mémoire et discours d’une part, grammaire et phonologie de l’autre, est peut-être la meilleure méthode pour démontrer la cohésion des facteurs en apparence si divers qui composent l’unité d’une langue.
Le même problème peut être posé sous un autre angle également important.
4) Langue parlée et langue écrite
Une personne à qui nous exposions notre idée d’utiliser les fautes de français pour la linguistique, nous avait demandé : Quel français étudiez-vous : le français populaire ? le français écrit ? le français de Paris ? celui de Genève ? le français des petites villes ? etc.
Il est évident qu’une enquête portant sur le français avancé doit tenir compte de l’« état-civil » des faits de langage. L’antinomie qui se présente tout de suite est celle entre la langue écrite et la langue parlée, ou d’une manière plus frappante entre la langue littéraire et la langue populaire. Où faut-il chercher le vrai français ? :
… En somme, en fin, en fait, le français, le vrai français, agréable ou non à l’ouïe, commode ou non pour l’expression de la pensée, est par essence celui que parle le peuple. Le peuple de France a créé le français ; il l’a fait, il l’a enfanté en ce qu’il a de véritablement français ; il l’a mené jusqu’à nos jours au point où nous l’entendons aujourd’hui ; et les écrivains et les savants, malgré une très grande influence dans la fabrication des mots nouveaux, n’ont fait que marcher à sa suite. En réalité, le vrai français, c’est le français populaire. Et le français littéraire ne serait plus aujourd’hui, à ce point de vue, qu’une langue artificielle, une langue de mandarins — une sorte d’argot… (B 30-1).
Bien que le latin vulgaire, dont le français est issu, soit évidemment un exemple en faveur de cette thèse, certains sont d’un avis différent :
Le langage littéraire et l’idiome populaire d’aujourd’hui, tout pétri d’argot, sont […]à peu près impénétrables l’un à l’autre. Et s’il y a contagion, c’est du premier sur le second, non le contraire. Quoi qu’en disent certains politiques qui conçoivent encore 35le peuple comme une classe en soi, les gens du peuple sont de plus en plus imprégnés d’âme bourgeoise, et en ce qui nous intéresse, de dialecte journalistique. L’école commence cette action que le journal achève ; et surtout à Paris, la discussion sociale, qu’on peut surprendre n’importe où, en termes nobles, fût-ce le samedi, entre deux prolétaires titubants… (Thérive FLM 58).
Les grandes langues modernes de civilisation ont été façonnées par des élites intellectuelles qui les enrichissent depuis de longues générations (Meillet, Les Langues dans l’Europe nouvelle, 262).
Pour nous cependant, qui nous plaçons au point de vue fonctionnel, la langue parlée formera la base de l’étude ; car les besoins fondamentaux se manifestent le mieux dans la langue parlée, qui est plus spontanée, moins entravée par la tradition que la langue écrite. En linguistique, toute vérité entre par les oreilles, toute sottise par les yeux.
Mais il ne s’agira pas pour cela de renoncer à la langue écrite. L’essentiel est de considérer l’une comme l’autre en fonction d’un petit nombre de besoins, en somme identiques, qui s’y manifestent avec un dosage et des procédés variables.
Voici un exemple qui illustre d’une manière frappante l’identité de principe des besoins qui commandent les deux pôles du français avancé. Soit une phrase correcte : Ce qui importe dans un pays, c’est le nombre. Le français avancé parlé dira : Ce que ça importe dans un pays, c’est le nombre ; tandis que le français avancé écrit aura : Ce qu’il importe dans un pays, c’est le nombre. Or un seul et même besoin est à la base de ces deux fautes ; le besoin d’invariabilité demande que la transposition de la phrase indépendante en une proposition relative s’effectue avec le minimum possible de changements. C’est donc le type de l’indépendante qui dans chaque cas commande la forme nouvelle : Ça importe > Ce que ça importe ; Il importe > Ce qu’il importe.
Par ces sortes de coïncidences, nous tâcherons de montrer que certains faits du français avancé, malgré l’aspect chaotique qu’ils présentent au premier regard superficiel, sont réductibles à des types, dont l’importance dépasse celle des altérations particulières.
De ce point de vue, la langue parlée et la langue écrite, 36par certains de leurs aspects, diffèrent moins qu’on ne le croit ; la différence est davantage dans les procédés mis en. œuvre que dans les besoins. La langue commune, ou langue de grande communication, est définie par le besoin biologique qui en est la raison d’être : la transmission rapide et étendue de la pensée entre le plus grand nombre d’individus malgré leur hétérogénéité. Au sein de cette langue, on peut distinguer la langue courante (parlée) et la langue cursive (écrite). La seconde, qui est surtout la langue des affaires, de la publicité, de la presse, etc., ne diffère de la première que par les procédés. Ce n’est pas un paradoxe de dire que la langue courante est plus proche de la langue cursive que de l’argot, et la langue cursive plus proche de la langue courante que de la langue littéraire et poétique.
Ce sont les journaux surtout qui servent aujourd’hui de pont entre l’écrit et le parlé ; étudiés dans les limites et avec les réserves nécessaires, ils nous fourniront un très grand nombre d’exemples.
Il serait difficile aussi de ne pas tenir compte de l’opinion des puristes et des grammairiens. Notre attitude à leur égard est délicate. Placés sur le plan fonctionnel et non, comme eux, sur le plan impératif et normatif, nous éviterons par cela même toute polémique. En revanche, nous les utiliserons largement à titre documentaire. Beaucoup d’entre eux fournissent en effet de véritables répertoires de faits, qu’il est très utile de consulter (en prenant garde, toutefois, que la majorité de leurs exemples appartient à la langue écrite).
Mieux que les journaux et les puristes, c’est l’enquête parlée et les lettres populaires qui livrent les faits les plus abondants et les plus sûrs. Outre les lettres publiées par M. Van Der Molen et par M. Prein, nous avons pu consulter une partie des lettres parvenues à l’Agence des Prisonniers de Guerre (Comité International de la Croix-Rouge, Genève 1914 sv). Rédigées le plus souvent par des personnes de culture rudimentaire — généralement des femmes du peuple — expédiées de tous les coins de France, ces lettres reflètent assez fidèlement l’état de la langue courante et populaire d’aujourd’hui.37
5) Coïncidences interlingues
L’idéal de la linguistique fonctionnelle serait de poursuivre la recherche des coïncidences non seulement entre les différentes parties d’une langue donnée, mais encore d’une langue à l’autre. Voilà évidemment une tâche de l’avenir, à laquelle on ne pourra pas encore songer ici.
Mais il ne sera pas inutile de terminer cette Introduction par une perspective qui dépasse l’étude présente, en montrant comment notre manière de concevoir la comparaison des langues s’oppose — radicalement — à la grammaire comparée traditionnelle.
Tandis que cette dernière recherche des correspondances de langue à langue, qu’elle interprète en les ramenant à un type ancestral unique dont elles sont le développement, la linguistique fonctionnelle recherche des coïncidences, qu’elle explique en faisant appel à un besoin identique qui les détermine. Deux conséquences importantes résultent de cette opposition.
D’une part, la méthode de la grammaire comparée ne peut être qu’historique et ne peut porter naturellement que sur des langues de même famille, c.à.d. qu’on suppose dériver d’une origine commune. La linguistique fonctionnelle, sans exclure la comparaison entre des langues généalogiquement ou culturellement parentes, a pour exigence idéale la recherche de coïncidences entre des langues qui ne soient reliées ni par des liens généalogiques ni par des emprunts.
D’autre part, la grammaire comparée doit, pour être fructueuse, tabler sur les éléments les plus archaïques et les moins spontanés. La linguistique fonctionnelle, au contraire, ne peut s’intéresser qu’aux faits les plus avancés et les plus spontanés que puisse présenter un état de langue.
6) Coïncidences inter-sémiologiques
6) Une tâche plus vaste et plus lointaine sera la recherche de coïncidences inter-sémiologiques, c’est-à-dire entre les divers systèmes de signes (langage articulé, langage gestuel, art, cultes, rites symboliques, formes de politesse, signaux, monnaies, etc.) dont l’ensemble constitue l’objet de la Sémiologie. Cette science, définie par F. de Saussure (CLG 33), nous dira peut-être 38un jour si les besoins fondamentaux qui sont la raison d’être de tout idiome, ne forment pas aussi la base de tout système de signes.
Telle est la méthode que nous soumettrons, dans ce livre, à une première application.
Arrivé au terme de cette Introduction, le lecteur se demandera peut-être si la linguistique ainsi comprise est encore une science autonome, ou si nous ne retournons pas tout simplement à l’ancienne « psychologie du langage ». On sait que le Cours de Linguistique Générale de F. de Saussure se termine par cette phrase, qui en marque l’idée fondamentale : « la linguistique a pour unique et véritable objet la langue envisagée en elle-même et pour elle-même ».
Mais dès que l’on considère la langue comme un instrument agencé en vue de fins données, la conception saussurienne devient trop étroite. Comment une science pourrait-elle étudier un instrument envisagé en lui-même et pour lui-même ? Nous dirons pour notre part que la linguistique fonctionnelle a pour unique et véritable objet le langage, envisagé comme un système de procédés qui est organisé en vue des besoins qu’il doit satisfaire.39
Interdépendance : assimilation et différenciation
Une langue n’est pas simplement une collection de signes existant chacun pour soi, mais forme un système de valeurs en vertu duquel chacun des éléments est solidaire des autres, c.à.d. dépend de la structure de l’ensemble et ne peut être ce qu’il est que dans et par sa relation avec le reste. Dans un tel système, la création, la modification ou la perte d’une seule valeur entraîne, l’altération des autres valeurs et détermine un regroupement général.
Tout système de valeurs suppose un ensemble d’oppositions formées d’identités partielles et de différences partielles. Les deux besoins opposés, mais solidaires, qui tendent en partie à assimiler les éléments les uns aux autres (chap. I) et en partie à les différencier (chap. II), sont à la base de tout système de signes.41
Chapitre premier Le besoin d’assimilation
Tout fait de langage tend à créer et à s’associer les faits qui peuvent entrer en système avec lui. Le besoin d’assimilation est la forme linguistique de l’instinct d’imitation, facteur tout-puissant dans la vie sociale ; tel ou tel élément, qui s’impose avec plus de force que ses concurrents, fait tache d’huile. C’est dans ce sens que l’on peut parler d’une « force d’imitation inhérente au système lui-même » (Systemzwang).
Selon la séparation du fonctionnement en deux axes établie dans l’Introduction, nous distinguerons l’assimilation mémorielle et l’assimilation discursive.
La première consiste à modifier ou à créer un élément par imitation d’un modèle logé hors du discours, dans la conscience linguistique. On peut appeler cette forme d’assimilation l’Instinct analogique.
L’assimilation discursive, ou Conformisme, oblige les éléments — grammaticaux aussi bien que phoniques — qui se suivent le long de la chaîne parlée, à varier les uns en fonction des autres (Accord, Concordance des Temps, Attraction des Modes, Sandhi, etc.).
A) L’instinct analogique
L’instinct analogique ainsi défini est un principe un qui se manifeste sous des formes variées comprenant, outre l’analogie proprement dite, tous les faits si divers qu’on appelle 43étymologie populaire, contamination, attraction homonymique, etc.
On a voulu séparer l’analogie des autres variétés, en ne reconnaissant qu’à la première un rôle important dans le fonctionnement du langage. M. Millardet a cependant montré qu’il n’y a pas antinomie absolue entre analogie et étymologie populaire. Ce « sont deux phénomènes comparables en ce sens que, sur une forme A, agit une forme B, par suite d’une association d’idées plus ou moins complexe, d’où naît une forme C ». (Linguistique et Dialectologie romanes, 396 sv).
D’autre part, des termes comme étymologie « populaire », contamination, contagion, etc., font trop souvent croire qu’il s’agit de formes essentiellement pathologiques. Cela suppose un malentendu constant, car l’incorrect (point de vue normatif) est loin d’être nécessairement un déficit (point de vue fonctionnel).
Le plus simple sera de distinguer l’instinct analogique selon qu’il agit sur la signification (Analogie sémantique) ou sur le signe (Analogie formelle).
1) Analogie sémantique
2) Analogie formelle
L’action d’un signe sur un autre peut aller jusqu’à substitution complète : Valoir > Falloir (Il faut mieux que vous y alliez : Joran n° 130), Voie > Voix (Ayant appris, par la voix des journaux, que vous vous chargiez de…, APG), etc.48
L’analogie formelle n’intéresse pas seulement le vocabulaire. Beaucoup de fautes de syntaxe s’expliquent par le croisement de deux formules ; il en est ainsi pour la négation explétive et autres faits semblables, d’ailleurs bien connus : La plus formidable facilité qui n’ait jamais été offerte à la clientèle, Elle se gêne avec d’autres qu’avec moi, Racontez cela à d’autres qu’à moi, Il ne l’accepterait de personne excepté de son fils ; etc.
Outre les croisements, il faut mettre à part les cas d’analogie formelle dus au besoin instinctif de classer les signes en un certain nombre de familles plus ou moins logiques. Cet instinct classificateur, base de tout système linguistique, se manifeste sous des formes variées.
Les agences parlent de voyages par Terre, Air, Mer et Fer. Les transports se font par rail ou par route. Les statistiques de navigation opposent le moteur et la vapeur. A la houille blanche produite par les chutes d’eau, est venue s’ajouter la houille verte (rivières et neuves), la houille bleue (vagues et marées) et même la houille incolore (vent). Après l’Internationale rouge, nous avons connu une Internationale jaune, une noire (Eglise), une verte (agriculture), une blanche (réaction), etc.
Cette lutte de la sémantique contre la morphologie se manifeste mieux encore comme une révolte de la logique contre l’illogisme de la catégorie morphologique, dans le « singulier sémantique » — par exemple la revue Les Lectures pour Tous désignée dans le peuple La Lecture pour Tous (B 25 n) — et dans le « masculin sémantique » : Un ordonnance, Un clarinette (Vincent 35), Il a été le dupe dans cette affaire (id. 59), etc.
L’action féminisante de la consonne finale se vérifie aussi pour certains adjectifs. Pécuniaire, interprété comme un féminin (*pécunière), donne un nouveau masculin : L’argument 51Pécunier ne me touche pas (Joran n° 211), Le soldat N. a-t-il souffert d’embarras pécuniers ? (Godet xxv). De même, tiède entraîne un masculin tied (B 94), et inversement bleu un féminin bleuse (ib.).
On aurait tort de considérer tous ces « accidents » comme des cas pathologiques ; ils ne méritent pas tant de dédain. Considérés dans leur ensemble, ils ont leur raison d’être, en ce qu’ils répondent à une tendance organique du système : le besoin de ramener l’inconnu au connu.52
On peut même dire d’une façon générale que la prononciation « correcte » (c.à.d. à l’anglaise, à l’allemande, etc.) des mots empruntés est sentie par les Français comme pédante. 53Qui oserait prononcer knockout, etc. comme les Anglais (nokaut) ?
La francisation des noms propres, fréquente depuis la guerre, se fait soit par traduction (Hirsch > Cerf) soit par assimilation phonique et graphique (Dreyfus > Tréfousse ; Seligsohn > Zéligzon ; Ullmann > Oulman ; Frey > Fret, etc.).
L’analogie sémantique et l’analogie formelle ont pour caractère commun l’imitation d’un modèle prédominant dans la conscience linguistique. Déclenchées l’une et l’autre par la laxité des associations de mémoire qui rattachent un élément au reste du système, elles répondent au besoin de limiter cet arbitraire en motivant l’inconnu par le connu.
Mais le besoin d’assimilation, qui tend à combiner ainsi les éléments du langage en un vaste ensemble aussi homogène que possible, ne borne pas son action aux rapports mémoriels.
B) Le conformisme
Le conformisme embrasse tous les procédés par lesquels le besoin d’assimilation cherche à adapter les uns aux autres les divers éléments, grammaticaux aussi bien que phoniques, qui se suivent le long de la chaîne parlée. La linguistique fonctionnelle ne saurait trop insister sur l’identité de principe qui relie des faits aussi différents en apparence que l’Accord, la Concordance des Temps, l’Attraction des Modes, — et le Sandhi ou Conformisme phonique.
Le conformisme grammatical comprend, outre l’Accord proprement dit par lequel le genre et le nombre de l’adjectif ou du verbe varient en fonction du genre et du nombre du substantif auquel ils servent de déterminant ou de prédicat, tous les procédés à l’aide desquels les signes sont obligés de varier catégoriellement les uns en fonction des autres dans le discours.54
C’est ainsi que le verbe de la proposition subordonnée se règle temporellement et modalement sur la subordonnante (concordance des temps et des modes) : Il doute qu’il soit venu > Il doutait qu’il fût venu ; Je sais qu’il viendra > Je savais qu’il viendrait. Ces modes et ces temps de concordance n’ont pas ici de valeur temporelle ou modale par eux-mêmes ; ce sont de simples procédés d’assimilation discursive.
De même, le subordinatif doit changer de catégorie grammaticale en fonction de son régime, c.à.d. qu’il est préposition devant un substantif (après son départ) et conjonction devant une proposition (après qu’il est parti).
Le déterminant varie d’une manière analogue. Adjectif quand il accompagne un substantif (une chanson gaie), il se transforme en adverbe pour déterminer le verbe : chanter gaiment.
Le conformisme porte d’ailleurs aussi bien sur la coordination que sur la subordination. C’est lui qui exige que deux ou plusieurs termes, s’ils sont coordonnés, appartiennent à la même catégorie grammaticale : Je déteste de boire et de fumer (et non : *Je déteste la boisson et de fumer).
Il y a bien d’autres cas encore. Il faudrait mentionner particulièrement les divers phénomènes d’attraction, par exemple en grec ancien l’attraction du relatif par son antécédent : ἔσεσθε ἄνδρες ἄξιοι τῆς ἐλευθερίας (ἧς) κέκτησθε (Xénophon, Anab., I, 7, 3). Certains dialectes allemands connaissent l’attraction de la conjonction avec le verbe : obst du hergehst, dassen wir kommen, obben wir gehen, obt ihr geht (Gabelentz, Sprachwissenschaft, 214, 398). Mais l’exemple classique en cette matière est fourni par les classificateurs des langues bantoues : « Le classificateur de chaque mot a une telle importance qu’il se répète au cours de la phrase pour tous les mots qui s’y rapportent : on dirait que le mot principal impose la couleur de son uniforme à tous les mots qui dépendent de lui » (Vendryes, Langage, 113).
Le conformisme est donc un procédé général d’assimilation discursive, qui caractérise d’une manière ou de l’autre la plupart des idiomes. Nous examinerons d’après les matériaux 55du français avancé quelques-uns des problèmes qui s’y rapportent.
La question des fautes d’accord peut se poser de deux manières : I. L’accord se fait-il selon la catégorie, et dans ce cas avec le sujet ou avec l’objet ? (on a prétendu que dans le langage populaire l’accord tend à se faire spontanément avec le sujet : Brunot PL 335) ; 2. L’accord se fait-il « mécaniquement », c.à.d. selon la séquence, et dans ce cas avec l’élément qui précède ou avec celui qui suit ?
La fréquence et la similarité de ces faits prouvent qu’il ne s’agit pas de simple lapsus ou coquilles ; on voit aussi par là que l’Accord continue à répondre, même et surtout sous des formes incorrectes, à une tendance spontanée et vivante.
Grammatici certant… — L’imparfait est interprété comme temps de concordance par M. Bally (Germ. Roman. Monatsschrift, 6, 418) et M. Brunot (PL 787). Cette théorie est rejetée par M. Lorck, qui attribue à cet imparfait, conformément au psychologisme qui caractérise l’école romaniste allemande, une valeur sémantique en soi (Erlebte Rede, 45 sv ; v. Neutre Sprachen, 35, 460 sv).
Psychologisme. — On sait combien, pour ce genre de problèmes, l’explication psychologiste est chère aux romanistes allemands, de Tobler à nos jours ; v. E. Lerch, Die halbe Negation im Französischen (Die Neueten Sprachen, 29, 6 .sv). Le besoin d’expressivité a peut-être son mot à dire ici ; mais dans l’ensemble et quant au fond il s’agit surtout d’un phénomène de conformisme : la négation se répète au cours de la phrase pour tous les mots qui s’y rapportent. On peut dire d’elle ce qu’on a dit des classificateurs bantous : elle impose la couleur de son uniforme à tous les éléments de la chaîne parlée.
L’attraction du comparatif formait une tournure correcte en latin : verior quam gratior « plus vrai qu’agréable ». On la retrouve dans le français spontané : Plus il vieillit, plus il est meilleur ; La stabilisation sera faite probablement plus tôt que plus tard (R. Poincaré : Thérive NL 4. 8. 28).59
La syllepse du pluriel est la plus fréquente, mais il y a d’autres cas. Ainsi l’accord peut se faire au singulier et au féminin (Plus des trois quarts de sa population est constituée par la classe paysanne ; all. Das Weib verwandte ihre ganze Kunst darauf). Nous connaissons même un curieux exemple de syllepse d’après le temps : Cette ère de mille ans supposait un Etat puissant (historien).
Le conformisme phonique — ou sandhi (sens large) — est l’assimilation qui se produit entre les éléments phoniques dans la chaîne parlée. Le sandhi, qui comporte de multiples variétés, peut se faire notamment d’après la sonorité (azaziner, tranzvormer, etc.), le mode d’articulation (pendant > pen-n-ant) et le timbre (harmonie vocalique, ex. j’aimais = jèmè, j’ai aimé = jéémé).60
Pour l’étude détaillée du phénomène, nous renvoyons le lecteur aux traités spéciaux. Ce qui nous importe ici est de signaler le parallélisme entre le conformisme grammatical et le conformisme phonique, que le point de vue fonctionnel permet de ramener à un principe un.
L’assimilation discursive exige également que les signes qui entrent en combinaison dans la chaîne parlée, fassent partie du même stock linguistique. Ainsi, un élément appartenant au stock populaire ne peut se combiner qu’avec un élément de même couleur, un élément savant qu’avec un élément savant : règle-ment / régul-ation ; avant-coureur / pré-curseur, etc. (v. Bally LV 203-4). Le même fait s’étend au domaine de la graphie : rationnel / rational-isme, donner / don-ation, consonne / conson-ant-isme, etc.
Ce besoin, que nous appellerons faute d’un terme meilleur le conformisme lexical, est senti très vivement par la langue contemporaine. Nous verrons cependant que l’emprise croissante du besoin d’invariabilité sur les autres besoins et notamment sur le conformisme, tend à faire abandonner l’ancienne réluctance du français pour les hybrides.
L’antinomie entre l’invariabilité et le conformisme éclate d’ailleurs sur toute la ligne. La multiplicité des formes qu’engendre l’assimilation discursive augmente en effet l’effort de mémoire à fournir, et provoque par conséquent des réactions en sens contraire. Selon les idiomes, cette lutte se résout dans la victoire de l’un ou de l’autre des deux besoins. Dans le langage avancé d’aujourd’hui, c’est le besoin d’invariabilité qui semble devoir l’emporter de plus en plus.61
Chapitre II Le besoin de différenciation (clarté)
J. Gilliéron : Pathologie et Thérapeutique verbales, I-IV, 1915-21.
J. Gilliéron : Généalogie des Mots qui désignent l’Abeille, 1918.
J. Gilliéron : La Faillite de l’Etymologie phonétique, 1919.
G. Millardet : Linguistique et Dialectologie romanes, 1923.
Le besoin de clarté cherche à distinguer les éléments linguistiques les uns des autres pour éviter les confusions, latentes ou réelles, qui surgissent dans le fonctionnement de la parole. Ici comme ailleurs, le rapport de finalité est constitué par trois termes : le besoin (clarté), le déficit (confusions, équivoques) et le procédé (différenciation).
Le rôle d’initiateur dans ce domaine appartient à Jules Gilliéron, dont les études sur la Pathologie et la Thérapeutique verbales fournissent la meilleure illustration de la finalité empirique du langage telle que nous la concevons. Il faut avouer cependant que l’effort de ce dialectologue s’est concentré presque exclusivement sur les faits de lexique ; tandis que nous aurons l’occasion de constater que le besoin de clarté porte sur tous les éléments du langage : signe et signification, valeurs lexicales et catégories grammaticales, — jusques et y compris la phonologie.
A première vue, il semblerait que le problème à résoudre consiste simplement à chercher comment le langage s’y prend pour détruire les équivoques existantes ; c’est le point 63de vue de la « thérapeutique ». Une vue plus complète devra tenir compte aussi du rôle très important joué par la « prophylaxie ». Lorsqu’il s’agit d’une langue de grande communication telle que le français, parlée avec moins de liberté et plus de conscience que le patois, et subissant de plus l’influence conservatrice de la langue écrite, il est à supposer que dans bien des cas l’équivoque, dépistée dès qu’elle est sentie sous roche, ne pourra guère monter jusqu’à la surface. C’est ce genre de faits que Gilliéron appelait dans sa terminologie pittoresque les « fantômes lexicaux », les « places gardées », etc. (Abeille, 259 sv) ; nous parlerons plus simplement d’équivoques latentes et d’incompatibilités que le besoin de clarté cherche à éviter à l’aide de divers procédés préventifs.
Dans le livre qu’il a consacré à l’influence du journalisme sur le vocabulaire, M. Vittoz classe parmi « les principaux éléments de conservation de la langue… l’obligation de se faire comprendre, et de se faire comprendre exactement » (181). Et de fait la « clarté française » a toujours été un des principaux arguments des défenseurs de la langue. Mais la question serait de savoir si la langue correcte ne présente pas elle-même des équivoques intolérables et si quelques-unes des innovations que l’on reproche au français avancé ne sont pas dues précisément au besoin de prévenir ou de détruire les équivoques, latentes ou déclarées, que présente le français traditionnel. Dans ce cas le besoin de clarté, par les procédés de différenciation qu’il déclenche, constituerait au contraire un des facteurs du changement linguistique.
A) Pathologie et thérapeutique
1) L’équivoque
Le principal déficit qui amène le besoin de clarté à recourir aux procédés de différenciation, est l’équivoque. Celle-ci peut être constituée, dans le jeu de la parole, soit par la rencontre sur un signe unique de deux ou de plusieurs significations, 64entre lesquelles l’entendeur ou le lecteur devra choisir (= bisémie, polysémie), soit par la ressemblance ou l’identité phoniques de signes incompatibles quant au sens (= homophonie).
On entend soutenir quelquefois que l’équivoque n’existe jamais qu’à l’état d’abstraction, par exemple dans les colonnes des dictionnaires, mais qu’elle ne se produit guère dans l’usage hic et nunc que l’on fait de la langue.
Il suffit de prêter l’oreille au jeu quotidien de la parole — dans la rue, au magasin, au téléphone, à table — pour se convaincre du contraire : J’aimerais acheter des plumes (des porte-plume ou des becs ?) ; Passe-moi la pomme (pomme-fruit ou pomme d’arrosoir ?) ; Les indigènes se sont révoltés (les troupes de couleur ou les autochtones ?) ; On a oublié de mettre le timbre sur cette lettre (le timbre-poste ou l’oblitération ?) ; J’ai vu sé lettres (les lettres de lui ? d’elle ? ces lettres ?) ; Il a permis à séz ouvriers de partir (à ses propres ouvriers ? à ceux d’un autre ? à ces ouvriers ?) ; C’est une vue de loteldülak (une vue de l’Hôtel du Lac ? une vue de l’hôtel à partir du lac ?) ; et ainsi de suite.
Gilliéron a montré l’étroit rapport de cause à effet qui bien souvent lie le monosyllabisme à l’homophonie. En effet, plus le signe est court, et petit le nombre des différences phoniques qui le constituent, plus le danger de confondre ce signe avec d’autres signes soumis aux mêmes conditions augmente. On sait à quels procédés spéciaux les langues monosyllabiques (chinois) et les langues monosyllabisantes (anglais) sont obligées d’avoir recours pour remédier à cet inconvénient : complications phoniques (tons distincts à valeur sémantique et morphologique, aspirations, etc.), complications graphiques (orthographe anglaise, idéogrammes chinois), complications grammaticales (composés formés de synonymes juxtaposés, suffixes et déterminatifs distincts pour chaque homophone différent, etc.). On sait aussi que les signes courts ou monosyllabiques que le besoin de clarté, pour une raison ou pour une autre, n’a pas réussi à différencier, sortent de l’usage, vieillissent et finissent par disparaître.
Nous ne nous éloignerons pas trop du sujet de cet ouvrage 65en énumérant ci-après les principaux monosyllabes qui ont disparu du français ou sont en train de le faire. La linguistique fonctionnelle s’intéresse aussi bien aux moribonds qu’aux nouveau-nés : aux uns, pour découvrir les causes de leur agonie ; aux autres, pour connaître les raisons de leur naissance. « C’est surtout dans la nécropole des mots qu’il faut chercher la vérité biologique [= fonctionnelle]. — C’est par l’étude de ces mots que devrait débuter l’historien de la langue pour asseoir ses connaissances et ses principes biologiques, pour savoir les conditions de vie et de mort des mots : seuls les morts peuvent nous permettre de tracer un tableau d’une vie lexicale complète, eux seuls nous révèlent infailliblement la cause qui les a frappés à mort. » (Abeille, 283-4). Quant aux mots que nous appelons vieillis, « à l’égal des mots disparus du français, ils ont l’avantage d’étaler devant nous une vie lexicale complète, mais une vie encore à son dernier souffle, à l’agonie, et celle-ci est souvent seule à pouvoir nous révéler la cause de leur mort prochaine, et celle-ci que dans les mots disparus nous ne pouvons étudier que d’après les dires de nos aïeux, plus ou moins sujets à caution, dans les mots vieillis nous pouvons l’étudier sur nous-mêmes, sur le vif, en pleine connaissance de leur vitalité déclinante. » (Pathologie et Thérapeutique, III, II).
Cette liste montre que la chute des verbes est provoquée par deux déficits principaux : leur irrégularité, et leur homophonie avec d’autres verbes. Que l’irrégularité n’est pas le facteur principal, les défaillances et l’extinction progressive d’un certain nombre de verbes réguliers, appartenant à la première conjugaison, suffisent à le prouver (cf. celer en face de seller et sceller ; bailler « donner » et bayer « béer » en face de bâiller ; conter en face de compter, ouvrer en face de ouvrir, voyer en face de voir, etc.).
2) Les procédés différenciateurs
Outre la revivification des consonnes finales, d’autres procédés encore peuvent intervenir pour grossir le volume des monosyllabes et différencier les homophones.
C’est ainsi que du verbe haïr, quand ce dernier n’est pas tout simplement remplacé par détester, les trois formes du passé (je tu haïs, il haït) sont transportées au présent (au lieu de je tu hais, il hait).
L’adverbe hier « se distend chez les Parisiens pour paraître avoir plus de corps : le provincial — celui de l’Est du moins — est surpris de les entendre dire hi-er. » (Pathol. et Thérap., IV 11). Cette prononciation est même recommandée : « L’adverbe hi-er a deux syllabes depuis le XVIe siècle, et ne doit pas se prononcer yèr. » (Martinon I 195).71
Pour distinguer la pomme d’arrosoir de la pomme-fruit, il arrive qu’on ferme et allonge l’o : Passe voire la paume pour la mettre à l’arrosoir !
Contrairement aux efforts du français avancé pour l’unification du radical verbal, le futur populaire du verbe trouver est aberrant : je trouvérai, tu trouvéras, il trouvéra, etc. (Martinon I 165, B 119). Cette exception semble attribuable au besoin d’éviter la confusion avec le verbe trouer, par suite de l’affaiblissement graduel de la consonne v en langage populaire : je trou(v)erai > < je trouerai.
On sait depuis les études de Gilliéron (Abeille, 189 et passim) le rôle important joué par les pseudo-diminutifs — diminutifs par la forme mais synonymes — dans la différenciation des monosyllabes homophones : ovis → ovicula → ouaille, auris → auricula → oreille, acus → acucula → aiguille, etc. Dans la langue de nos jours, on dit : un grain de mil, mais : du millet.
D’une manière plus générale, les pseudo-dérivés — dérivés par la forme mais synonymes — remplissent la même fonction différenciatrice. C’est ainsi que le français populaire élargit fin en finition, plant en planton (Wissler 796), etc.
Un moyen beaucoup plus fréquent, c’est le renforcement sémantique, à l’aide de procédés syntaxiques ou morphologiques variés qui précisent le sens du terme équivoque : la Sainte-Cène, un ouvrage de vulgarisation dans le meilleur sens du terme, un ouvrage de haute vulgarisation, etc. ; sa famille à lui / à elle ; ou bien / là où, etc.
Ainsi et et est, dangereusement homophones, sont soumis à un traitement bilatéral. La conjonction et s’adjoint diverses particules qui l’étoffent : vivre et puis mourir, et alors, et ensuite, et maintenant. Plus personne, d’autre part, n’ose dire : Vivre est apprendre à mourir ; le remplacement de est par c’est (sans pause : Vivre c’est apprendre à mourir) est devenu une condition indispensable à l’intelligence de ce type de phrases.
Le dernier cas (de > depuis) est davantage une substitution qu’une explicitation. La substitution est le remède radical qui s’impose toutes les fois que les autres procédés sont inapplicables ou inexistants.
Une maison d’édition publie une Collection de Diffusion, qu’elle appelle ainsi sans doute pour éviter l’import péjoratif du mot vulgarisation.
Le traitement du comparatif plus par la finale (pluss) a été souvent signalé. Mais ce procédé, qui n’est qu’un pis-aller, est senti à la longue comme insuffisant. Le remède radical est dans la substitution du mot davantage : J’en ai davantage, Il a davantage de temps, Il en a davantage que lui, etc.
Le déterminatif quelque n’est plus employé au singulier, dans la langue parlée : quelque personne ferait équivoque avec le pluriel. Mais quelque a trouvé des remplaçants, qui permettent en outre de faire une distinction précieuse, connue du latin : une certaine personne (lat. quidam) / une personne donnée (lat. aliquis), et qui répond à l’opposition des lettres N et X dans les formules scientifiques.
Revivification des finales, renforcements divers, fausse diminutivité, explicitation, substitution, — telles sont les principales armes employées par le besoin de clarté contre l’équivoque. Mais une étude détaillée du problème devrait tenir compte de bien d’autres procédés encore. Ainsi une des fonctions actuelles du genre, catégorie en grande partie inutile au point de vue sémantique, est la différenciation 73des homophones : le père / la paire, le maire / la mère, le livre / la livre, etc. Le pluriel, quand l’idée s’y prête, réussit également : avoir des fonds, payer les frais, etc.
Le chinois parlé, langue où le monosyllabisme fait de l’équivoque une question de tous les instants, a dû se créer des procédés multiples : composés synonymiques, c.à.d. formés de monosyllabes synonymes juxtaposés, déterminatifs (particules numérales) variant pour chaque substantif homophone, tons différents pour chaque monosyllabe homophone, etc. On remarquera que l’accent français, par le fait qu’il porte toujours sur le prédicat, respectivement sur le déterminant, sert entre autres à différencier le déterminatif numéral de l’article indéfini : Donnez-moi une pomme (angl. one) / une pomme (angl. a).
Une étude plus complète aurait encore à mentionner le côté graphique du problème. Le langage, tirant parti des hasards et des artifices de l’évolution, distingue en effet les unités homophones en leur donnant à chacune un « orthogramme » différent : fond / fonds, du / dû, dessin / dessein, conter / compter, différencier (différenciation) / différentier (différentiation), etc. etc. L’analogie de ces orthogrammes avec les idéogrammes de l’écriture chinoise a été entrevue notamment par M. Paul Claudel : « … L’étude de la forme des caractères français me passionne : j’y trouve autant d’idéogrammes qu’en japonais. Le mot toit par exemple est vraiment le dessin de la chose représentée. En écrivant les mots, je pense leur forme… » (NL 4. 8. 28).
Comme l’a signalé dès longtemps M. Bally dans ses cours, c’est dans le besoin de clarté qu’il faut chercher la véritable raison d’être d’une bonne partie des chinoiseries de l’orthographe française. Celles-ci apparaissent dans la mesure où le danger d’homophonie est imminent ou, ce qui revient le plus souvent au même, dans la mesure où le volume des mots se rétrécit. Et ces procédés de visualisation des signes ne répondent pas simplement à une tendance artificielle de la langue écrite. Les auteurs qui connaissent l’écriture populaire 74remarquent « l’habitude d’ajouter des lettres qui n’existent ni en français correct écrit ni dans la prononciation populaire. Car le peuple, lorsqu’il fait des fautes d’orthographe, pèche plus par complication que par simplification ». (B 178).
Certains idiomes marquent à l’égard de ce problème une coïncidence qui n’est pas due au hasard. Les langues monosyllabiques comme le chinois et les langues monosyllabisantes telles que l’anglais et dans une moindre mesure le français, sont réputées pour la difficulté de leur phonétique et de leur orthographe. Le chinois différencie les homophones par le ton, la quantité, l’aspiration, etc. ; l’anglais par le timbre des voyelles, etc. ; le français, par exemple par la série des voyelles ouvertes ou fermées, ou par la riche gamme des voyelles nasales qui font le désespoir des étrangers.
Il s’agit donc d’un conflit entre deux besoins fondamentaux : la trop grande brièveté entraîne des équivoques, que le besoin de clarté corrige par des « chinoiseries » de prononciation et d’orthographe. En figurant la différenciation par D et la brièveté par B, on peut noter le phénomène par la formule D = f(B). Cette loi se vérifie pour le chinois, le japonais savant, l’anglais et, dans une certaine mesure, le français.
Réforme de l’orthographe. — La visualisation du signe est en désaccord avec la lutte pour la simplification de l’orthographe et montre combien cette lutte, pour certaines langues du moins, est artificielle. Aucune des tentatives entreprises tant en Chine qu’au Japon pour supprimer les caractères chinois n’a réussi ; pareillement, les tolérances orthographiques autorisées par l’Académie française depuis 1905 ont échoué, parce que contraires au génie spontané de la langue : « Concessions fort modérées, et cependant encore excessives. Latitude dont ni ceux qui l’ont accordée, ni ceux qui l’ont réclamée, ne songent à se prévaloir. Qui s’avise en effet, malgré la permission officielle, d écrire et dévoument, et confidenciel, et enmener, enmitoufler, enmailloter, et pié, et échèle, et dizième, et sizième, et pous, joujous, chous, genous, etc., etc. ? On s’était persuadé que l’insurrection contre l’orthographe traditionnelle avait tout le pays avec elle : l’événement a tout de suite démontré qu’on n’était en face que de quelques « intellectuels » en mal d’innovation ». (Joran. p. 144).75
Après avoir étudié la pathologie et la thérapeutique linguistiques en prenant comme point de départ le cycle fonctionnel, c.à.d. sous l’angle successif des équivoques et des procédés différenciateurs mis en œuvre pour y remédier, nous allons passer à l’examen d’une série de faits montrant comment le besoin de différenciation se réalise dans tous les principaux éléments du système : valeurs lexicales et catégories grammaticales, signe et signification, mémoire et discours, grammaire et phonologie.
B) Différenciation mémorielle
1) Différenciation formelle
Les cas de différenciation étudiés par Gilliéron concernaient surtout le lexique ; dans la suite, nous insisterons davantage sur la différenciation des catégories. Il arrive souvent en effet que les hasards de l’évolution phonétique et grammaticale finissent par mêler, dans une partie ou dans la totalité de leurs emplois, des catégories grammaticales distinctes. Le besoin de clarté est sans cesse à l’affût pour éviter toute équivoque dans ce domaine.
La langue moderne tend par exemple à ne plus distinguer les finales longues et les courtes, et cela entraîne des confusions entre le singulier et le pluriel (il croit > ikrwa < ils croient) ou entre l’indicatif et le subjonctif (qu’il croit > kilkrwa < qu’il croie). La tendance populaire à ajouter un yod aux formes du pluriel et du subjonctif ne doit pas être étrangère à ce fait : Ikrwa (croit) / ikrway (croient), Ivwa (voit) / ivway (voient), Il n’est pas possible qu’un homme ne krway pas ce qu’il krwa, qu’il ne vway pas ce qu’il vwa, etc.
Outre ces cas, il y en a où l’indicatif fait normalement équivoque avec le subjonctif (sans que cela soit dû à l’évolution 76phonétique moderne). Des formes comme qu’il ouvre, qu’il s’y intéresse peuvent appartenir aussi bien au subjonctif qu’à l’indicatif. Les auxiliaires qui supplantent peu à peu le subjonctif traditionnel peuvent intervenir utilement ici pour faire la différence : Et voici qu’il est question que la mariée doit ouvrir le bal (Thérive FLM 94), Il n’y a qu’un public restreint qui peut s’y intéresser (Van Der Molen 97).
De même, le présent et l’imparfait sont identiques dans certaines de leurs formes : nous croyons > nukrwayõ < nous croyions, et c’est une des raisons qui favorisent l’emploi de on : Nous on croit / nous on croyait.
Une source fréquente d’équivoques, dans tout le domaine de la langue, c’est la fermeture progressive de l’e final (è > é) : L’é fermé de mes, tes, ses, ces, les, des (qui se prononçaient autrefois avec è ouvert) appartient désormais à la « bonne prononciation » ; billet, désormais, excès, gai, geai, jamais, mai, mais, quai, je tu il sait, succès, sujet, etc., sont en train d’installer l’é fermé. Cette évolution entraîne de fâcheuses confusions entre certaines formes de la conjugaison. Le passé simple ne se distingue plus de l’imparfait (je mangeais > imàžé < je mangeai), ce qui crée un motif de plus au remplacement du temps simple par le composé (j’ai mangé). Le conditionnel ne se distingue plus du futur (je mangerai > žmãžré < je mangerais), d’où création et extension de formes de futur et de conditionnel composées : j’aimerais manger, je voudrais manger, etc., opposés à je veux manger, je vais manger, etc. Le passé composé de l’indicatif ne se distingue plus du subjonctif passé (que j’ai mangé > žé < que j’aie mangé), et cette équivoque nécessite la prononciation : que j’aye (ey, qqf. ay) mangé.
Dans la langue écrite, l’homophonie de plusieurs formes du passé et du présent motive la création de passés incorrects : Je jouissai d’avance du supplice que j’allais faire subir à ma victime et je choisissai mon moment (Curnonsky et Bienstock, Musée des Erreurs, 17), Le Conseil fédéral les exclua (Godet XXIII), Il conclua bientôt que… (id. LVII) ; v. B 117. Tous ces cas se rapportent à la langue écrite, ou à la langue parlée de teinte écrite. Pour la langue parlée courante, 77c’est une raison de plus en faveur du remplacement définitif des formes simples du passé par des formations composées.
Une équivoque particulière à la langue parlée a été signalée dès l’Introduction : c’est lui quila fait venir (qu’il a ? qui la ? qui l’a ?). L’accord du participe intervient ici d’une façon heureuse pour distinguer le passé du présent : C’est lui qui l’a faite venir, Il l’a faite manger, La joie l’a faite changer de couleur.
L’évolution phonétique a amené la confusion de certaines formes de l’indicatif passé et de l’imparfait du subjonctif (qu’il aimast → qu’il aimât > < qu’il aima ; qu’il reçust → qu’il reçût > < qu’il reçut ; qu’il fist → qu’il fît > < qu’il fit, etc.). Cette confusion entraîne, dans la langue écrite de nos jours, la création de certaines fautes destinées à différencier ces deux catégories grammaticales : Il n’y avait pas un homme de la caserne qui ne riât aux larmes (Curnonsky et Bienstock, Musée des Erreurs, 17).
La confusion entre le passé simple et l’imparfait du subjonctif est parallèle à celle entre le passé antérieur et le plus-que-parfait du subjonctif : Il eut aimé > < Il eût aimé (cf. surtout les fautes du type : Dès qu’il eût…, Dès qu’il fût…, Après qu’il fût…). On sait que le remplacement du passé antérieur composé par le surcomposé est une simple unification analogique (il eut > il a eu = il eut mangé > il a eu mangé) ; mais l’état de confusion entre le passé antérieur et le subjonctif passé motive d’autant plus ce remplacement.
On sait que dans le français avancé le verbe disparaître ne prend pas l’auxiliaire avoir, ce qui explique l’équivoque de il est disparu « état consécutif à un procès > < procès logé dans le passé ». Il va sans dire que dans ces emplois le passé antérieur, au lieu de fonctionner comme un temps relatif (« passé dans le passé »), sert de temps absolu.
Mais nous ne sommes pas encore au cœur du problème. M. Meillet a montré dans son étude sur la disparition des formes simples du prétérit (Linguistique Historique et Lingu. générale, 149 sv) comment le français parlé a remplacé le passé simple par le composé. Cependant, « il est fâcheux que le français moderne ait réduit à un seul les deux temps passés dont il disposait, le passé défini et le passé indéfini : la différence qui les séparait était réelle, et l’on pouvait en les employant rendre de fines nuances, qui aujourd’hui disparaissent faute d’expression. » (Vendryes, Langage, 411). Quelle était cette nuance ? Les grammairiens s’accordent en général à reconnaître que le passé simple marquait « un fait entièrement achevé à une époque antérieure, plus ou moins déterminée, sans aucune considération des conséquences qu’il peut avoir dans le présent : à telle époque il aima, il reçut, il écrivit. C’est le temps naturel du récit historique ou de la narration ». (Martinon II 347). Le passé composé marquait « un fait achevé à une époque indéterminée, généralement récente, et dont on considère les conséquences dans le présent : j’ai terminé mon travail ; je suis arrivé à mon but ». (ib.). De ces définitions, qui sont complexes, nous ne retiendrons que ce qui nous paraît l’essentiel : le Passé défini marquait le « passé déterminé », le Passé indéfini le « passé indéterminé ». (v. D’Harvé PB p. 262 n).
M. Foulet, à qui nous empruntons la plupart de ces exemples (Romania, 51, 203 sv) a signalé les notions de recul dans le passé et d’indétermination quant à la date que cette forme surcomposée est chargée de rendre. Mais il importe de bien distinguer l’emploi de ce passé comme temps absolu (« passé indéterminé ») ou relatif (Passé antérieur = « passé dans le passé »).
Le français traditionnel distingue le participe présent marquant un procès, du participe pris au figuré comme qualificatif, en accordant ce dernier avec son substantif : Une femme causant (« procès ») / Une femme causante (« qualité »). Mais pour le participe passé, le français traditionnel n’a pas de procédé signalant formellement la différence ; seuls, la situation et le contexte permettent d’établir si un participe passé est pris au sens propre (« état consécutif à un procès ») ou s’il est transféré en un qualificatif.
Les mêmes réactions différenciatrices se constatent dans le domaine des adjectifs de procès, sans cesse guettés par la transformation en qualificatifs : un élément décisif / décisoire, des mesures conservatives / conservatoires, une théorie réfléchie / réfiexive (Lalande 693), un jugement relatif / relationnel, etc. Les adjectifs potentiels négatifs surtout, finissent fatalement par verser dans la qualification (incommensurable, intolérable, intangible, etc. sont employés comme de simples évaluateurs), ce qui oblige le langage à les recréer sans cesse soit dans le parler (pas comparable, pas mesurable ; pas à comparer, pas à mesurer) soit dans l’écrit (non-comparable, non-mesurable…).
Différenciation explicite. — Les langues qui ne peuvent se servir de la séquence distinguent par la forme : Eine neue Methode / eine neuartige M., eine einzige Sammlung / eine einzigartige S., eigene Beobachtungen (des observations personnelles) / eigenartige B. (des o. originales).
2) Différenciation sémantique (bifurcation des synonymes)
En disant que l’équivoque est le principal déficit qui déclenche les procédés de différenciation, nous n’avons tenu compte que d’un côté du phénomène.
Un déficit qui forme la contre-partie de l’équivoque, 83la synonymie, est l’objet de vues contradictoires. On affirme ou nie tour à tour l’existence de synonymes dans le langage. La linguistique fonctionnelle pose la question autrement. Il y a des synonymes, mais cette synonymie étant conçue comme un déficit, le langage cherche à s’en débarrasser. Deux solutions sont alors possibles : ou bien la langue ne conserve que l’un des deux concurrents et abandonne l’autre, ou bien — et c’est ce qui nous intéresse ici — elle conserve les deux en revotant chacun d’une signification distincte (ex. âpreté / aspérité, avoué / avocat, chaire / chaise, col / cou, etc.).
Bibliographie. — Bréal, Sémantique, 26 n. (loi de répartition) ; Erdmann, Bedeutung des Wortes, 28 sv. (Bedeutungsdifferenzierung des Gleichwertigen, Gabelung des Plurals) ; Gabelentz, Sprachwissenschaft, 238, 254 (Entähnlichung der Bedeutungen bei Doubletten).
Quand on n’étudie des signes que leur histoire, il est difficile d’établir dans chaque cas s’il y a eu différenciation formelle ou sémantique (voir les exemples donnés plus haut). Il est donc nécessaire d’observer le phénomène sur le vif, dans les fluctuations de l’usage présent.
Au sens étroit, la bifurcation porte sur les doublets, c.à.d. les formes distinctes d’un signe conçu comme identique. C’est ainsi que recouvrer et récupérer, qui coexistent dès le XVIe siècle, admettent aujourd’hui des emplois distincts : on recouvre une somme due, une taxe, un impôt, mais on récupère ce qu’on a perdu (v. Gilliéron, Abeille, 267). Un acquéreur est celui qui achète pour son propre compte, tandis que l’acquisiteur le fait pour le compte d’une maison (Godet VI, VII).
La bifurcation est un procédé courant de la langue savante. La majeure partie de l’effort terminologique des savants et des philosophes, si l’on fait abstraction des néologismes formels, repose sur la différenciation des synonymes. Pour ne citer qu’un exemple, l’opposition des préfixes négatifs latin in- et grec a-, est souvent utilisée pour distinguer les contraires et les contradictoires : Le génie est a-moral et non immoral, le langage est a-logique et non illogique, etc.
La langue administrative se sert également de la bifurcation. Ainsi la poste suisse ne distingue pas entre une lettre chargée ou recommandée ; en France, l’administration a différencié les deux mots : lettre recommandée (all. eingeschrieben) / chargée « valeur déclarée ».
La bifurcation peut aussi s’exercer sur l’import du signe, dans ce sens que de deux synonymes l’un sera pris en bonne l’autre en mauvaise part, ou que l’un appartiendra à un langage plus poli l’autre moins, etc. Ainsi les couples traditionnels voici-voilà, ici-là, çui-ci – çui-là, ne correspondent plus à la différence entre « proche » et « éloigné », mais à celle entre « relevé » et « populaire ». De même, la formule des magasins est Et avec ceci ?, tandis que sur le marché en plein air on entendra Et avec ça ? ; la numération en centimes (cinquante centimes) est plus relevée que celle en sous (dix sous) ; de suite est plus poli que tout de suite, etc. Cf. mou / mol (sens péjoratif et archaïsant : l’humanitarisme mol) ; fou / fol (un fol adorateur du peuple), etc.
Casuistique. — La manie des puristes et des grammairiens de chercher dans certaines fluctuations de l’usagé des nuances sémantiques subtiles, relève du même besoin que là bifurcation 86des synonymes et n’en est que l’exagération. C’est ainsi qu’ils veulent voir une différence entre je suis allé (« aller simple ») et j’at été (« aller-retour »), entre désirer de (« désir dont l’accomplissement est incertain ») et désirer tout court (« désir dont l’accomplissement est certain »), entre avant que et avant que ne (« sens légèrement dubitatif »), entre après-dîner et après-dînée, etc. etc. Personne au monde n a jamais su où ils prenaient tout cela.
C) Différenciation discursive
1) Différenciation syntagmatique
Bien téméraire celui qui dénierait à la syntaxe moderne des états pathologiques et des états restaurés. Je dirai même : à quand la syntaxe réparatrice ? (Gilliéron, Pathol. et Thérap., III, 55).
La différenciation syntagmatique embrasse tous les problèmes qui se rattachent au degré de cohésion et à la portée respective des signes enchaînés sur la ligne du discours.
Au point de vue du degré de cohésion des signes agencés, il faut distinguer le lexique (signes simples) et la syntagmatique (signes agencés) ; la syntagmatique se divise à son tour en syntagmatique plus ou moins étroite (morphologie) et syntagmatique plus ou moins lâche (syntaxe). Il est important pour la clarté de la chaîne parlée que ces divers éléments soient bien distingués les uns des autres, qu’un syntagme par exemple ne puisse être interprété comme un signe lexical (ex. nous apprenons d’ailleurs / par ailleurs que…), ni un groupe syntaxique comme un composé, etc.
Un des problèmes les plus importants, dans le domaine de la différenciation syntagmatique, est celui du de dit explétif, par lequel le français distingue le prédicatif du simple déterminant : une chambre libre / une chambre de libre. Ce de, qui est à peu près admis aujourd’hui dans certains cas, constitue dans d’autres une incorrection plus ou moins forte.
Les exemples les plus fréquents jusqu’à présent semblent se rattacher à la formule substantif actualisé + de + participe passé (ex. C’est un grand pas de fait). Pourquoi dit-on dans certains cas : un franc perdu, trois livres reliés, et dans d’autres : un franc de perdu, trois livres de reliés ? On a l’impression nette que un franc perdu et un franc de perdu, trois livres reliés et trois livres de reliés, etc., répondent à des valeurs syntagmatiques distinctes. Perdu, reliés sont de purs déterminants, qui s’appliquent à des signes virtuels (franc, livres), tandis que de perdu, de reliés sont des prédicatifs, portant sur des termes actualisés (un franc, trois livres).88
La différence entre prédicatif et déterminant s’accompagne d’une différence dans la délimitation des éléments. Les combinaisons virtuel + déterminant ont une cohésion assez forte : un | franc perdu, trois | livres reliés ; les combinaisons actuel + prédicatif, au contraire, présentent à peu près deux termes : un franc | de perdu, trois livres | de reliés. Les premières se rapprochent, à des degrés infiniment divers, de la composition, tandis que les secondes sont du côté de la syntaxe.
Dans ces trois langues, la place de l’adjectif déterminant est assez rigoureusement fixe. Il sera reparlé de la fin toute différente à laquelle sert la place mobile de l’adjectif français.
Après les nominaux tels que rien, personne, quoi, quelque chose, etc., le de est devenu à peu près obligatoire (quelques-uns condamnent encore personne de et rien de) ; cet emploi ressort de la nature même de ces signes, qui sont des actualisés par définition (rien « pas une chose », aucun « pas un homme », quelque chose « une chose donnée », etc.).
Autres langues. — Ici encore, il ne s’agit pas de subtilités particulières au français, mais d’une différence fondamentale (déterminatif + signe virtuel / nominalisé + actualisé), faite peu ou prou par la plupart des langues.
L’allemand distingue en combinant l’accord et le non-accord : Ich habe eine reife (< eine reife Traube, j’ai une mûre) /… eine reif (< eine Traube reif, j’ai une de mûre).90
L’anglais distingue en préposant ou postposant le représentant one : I have a ripe one (< a ripe grape) / I have one ripe (< a grape ripe).
Mais si en français l’article indéfini est interchangeable avec son nominal, il n’en est pas de même pour l’article défini ; on ne saurait dire *la de libre. La langue parlée a recours, dans ce cas, au démonstratif celui : Je vais vous donner celle de libre « la chambre qui est libre », On mettra de côté celles de véreuses « les pommes qui sont véreuses », etc. La formule est donc : une libre / une de libre = la libre / celle de libre.
Dans beaucoup de cas, le français correct ne peut se débarrasser de l’équivoque. Ainsi, un Monument aux morts pour la patrie, est-ce un monument aux morts dédié à la patrie, ou un monument érigé en l’honneur de ceux qui sont morts pour la patrie ? Le français est ici vraiment à un point tournant, si l’on considère les nombreux cas de syntagmatique équivoque appartenant à ce type ; le sujet vaudrait une étude détaillée, et les observateurs du langage spontané devraient guetter tous les procédés mis en œuvre par le langage avancé pour tourner la difficulté.
Il arrive que la liaison serve correctement à différencier 91les deux formules : Un marchand de drap(s) anglais / un marchand de draps-z-anglais (Martinon I 377), une fabrique d’arme(s) anglaise / une fabrique d’armes-z-anglaises (id. 380). Mais il faut bien avouer que ce procédé est actuellement plus que fragile.
Pour bien saisir la valeur de ce procédé, il ne faut consulter naturellement que l’oreille et faire abstraction de l’écriture. Bref, la recherche des moyens par lesquels le langage essaye de différencier la portée respective des signes agencés dans le discours, devrait être poursuivie dans tout le domaine de la grammaire syntagmatique. Cf. 26 dossiers de 2000 numéros (total) / 26 dossiers à 2000 numéros (chacun) ; elles sont toutes différentes (all. alle) / elles sont tout différentes (all. ganz), etc.
Une autre face du problème est ce qu’on peut appeler la différenciation séquentielle. Si le langage ne se servait de procédés spéciaux pour signaler l’inversion — notamment l’accent et l’usage de séparatifs — il serait difficile souvent de savoir si tel syntagme représente la séquence normale ou constitue une inversion. Dans les deux types : C’est un bijou que cet enfant ! (inversion expressive de : Cet enfant est un bijou !) et : un bijou d’enfant ! (inversion expressive de : un enfant bijou !), l’inversion est signalée par l’accent, qui 92porte sur le prédicat, respectivement sur le déterminant originels (bijou), et par les séparatifs de et que.
Un type d’équivoques fréquent porte sur la difficulté de déterminer le sujet d’un infinitif-régime. En principe, la règle héréditaire exige que le sujet de l’infinitif placé après un verbe soit le même que celui du verbe qui régit cet infinitif : J’espère venir demain = J’espère que je viendrai demain.
Mais la langue actuelle marque une telle préférence pour l’infinitif (en général aux dépens du subjonctif) qu’elle l’emploie même lorsque le sujet du verbe subordonnant et le sujet de l’infinitif subordonné sont différents. « L’emploi de l’infinitif est tellement commode, il allège tellement les phrases où il se trouve, qu’on en use volontiers même pour renvoyer à un complément, pourvu qu’il n’y ait aucune équivoque possible : le roi l’a choisi pour commander ; les électeurs l’ont nommé pour faire leurs commissions. On peut même dire, en renvoyant à un sujet indéterminé : pour faire sa fortune, le théâtre vaut mieux que le roman ; la marche est excellente pour s’entretenir en bonne santé ; ceci est excellent pour manger ou pour boire. Mais on voit sans peine le danger de cette syntaxe, et on sait que le français évite volontiers l’équivoque. » (Martinon II 447).
Le français avancé évite toute confusion dans ce domaine par l’insertion du pronom personnel entre la préposition pour et son régime l’infinitif : Va chercher le journal pour moi lire. Au premier abord, cette construction semble du petit-nègre ; mais elle est si bien attestée que son existence est hors de doute.
Bibliographie. — B 124. — Thérive FLM 47. — Marouzeau, Linguistique, 74. — D’Harvé PB, suppl. belge, § 171. — Prein, 15-6. — Van der Molen, 107-9, plus qqes ex. dans les lettres de mineur de l’Appendice.
Le participe présent entraîne les mêmes équivoques que l’infinitif et, parallèlement à lui, des procédés différenciateurs analogues : Mes parents vous ayant écrit, mais moi n’étant pas très bien avec, je ne sais ce que mon frère devient (APG).
Ce type, caractéristique de la langue cursive, est un latinisme déjà ancien, qui semble aujourd’hui admis.
Tous ces procédés, plus ou moins parallèles — pour moi écrire, moi voulant écrire, la lettre par moi reçue — ont leur origine dans la langue du droit et de l’administration : …Et lour donna rentes pour elles vivre (Joinville : Van Der Molen 108) ; Item, le 4e de feuvrier, vint Gargantuas loger en la sala et pour deux jours, tant de son cheval que dépance par lui faite, V sols (Registre des comptes, XVe siècle : D’Harvé PB § 359). De fait, la langue juridico-administrative est caractérisée par la place prépondérante accordée au besoin 95de clarté et aux procédés de différenciation qu’il déclenche ; ce qui achève de démontrer le parallélisme de ces diverses constructions.
2) Différenciation phonique
La phonologie mémorielle et la phonologie discursive sont soumises l’une et l’autre au besoin de clarté.
D’une part, dans les rapports de mémoire, les phonèmes doivent être suffisamment distincts pour qu’on ne les confonde pas entre eux. D’autre part, les éléments phoniques enchaînés sur la ligne du discours doivent être eux aussi nettement différenciés les uns des autres.
Nous laisserons de côté la différenciation mémorielle, question délicate qu’il faut réserver à des études spéciales, — pour ne considérer que l’aspect discursif du problème, sur lequel le français avancé fournit des renseignements plus abondants.
a) Délimitation.
Il est arrivé que des linguistes, tirant argument de ce fait, ont voulu nier « l’unité psychologique du mot ». Mais à défaut d’une correspondance exacte entre la séparation des syllabes et la délimitation grammaticale, telle qu’elle se rencontre dans les langues monosyllabiques, les procédés variés par lesquels les divers idiomes cherchent à séparer la finale du mot de l’initiale du suivant, et l’initiale du mot de la finale du précédent, semblent indiquer que la « conscience du mot » est bien une réalité linguistique.96
Tout problème de délimitation (discours) est d’ailleurs lié à un problème d’identification (mémoire). Ainsi le fait qu’en français la séparation syllabique et la délimitation grammaticale ne correspondent pas, amène une multitude d’inconvénients ; le calembour n’est pas un des moindres : Il est trop osé (> < trop posé), Il a une tentation (> < une tante à Sion), Ah non (> < ânon), etc.
Quels sont les procédés employés par le français pour faire coïncider la coupe de syllabe avec la limite de mot ?
Un procédé courant, et d’ailleurs à peine perceptible, est la non-liaison. Un syntagme comme avoir honte, par exemple, pourra se prononcer « syllabiquement » (a-vwa-rõt), ou au contraire « grammaticalement » (a-vwar-õt). Telle est la vraie raison d’être de l’h dit aspiré, qui est en réalité un séparatif destiné à faire correspondre la coupe de syllabe avec la limite de mot ; le langage populaire tend à l’étendre : un | huissier (B 44).
Dans quelques cas, le français avancé va encore plus loin et favorise la coupe des mots par l’insertion de consonnes 97séparatives : un vhuissier, de la vouate, une choupette (houpette à poudre, B).
De même, -tier a supplanté -ier (lait-ier → lai-tier), -ter a remplacé -er (abri-er → abri-ter), et ainsi de suite. Pareillement, « pour la conscience linguistique actuelle, le signe du futur est -rai et non plus -ai » (Bally LV 74) : J’aimer-ai → j’aime-rai.
Les changements de délimitation amenés par la tendance à l’initiale consonantique sont particulièrement visibles dans les groupes article + substantif. Deux cas sont possibles.
(Tous ces faits sont des accidents. Mais la sélection linguistique conserve de tels accidents, lorsqu’ils répondent à la tendance du français vers l’initiale consonantique. C’est à cette conservation par sélection que nous devons des mots comme lendemain, lierre, lingot, loriot, luette et tante).99
b) Dissimilation.
Tout au plus peut-on noter certaines préférences. Le français évite autant que possible la rencontre des k, en contact ou à distance. C’est à cette réluctance que nous devons la perte de formations telles que dans le cas que et au cas que ; dans le cas où et au cas où sont, au fond, des dissimilations.
Dans la langue de nos jours, on a recours aux procédés les plus divers pour éviter les rencontres de k. Ainsi, comme on ne saurait dire : *J’aime mieux qu’il s’en aille que qu’il reste, on a la tournure : J’aime mieux qu’il s’en aille que s’il reste. (D’autre part, on dit assez correctement, pour éviter la répétition de deux si : Si vous travaillez et que quelqu’un vient vous déranger…).
La dissimilation, sous ses diverses formes, porte naturellement aussi sur les répétitions de voyelles. Une des phobies du français, par exemple, c’est la répétition de plusieurs e muets : *Jə nə mə lə suis pas rappelé ; d’où la thérapeutique : Je (ne) m’en suis pas rappelé, appuyée sur l’analogie de je m’en souviens.
c) Netteté de syllabation.
« La tendance à alléger autant que possible la syllabe en supprimant les éléments qui entravent le mécanisme normal des explosions et des implosions successives, n’est pas illusoire. Sans aller aussi loin que l’arabe qui n’admet pas le contact de deux consonnes à l’intérieur de la même syllabe, les idiomes romans tendent plus ou moins nettement à réaliser un type de syllabe satisfaisant à la fois le sens articulatoire et le sens acoustique par une gradation aussi nette que possible des apertures. » (Millardet, 317).
Cette tendance différenciatrice qui cherche à rendre la syllabation aussi nette que possible, se manifeste sous deux formes principales, le besoin d’éviter les blocs de consonnes et celui d’éviter les rencontres de voyelles (hiatus).101
La prosthèse est particulière aux groupes ouvrants s + occlusive + phonème d’aperture plus élevée (ex. sta-, spé-, etc.). Ces groupes, par la succession d’apertures qu’ils présentent (1+o + phonème d’aperture plus élevée), sont en effet contraires à une bonne syllabation (principe des apertures régulièrement croissantes dans les groupes ouvrants, régulièrement décroissantes dans les groupes fermants : Saussure CLG 88 sv). La prosthèse a pour but de transformer l’s en une fermante suivie d’une limite de syllabe : scu-tum → is-cutum (→ escu → écu) ; spi-ritum → is-piritum (→ esprit). Exemples actuels : u-nəs-tatue, u-nəs-tation, etc. Cette prononciation est taxée de méridionale.
Il faut bien avouer d’ailleurs que le traitement des blocs de consonnes par l’insertion d’un e dit muet est entravé de plus en plus dans la langue de nos jours par la chute générale et progressive de cet ə même dans les cas où la netteté de syllabation exigerait son maintien. « Il nous paraît que les Français sont en train d’acquérir peu à peu une plus grande aptitude à prononcer des groupes de consonnes qui étaient autrefois réservés aux gosiers germaniques. Les gens qui, à l’heure actuelle, prononcent tout naïvement une estatue, une estation, excitent la risée des Français qui ont passé par l’école… Mais les modernes peuvent dire sans broncher, non seulement : un’ statue, mais : un’ grand’ statue, tourn’-toi, rest’-là, un’ solid’ structure, etc. » (Nyrop, Manuel phonét., § 92).102
En dernier ressort, quand aucun des moyens indiqués n’est applicable, c’est le besoin de brièveté, toujours à l’affût, qui intervient pour supprimer la difficulté phonique, en faisant tomber l’une ou plusieurs des consonnes en présence (amuissement).
Les blocs de consonnes ont leur contre-partie dans les rencontres de voyelles ou hiatus.
Le cuir, ou insertion d’un t, est beaucoup moins fréquent que le velours : Il va-t-et vient, Il faudra-t-aller (B 57), I va-t-en ville.
On sait que la langue de la poésie garde l’ancienne prononciation vocalique : ambiti-on, délici-eux, di-amant, passi-on, etc. Lorsque la seconde voyelle est moins ouverte que la 104première, la consonification atteint la seconde : abbaye > abèy (B 54).
Souvent d’ailleurs, il y a plutôt diminution d’aperture que consonification véritable : Agr(i)able, p(u)ète, c(u)incidence, (u)asis.
Citons pour terminer, le cas où l’hiatus est éliminé à la faveur de synonymies grammaticales : fainéant > feignant ; au hasard de la fourchette > à l’hasard de la fourchette (Martinon I 249) ; il n’a été fait d’exception pour personne (Joran n° 84).
Et là encore, comme pour les blocs de consonnes, c’est l’amuissement (dont il sera reparlé) qui a le dernier mot quand aucun autre procédé ne réussit.105
Économie : brièveté et invariabilité
Le besoin d’économie, bien qu’il puisse être tenu en échec par des influences opposées, est un facteur indéniable dans la vie du langage.
Pour le parleur et l’entendeur pressés, le jeu de la parole et de l’interprétation doit se dérouler aussi rapidement que possible. Le parleur abrège ou supprime plus ou moins inconsciemment tout ce qui dans une situation donnée va de soi, c.à.d. tout ce qui, étant connu de l’interlocuteur, forme le fond commun de leur conversation. L’entendeur, de son côté, au lieu de soumettre la parole de son interlocuteur à une analyse serrée, cherche à comprendre avec le minimum d’effort et de temps.
L’économie linguistique se manifeste sous deux aspects opposés, selon qu’on la considère dans l’axe du discours ou dans celui de la mémoire. Le besoin de brièveté (chap. III), ou économie discursive, cherche à abréger autant que possible la longueur et le nombre des éléments dont l’agencement forme la chaîne parlée. Le besoin d’invariabilité (chap. IV), ou économie mémorielle, cherche à alléger autant que possible l’effort de mémoire à fournir, en conservant toujours la même forme à un élément linguistique donné, malgré la variété des combinaisons dont il est amené à faire partie.107
Chapitre III Le besoin de brièveté
Bally, Copule zéro et faits connexes (Bull. Soc. Lingu. 23, 1 sv).
Brunot PL 63 sv (nominaux), 171 sv (représentants).
Nyrop IV § 77-97 ; V § 10-28.
Saussure CLG 248 sv (agglutination).
A) Figement (brachysémie)
Le mécanisme de la brachysémie ou brièveté sémantique, qui est le figement d’un syntagme, c.à.d. d’un agencement de deux ou plusieurs signes, en un signe simple, a été décrit par F. de Saussure sous le terme d’agglutination ; celle-ci « consiste en ce que deux ou plusieurs termes originairement distincts, mais qui se rencontraient fréquemment en syntagme au sein de la phrase, se soudent en une unité absolue ou difficilement analysable ». (CLG 249). Exemples : ce ci → ceci ; tous jours → toujours ; dès jà → déjà, etc. « Cette synthèse se fait d’elle-même, en vertu d’une tendance mécanique : quand un concept composé est exprimé par une suite d’unités significatives très usuelle, l’esprit, prenant pour ainsi dire le chemin de traverse, renonce à l’analyse et applique le concept en bloc sur le groupe de signes qui devient alors une unité simple. » (250).
Le phénomène présente deux faces successives, une face sémantique et une formelle, qu’il importe de bien distinguer. Au point de vue sémantique, la brachysémie est le remplacement d’une suite de deux ou plusieurs significations 109par une signification unique ; au point de vue formel, l’ancien syntagme, considéré désormais comme trop long en tant que signe simple, est soumis après coup aux effets de l’agglutination matérielle (abréviations, mutilations, etc.). Ainsi bonhomme, avec son pluriel correct bonshommes, est figé dès longtemps, tandis que l’agglutination matérielle qui consacre ce processus n’est qu’une innovation récente (des bonhommes). Il va sans dire que si la science se donne la liberté de dissocier les phénomènes, comme nous le ferons ici, pour les étudier séparément, dans la réalité concrète les deux aspects — brachysémie et brachylogie — sont trop solidaires pour se concevoir séparément.
Les principaux indices de la brachysémie sont la difficulté des substitutions partielles et, corrélativement, la facilité des substitutions totales. Ainsi bon marché est partiellement figé, car d’une part il est difficile de substituer mauvais marché, etc., et d’autre part il devient d’autant plus facile de substituer des synonymes (économique, etc.) ou des contraires (cher, etc.).
De même, la facilité de déterminer globalement et la difficulté de déterminer partiellement, sont aussi des indices corrélatifs. Dans des exemples populaires tels que : c’est plus bon marché, une marchandise plus bon marché qu’une autre, trop de bonne heure (Joran n° 289), le qualificatif s’applique à l’ensemble du bloc (au lieu de meilleur marché, de trop bonne heure).
Dans tous ces exemples, l’incohérence et le pléonasme sous roche ne percent qu’à l’analyse, et c’est précisément l’oubli du sens des éléments constitutifs du syntagme qui rend ces fautes concevables.
L’accord fautif peut être également un indice de brachysémie. Dans une phrase comme : elle a l’air méchante, l’accord, aujourd’hui toléré, signale le figement de avoir l’air en un verbe transitif d’inhérence : « elle paraît méchante ». Cf. Ces deux choses n’ont rien de comparables (n’avoir rien de > « n’être nullement »). Inversement, le non-accord des éléments bloqués sert à son tour d’indice : Elle s’est fait fort de réussir.
Bien que le figement ne soit pas directement un procédé, mais un processus, la finalité y a son mot à dire, car ce processus dans l’ensemble ne s’attaque pas à n’importe quels syntagmes, mais de préférence à ceux qui pour une raison 111ou pour une autre sont difficilement analysables, donc déficitaires.
La condition essentielle qui domine toute brachysémie est en effet, nous le savons déjà, l’incompréhension plus ou moins forte des éléments. Cette incompréhension se produit notamment lorsque l’invariabilité est en défaut, c.à.d. lorsque la mémoire ne parvient pas à rattacher les éléments du syntagme au reste du système, puisque l’entendeur tend toujours à interpréter les syntagmes en les ramenant à l’usage le plus communément reçu.
Le figement, considéré de ce point de vue, constitue donc un cas limite de la finalité (sélection par élimination des inaptes). Il s’attaque de préférence aux formes fossiles, qui, ne se laissant pas rattacher au reste du système, sont difficilement analysables. Exemple : Cette information s’est avérée inexacte (l’alternance vrai/ver- est un défi à la mémoire).
Le figement bloque naturellement de même manière les syntagmes qui résistent à l’analyse par le fait qu’ils sont empruntés à une langue étrangère : bifteck de veau (← beef-steak « grillade de bœuf ») ; five o’clock à toute heure, etc.
Après ce regard jeté sur la Brachysémie, ou brièveté sémantique, nous allons considérer la Brachylogie proprement dite, ou brièveté formelle, qui peut être obtenue à l’aide de deux procédés principaux : la représentation et l’ellipse.
B) Représentation
Au lieu d’énoncer les mots et les syntagmes tout au long de la chaîne parlée, l’esprit cherche sans cesse à les représenter à l’aide de signes plus brefs et plus maniables.
Le cas classique de la représentation est fourni par les pronoms. La grammaire traditionnelle désigne sous ce terme « un mot qui tient la place du nom » : Pierre est parti, mais il reviendra. M. Brunot a élargi d’une manière heureuse cette conception étymologique du pro-nom. « Le mot pronom, comme il a été employé, donne des idées fausses. On l’a appliqué à des mots qui remplacent tout autre chose que des noms. Ils représentent des adjectifs : belle, elle l’est ; le savant que vous êtes ; des verbes : allez-y, il le faut ; des idées entières : elle défit sa chevelure, et cela avec la simplicité d’une enfant ; je bois de l’eau, ce qui me réussit très bien. Il faudrait donc distinguer des pronoms, des proadjectifs, des proverbes, des prophrases. Pour éviter ces mots équivoques ou barbares, nous dirons représentants… » (PL 173).
Il convient d’ajouter que ces divisions établies d’après la catégorie du signe représenté — représentation du nom, de l’adjectif, du verbe, de la phrase, etc. — sont surtout formelles. Si au contraire on se place au point de vue du fonctionnement, la première constatation montre que la représentation peut mettre en jeu deux sortes de rapports fort différents quoique parallèles ; selon que le signe représenté 113se trouve logé dans la mémoire ou dans la chaîne parlée même, nous parlerons de représentation mémorielle ou de représentation discursive.
Or la représentation telle qu’elle est définie et exemplifiée par M. Brunot ne s’applique qu’aux rapports discursifs ; les représentants qu’il étudie sont des anaphoriques (annonces et reprises) : Pierre est arrivé, je l’ai vu ; Elle l’a manqué, son train.
Mais il est intéressant de constater d’autre part que les nominaux de M. Brunot ne sont pas autre chose qu’un cas de représentation mémorielle. « A côté des noms véritables, il y a des noms ou des expressions qui ont été généralement classées soit parmi les noms, soit parmi les pronoms, parce qu’on répugnait à changer le nombre des « parties du discours ». De toutes provenances, ces mots ne sont pas arrivés à avoir tous les mêmes caractères ; il est cependant nécessaire de les réunir, et il m’a paru que le nom d’expressions nominales ou de nominaux leur convenait assez bien, car, on le verra par la suite, ils se rapprochent des noms sans se confondre avec eux… » (PL 63). Exemples : moi, nous, lui ; quelqu’un, quelque chose, rien, tout, cela ; etc. etc.
M. Brunot a d’ailleurs signalé les fréquents échanges qui se produisent entre représentants et nominaux : « … La plupart des représentants peuvent devenir des nominaux. Une femme fait des reproches à son mari : Tu ne travailles pas, tu es toujours à causer avec celui-ci, avec celui-là, avec l’un, avec l’autre. » (PL 63-4). Cela revient à dire qu’un signe qui représente normalement un autre signe agencé dans la chaîne parlée, peut occasionnellement servir à représenter un signe logé dans la mémoire.
1) Représentation mémorielle
Il va sans dire que ce terme de nominal — parallèlement au pronom, qui ne représente pas exclusivement un nom mais peut remplacer tour à tour un adjectif, un verbe, une phrase, etc. — devra lui aussi être élargi.
Ainsi l’infinitif n’est pas autre chose que le représentant 114d’un verbe conjugué et par conséquent d’une proposition : Il est temps de partir (Z Il est temps que nous partions), Je veux mourir (Z *Je veux que je meure), v. De Boer, Revue de Lingu. romane, 3, 307.
Nous indiquons ci-dessous quelques types qui intéressent particulièrement le français avancé.
Les mêmes procédés de représentation s’appliquent aux temps. Bien que le passé simple ait disparu à peu près complètement de la langue parlée, les agences de presse et les journaux le conservent soigneusement, pour faire l’économie de la forme composée : Il débarqua (Z il a débarqué).
La langue moderne aime à abréger les relatives (Legrand, Stylistique française, 113-40, indique les procédés corrects qui permettent de se passer du relatif). « En vertu du moindre effort à faire, on abrège des locutions : une pièce mouvementée, pour : une pièce qui a du mouvement ; un style imagé, pour : un style qui a des images ; un événement sensationnel, pour : qui fait sensation. » (Vincent XXIV). Le sens actuel de conséquent (« important », ex. une ville conséquente, une affaire conséquente) s’explique par le fait que cet adjectif représente Une expression plus longue : de conséquence.116
Le participe présent de relation a pour fonction de représenter les relatives qui ont un autre sujet que l’antécédent : un café chantant (Z où l’on chante), un thé dansant (Z où l’on danse). Cf. un quartier commerçant, une rue passante, un parquet glissant, un sol roulant, W. C. payants, etc.
De telles phrases, est-il besoin de le dire, ne sont équivoques qu’à la réflexion ; leur rôle est de représenter des circonstancielles qu’il serait trop long d’énoncer explicitement. D’ailleurs, cette syntaxe rejoint celle en usage autrefois, telle qu’elle s’est conservée dans quelques proverbes : L’appétit vient en mangeant, La fortune vient en dormant.
Nous avons vu ailleurs comment le français avancé se débarrasse, s’il y a lieu, de certaines de ces équivoques (type : Passe le journal pour moi lire).
Mots par initiales. — L’usage d’abréger les syntagmes en les représentant par les initiales des mots qui les composent, est aujourd’hui très étendu, mais ces créations n’ont le plus souvent qu’un caractère local et éphémère : erpéiste (partisan de la Représentation Proportionnelle) ; le Bite (Bureau International du Travail), etc.
2) Représentation discursive
Par la représentation discursive, un signe plus court ou plus maniable reprend ou anticipe un autre signe qui figure dans la chaîne du discours : Pierre est parti, mais il reviendra, La maison de Jean est plus petite que celle de Pierre.
Au lieu de donner une étude complète de ces anaphoriques — il, elle, ça, le ou pop. y, dont, en, où, etc. — on se contentera de citer deux ou trois faits qui intéressent le français avancé.
Que sert correctement à reprendre certaines conjonctions 119dont la répétition ferait longueur : Si vous travaillez et que quelqu’un vient vous déranger ; Quand on travaille et que quelqu’un vient vous déranger ; Quand je me repose ou que je dors. Cet emploi si commode est étendu à d’autres conjonctions, où il passe pour incorrect : C’est pourquoi…, et que… (Martinon II 402 n).
La langue familière emploie si pour reprendre est-ce que : Est-ce que tu restes ou si tu pars ?
L’emploi de faire comme anaphorique du verbe est classique, mais on ne le tolère pas toujours. « Un des pires abus du verbe faire consiste à l’employer à la place d’un autre verbe » (Albalat, Comment il ne faut pas écrire, 49) : Je le reconnus mieux que je n’avais fait sa femme (A. Hermant). Dans la langue parlée d’aujourd’hui, cet usage se limite à l’emploi de faire avec le. Tandis que la langue écrite tolère un exemple du type : Le pire est que nous ne pouvons soupçonner Joubert d’aucune ironie, comme nous faisons notre bon maître Anatole France (A. Hermant : D’Harvé PM § 795 A), la langue parlée aurait comme nous le faisons de…
Cas limites. — Entre représentations mémorielle et discursive, il n’y a pas toujours de limite nette. Ainsi les prophrases qui servent de réponses (Oui, Non, Volontiers, etc.) supposent la combinaison d’un élément donné dans la question avec un autre élément logé dans la mémoire (affirmation, négation, acquiescement, etc.) : Est-ce que Pierre est rentré ? Oui (Z P. est rentré) ; Non (Z P. n’est pas rentré) ; Voulez-vous du thé ? Volontiers (Z J’en veux bien).
C) Ellipse
Au lieu de représenter l’élément dont on veut faire l’économie, on peut aussi le passer sous silence. C’est ce qu’on appelle communément l’ellipse.
Comme nous l’avons fait pour la représentation, nous distinguerons du point de vue du fonctionnement deux sortes d’ellipses : l’ellipse mémorielle et l’ellipse discursive.
L’ellipse mémorielle consiste à sous-entendre un élément qui doit être suppléé par la mémoire : un documentaire 120(Z un film documentaire), tandis que l’ellipse discursive est l’anticipation ou la reprise d’un élément donné dans le discours : illustrations dans et hors texte (Z dans texte) ; les pommes cueillies et les tombées (Z et les pommes tombées).
Terminologie. — La terminologie grammaticale n’est pas fixée. Tandis que M. Nyrop (V § 14 sv) appelle l’ellipse mémorielle ellipse proprement dite, M. Bally (Copule zéro) voudrait réserver le terme d’ellipse à la seule ellipse du discours. — Nous nous conformerons à l’usage le plus communément reçu en gardant le mot d’ellipse comme terme générique, pour désigner le phénomène dans son ensemble. On peut réserver le terme de sous-entente à l’ellipse mémorielle et celui d’haplologie (non répétition) à l’ellipse discursive.
1) Ellipse mémorielle
Selon que l’élément ellipse est grammatical ou seulement phonique, c.à.d. selon qu’il est porteur ou non d’une signification immédiate, nous parlerons de sous-entente ou d’amuissement. En principe, il n’y a pas de fossé entre ces deux procédés, qui se laissent rattacher au même besoin.
a) Sous-entente.
On distingue généralement la sous-entente du déterminé, celle du déterminant et celle du signe de rapport chargé de relier le déterminé et le déterminant. Il est difficile de dire dans chaque cas pourquoi c’est l’une ou l’autre de ces trois possibilités qui l’emporte ; tout au plus peut-on supposer à première vue que la sous-entente du déterminé (sujet, etc.) et celle du signe de rapport (verbe transitif, copule, préposition, conjonction) sont plus fréquentes que celle du déterminant. « Le langage est presque toujours très elliptique : ce qui est sous-entendu, ce n’est pas l’accessoire et l’accidentel [prédicat, déterminant], qui ne se laisseraient pas deviner ; mais ce qui est si essentiel qu’on ne manquera pas de le suppléer [sujet, déterminé, signe de rapport] ». (Goblot § 96).
La liste ci-après énumère les principaux cas de sous-entente que présente le français avancé.121
Sujet :
Regrette, n’ai plus. — Bien fâché, n’y pouvons rien. — Monsieur X ? Connais pas.
Les lettres populaires : Les jours sont durs et voudrais bien que…
Voudrais bien de tes nouvelles, suis toujours ici, te prie… Hier sommes allés… Aujourd’hui avons reçu… (= Prein).
Journaux intimes : Aujourd’hui dîné chez X… Rentré tard… etc.
Sujet impersonnel. : Là-bas faut que vous alliez. — Ya un bureau de poste à côté.
Substantif déterminé :
On vous le fournira fin (du mois) courant.
L’épreuve du kilomètre (avec départ) lancé.
Vente pour cas (de force) majeur(e), Départ pour cause d’occupation (par force) majeure (Vittoz 92).
Transit par (chemin de) fer entre la Suisse et les ports français.
Faubourg (Saint)-Antoine (B).
Chaussures extra en (cuir) double veau.
Subordonnante (sujet + signe de rapport) :
Vous avez volé ça : : J’ai volé ça ? (Vous prétendez que, Vous dites que…).
Où veux-tu aller ? : : Où je veux aller ? (Tu demandes où…).
Il est déjà venu ? : : S’il est déjà venu ? (Vous demandes si…).
Que si, Que oui, Que non (Je vous dis que…).
Dans leur maison, pas un seul tapis.
Quand il y a divergence, permis à chacun de faire à sa guise.
Tu iras à tel et tel endroit : : Entendu.
J’essayerai de le faire : : Trop tard maintenant.
Qui, quand, comment, où (c’est) ça ?
Subordonnante dans une circonstancielle :
Donc c’est entendu : si beau je viens, si pluie je reste.
Le cortège aura lieu pluie ou pas pluie.
Besoin ou pas besoin, je te défends de l’acheter.
Son œuvre, commencée alors que jeune étudiant.
Aussitôt que lavé et nourri à l’hôtel, il alla… (Nyrop V § 17).
Bien que déprimées, elles sourirent jusqu’à la fin (ib.).
J’ai acheté ce cheval, quoique un peu cher (ib.).
Celui qui aime les primitifs parce que primitifs (ib.).
Le commandant E., bon catholique, puisque zouave du pape, mais déplorable Français (ib.).
Nous espérons que ces indications vous faciliteront pour faire les recherches, c’est pourquoi aussitôt reçu nous nous empressons de vous les communiquer (APG).
Nous croyons, ainsi que ses camarades le disent, que malgré blessé, il aura pu être fait prisonnier (id.).
La neige fait son apparition sur les montagnes avoisinantes, et dès une couche suffisante, nous pourrons bientôt voir les nombreux fervents des « planches » s’adonner à leur sport favori (Godet c).122
Qui est, etc. :
Par divers renseignements recueillis, j’apprends que tous ceux morts sur le champ de bataille ont pu être enterrés (APG).
Cette revue dépassera en gaîté celle montée à pareille époque l’année dernière ; Ceux donnés par la nature (Joran n° 54).
Paul, (qui est de) retour de Pans, m’a annonce cette nouvelle (Vincent 152-3).
Que (+ régime) :
Tu veux je vienne ? Faut je m’en alle ? Il a dit i viendrait (viendra, veut venir). Je veux pas tous ces types i soyent toujours à me courir (B 142).
Il nous a dit comme blessure il avait reçu une balle dans le dos, traversé sa cartouchière et sorti par devant (APG).
Tu hécrira si tu veux au dépôt pour il manvoi un paquet de fait [= d’effets] de soldat (Prein 76).
Cf. Je languis (d’être) à l’année prochaine (Plud’hun 71).
Préposition d’inhérence (+ prédicatif) :
Une dissolution du Reichstag est considérée impossible par tous les milieux politiques ; M. C. considérerait excessive la réduction projetée du programme naval ; On le considère très habile (Martinon II 497).
Nos prix déjà connus excessivement bas ne seront rien à côté de… (réclame).
L’écueil à éviter, c’est que les personnages inventés par l’auteur n’apparaissent plutôt des représentations d’idées abstraites que des êtres bien vivants.
Préposition :
Le fils Dupont, la fille Durand (Joran n° 134).
Voyez caisse ! Voyez terrasse ! Voyez guichet 5 !
Mallette placage, doublure fantaisie, coloris mode, modèle luxe, cousu main, etc.
Œuf coque, œuf plat, fine Maison (B 167).
La partie texte, fer, maçonnerie, etc.
Le facteur temps, argent, etc.
La question approvisionnement, ravitaillement, etc.
Le trafic marchandises, le mouvement marchandises du PLM, les chiffres de la circulation voyageurs, etc.
Préposition composée > simple :
C’est en face la Sorbonne ; Continental Hôtel, face les Bains.
Le pavillon est placé hors la vue des promeneurs.
Au point de vue enseignement ; Placez-vous au point de vue relief ; Au point de vue formation de l’infanterie (Thérive NL 10. 4. 26).
Rapport à ces nuages-là, il va pleuvoir.
Jusque deux heures, Jusque maintenant, Jusque la Madeleine.
Crainte de vous nuire, qu’on ne vous nuise (Vincent 47-8).
Je vous l’apporte d’ici la semaine prochaine.
Cause départ ; Cause santé (annonces).
On vous le fournira courant avril.
C’est vis-à-vis l’église ; Vis-à-vis la porte de gauche.
Près le pont ; Près la porte Maillot.123
Déterminant :
Rompez ! (les rangs).
Allons, ouvre ! (la porte).
Aujourd’hui, tout le monde veut avoir sa voiture (automobile).
Le garçon n’annonce pas : un café, deux cafés, mais : Versez pour un, pour deux, etc. (B 167). — Versez, au premier !
La copie (ci-)incluse (Martinon II 477 n).
Un essuie(-mains) (B).
Avoir le dernier (mot).
A la première belle (occasion).
b) Amuissement.
Il n’y a pas de fossé véritable entre l’ellipse proprement grammaticale ou sous-entente, dans laquelle le signe passé sous silence est toujours accompagné d’une signification distincte, et l’ellipse phonique ou amuissement. Par ce dernier terme, nous désignons tous les cas d’ellipse mémorielle qui intéressent le signe — phonèmes, syllabes, groupes de syllabes — à l’exclusion de la signification.
2) Ellipse discursive (haplologie)
Pris dans un sens plus large, le terme d’haplologie peut aisément servir à désigner l’ellipse discursive en général, c.à.d. toute non-répétition (h. progressive) ou non-anticipation (h. régressive), en contact ou à distance, sous une forme identique ou approchante, d’un simple phonème, d’une syllabe ou d’un mot.
Cette extension du terme d’haplologie est conforme aux faits. Livrées à elles-mêmes, les langues manifestent une répulsion plus ou moins vive pour la répétition fortuite des phonèmes, des syllabes et des mots ; et cette répulsion est un des cas où l’instinct collectif semble d’accord avec la grammaire impérative : tous les écoliers de France et de Navarre connaissent la règle qui interdit les répétitions de mots. 128Seulement, la tendance spontanée porte sur les phonèmes isolés et les syllabes autant que sur les mots entiers, et en contact comme à distance.
Après avoir énuméré quelques variétés d’haplologie verbale et d’haplologie syllabique, il nous reste à examiner l’haplologie phonique. Entre cette dernière et les autres, il n’y a qu’une question de degré : Qu’est-ce que c’est que ça ? > kèksèksa. > kèsèsa ; Qu’est-ce que ça fait ? > kèksafè > kèsafè.
La même réluctance pour la répétition fortuite explique la suppression d’un grand nombre de liaisons : Un attenta(t) affreux, po(t) à tabac, to(t) ou tard, aussitô(t) après, bientô(t) après, est-ce que vous ire(z) aux eaux, etc. etc. On voit donc que l’haplologie va jusqu’à l’emporter sur la tendance, si forte par ailleurs, à réduire l’hiatus.
La question de l’e muet intervient également ici. On sait le sort que réserve à cet ə le français avancé ; la langue correcte même n’admet pas sa répétition dans une suite de deux ou plusieurs syllabes, et la « loi des trois consonnes » pourrait s’appeler tout aussi bien la « loi des deux voyelles ». 129Exemples : *ça nə mə fait rien, *veux-tu tə ləver, *on sə dəmande, *il restə dəbout, *tu mə rəssembles, *vous rədəvənez jeune, *on mə lə donne, *si jə lə savais. — A plus forte raison, la répétition multipliée de la même voyelle entraîne une bouillie imprononçable : *jə nə mə lə rappelle pas (d’où : je ne m’en rappelle pas), *jə nə tə lə rəfuse pas (d’où pop. je t’y refuse pas), *jə nə tə lə rədəmanderai pas, etc.
Cette tendance brachylogique est si forte qu’elle s’étend même aux cas où il n’y a pas répétition d’un e muet : atlier, dmain, rnoncer (Plud’hun 16), amner, enlver ; lmarchand n’avait pas ça ; du 60 à l’heure qu’i f’saient !
Ce point de phonologie est très important ; le parler populaire amène ainsi le français à connaître des consonnes à fonction vocalique (r l m n voyelles) telles qu’en possède l’allemand et telles qu’elles existaient probablement en indoeuropéen. Le français y avait répugné jusqu’à présent.
Les abréviations sémantiques et formelles étudiées dans ce chapitre montrent que si le français était, sur ce point, livré à lui-même, il ne tarderait pas à devenir une langue monosyllabisante ou monosyllabique du type de l’anglais ou du chinois, avec tous les avantages et inconvénients qui s’y rattachent. Nous avons signalé les multiples dangers d’homophonie qui résultent de la marche vers le monosyllabisme, et nous renvoyons à la loi que nous avions formulée : la différenciation est fonction de la brièveté.130
Chapitre IV Le besoin d’invariabilité
Bally LV 205 sv ; Bull. Soc. Lingu., 23, 119 n.
Bergson, Evolution créatrice, 171 sv.
Nyrop III § 638 sv. (Dérivation impropre).
Sechehaye, Structure logique de la phrase, 102 sv.
Langues où l’invariabilité du signe est particulièrement avancée : l’anglais, et surtout le chinois.
C’est un philosophe, M. Bergson, qui a le mieux aperçu le principe qui constitue le trait essentiel du langage humain, la mobilité du signe :
« Les sociétés d’insectes ont sans doute un langage, et ce langage doit être adapté, comme celui de l’homme, aux nécessités de la vie en commun. Il fait qu’une action commune devient possible. Mais ces nécessités de l’action commune ne sont pas du tout les mêmes pour une fourmilière et pour une société humaine. Dans les sociétés d’insectes, il y a généralement polymorphisme, la division du travail est naturelle, et chaque individu est rivé par sa structure à la fonction qu’il accomplit. En tout cas, ces sociétés reposent sur l’instinct, et par conséquent sur certaines actions ou fabrications qui sont plus ou moins liées à la forme des organes. Si donc les fourmis, par exemple, ont un langage, les signes qui composent ce langage doivent être en nombre bien déterminé, et chacun d’eux rester invariablement attaché, une fois l’espèce constituée, à un certain objet ou à une certaine opération. Le signe est adhérent à la chose signifiée. Au contraire, dans une société humaine, la fabrication et l’action sont de forme variable, et, de plus, chaque individu doit apprendre son rôle, 131n’y étant pas prédestiné par sa structure. Il faut donc un langage qui permette, à tout instant, de passer de ce qu’on sait à ce qu’on ignore. Il faut un langage dont les signes — qui ne peuvent pas être en nombre infini — soient extensibles à une infinité de choses. Cette tendance du signe à se transporter d’un objet à un autre est caractéristique du langage humain. On l’observe chez le petit [172] enfant, du jour où il commence à parler. Tout de suite, et naturellement, il étend le sens des mots qu’il apprend, profitant du rapprochement le plus accidentel ou de la plus lointaine analogie pour détacher et transporter ailleurs le signe qu’on avait attaché devant lui à un objet […]. Ce qui caractérise les signes du langage humain, ce n’est pas tant leur généralité que leur mobilité. Le signe instinctif est un signe adhérent, le signe intelligent est un signe mobile. » (Evolution créatrice, 171-2).
Le même problème peut être posé en d’autres termes. L’opposition bergsonienne du signe adhérent et du signe mobile correspond à l’opposition faite par F. de Saussure entre le symbole et le signe arbitraire (CLG 103) : Le symbole a pour caractère de n’être jamais tout à fait arbitraire ; il y a un rudiment de lien naturel entre le signe et la signification. Autrement dit, le signe adhère à la signification. Le symbole de la justice, la balance, ne pourrait pas être remplacé par n’importe quoi, un char par exemple. — Le signe arbitraire, au contraire, est immotivé, c.à.d. que rien ne le rattache naturellement à la signification (= signe mobile).
Il est aisé de voir pourquoi le signe linguistique est mobile. Logiquement, il faudrait qu’à chaque signe corresponde 1 signification. C’est là le point de vue du signe adhérent ou du symbole, et c’est bien à peu près ce que l’on constate dans les langues dites primitives, qui consacrent un signe spécial à chaque signification particulière mais n’ont pas de termes pour rendre les idées abstraites. Il en résulte une multiplication des signes à l’infini, et un effort de mémoire inouï. Le besoin d’économie pousse le langage à remplacer la multiplicité des signes particuliers par des signes mobiles pouvant traduire tour à tour un grand nombre de significations distinctes. Cette généralisation ne s’arrête pas au signe générique (ex. arbre, maison, véhicule, colis, etc.) ; elle va jusqu’au signe catégoriel (signes désignant le concept de chose, d’être, de qualité, d’action, etc.).132
Dans le camp des logiciens et des psychologues aussi bien que dans celui des linguistes, on a abandonné de plus en plus la croyance au parallélisme psycho-linguistique, pour reconnaître l’alogisme des catégories grammaticales. Les « parties du discours » sont loin d’être un simple décalque des catégories de la pensée ; les correspondances établies entre le Substantif et la « substance », l’Adjectif et la « qualité », l’Adverbe et la « manière », le Verbe et le « procès », la Préposition et la « relation », etc., ne conviennent que trop souvent aux manuels de grammaire et de logique à l’ancienne mode. Un substantif, par exemple, n’est pas rivé à la notion de « substance », il peut supporter une idée de « qualité » (ex. la beauté) ou de procès (la venue) ; un adjectif peut contenir une idée de « substance » (la production livresque de l’Allemagne), un verbe une idée de « qualité » (rougir), etc.
Dès qu’on pénètre dans la réalité du langage vivant pour observer sur le vif le déroulement des phrases dans la parole, on voit bien vite combien est risquée la tentative d’établir un parallélisme rigide entre les cadres de la pensée et les moules de la grammaire. Le besoin de disposer de signes mobiles et maniables tend au contraire à permettre qu’une seule et même catégorie grammaticale supporte tour à tour des valeurs et catégories de pensée différentes.
Le problème de la traduction, dont la théorie pourrait tenir en quelques lignes, montre très bien la différence entre les deux ordres de faits. La traduction « littérale » .consiste à traduire à l’aide des mêmes catégories grammaticales, mais aux dépens de l’identité sémantique ; exemple : zuletzt ging sie nach Hause zurück > finalement elle retourna chez elle. La traduction « libre » cherche à obtenir l’identité sémantique aux dépens de l’identité des catégories grammaticales : elle finit par retourner chez elle.
La croyance au parallélisme psycho-linguistique donne lieu à des erreurs fréquentes ; parce que des signes sont identiques de forme, on croit qu’ils appartiennent nécessairement à la même catégorie. Le mélange du substantif et de l’adjectif en une catégorie unique est un exemple de cette erreur : « Substantifs et adjectifs échangent leurs rôles dans toutes 133les langues ; grammaticalement il n’y a pas entre eux de limite tranchée. On peut les réunir tous deux dans une catégorie unique : celle du nom. » (Vendryes, Langage, 138). Ou bien, parce que dans une langue le pronom possessif est interchangeable avec le pronom personnel (ex. ma venue = je viens), on appellera cette langue une langue à « conjugaison possessive » ; parce que dans une langue le nom est interchangeable avec le verbe (jap. la neige tombe = la chute de la neigé), on appellera cette langue une langue à « conjugaison nominale », etc. etc. Autrement dit, on déduit faussement de l’identité des signes celle des significations, sans se douter que le besoin d’économie n’efface les différences formelles superflues qu’en gardant strictement la différence des fonctions.
Historique. — Le parallélisme psycho-linguistique est soutenu par le logicien Keynes et par l’école de linguistes qui va de Humboldt et Steinthal jusqu’à Wundt et Cassirer. Ont réagi : chez les logiciens, Goblot (§ 96 et passim) ; chez les linguistes : H. Paul, Marty, Jespersen, et l’école de Saussure. Cf. 0. Funke, Studien zur Geschichte der Sprachphilosopie, Bern 1928.
Cette mobilité du signe dépend non seulement de l’arbitraire du signe par rapport à la signification, mais bien plus encore de celui de la signification, c.à.d. de la pensée, par rapport à la réalité pensée. De même que le langage n’est pas un simple décalque de la pensée, notre pensée, elle non plus, n’est pas un simple décalque du donné, c.à.d. des perceptions qui nous viennent du monde extérieur et de nos sensations du monde subjectif (v. Bally LV 148-9 ; Contrainte sociale : Revue Intern. de Soc, 35, 218 sv).
Il est aisé aussi de voir pourquoi la pensée est mobile par rapport à la réalité pensée. Les faits que nous percevons et sentons ne sont toujours que singuliers, individuels, détaillés. Pour les « penser », le besoin d’économie nous pousse à simplifier la multiplicité du perçu, à la classer en un certain nombre de groupes et de sous-groupes. La pensée élabore la variété formidable du donné en y substituant des représentations 134génériques : le concept est une signification générique, c.à.d. une signification interchangeable d’une signification particulière à une autre (le concept « maison », par exemple, peut se substituer à tour de rôle à un nombre énorme de perceptions de maisons singulières, aucune n’étant identique à l’autre ; v. Sapir, Language, II-2).
Le passage de la réalité au langage suppose donc un double décalage, entre la réalité et la pensée d’abord, ensuite entre la pensée et le langage. De ces deux arbitraires, seul le second intéresse directement la linguistique, le premier ressortit à la psychologie.
Nous insistons sur ce dernier point, parce qu’on a cherché à transporter dans le domaine du langage des distinctions qui n’appartiennent ni à la langue ni à la pensée. Ainsi celle proposée par Brentano et Marty entre les prédicats (et les déterminants) qui enrichissent leur sujet (leur déterminé) et ceux qui le modifient (v. Brentano, Psychologie, II 62 n) ; ex. Pierre est savant (enrichissement du sujet) / Pierre est mort (modification du sujet). La pensée et le langage sont indifférents à cette distinction, qui n’appartient qu’à la réalité. « Quand nous disons l’enfant devient homme, gardons-nous de trop approfondir le sens littéral de l’expression. Nous trouverions que, lorsque nous posons le sujet enfant, l’attribut homme ne lui convient pas encore, et que, lorsque nous énonçons l’attribut homme, il ne s’applique déjà plus au sujet enfant. La réalité, qui est la « transition » de l’enfance à l’âge mûr, nous a glissé entre les doigts […] La vérité est que, si le langage [et la pensée] se moulait ici sur le réel, nous ne dirions pas l’enfant devient homme, mais il y a devenir de l’enfant à l’homme. Dans la première proposition, devient est un verbe à sens indéterminé, destiné à masquer l’absurdité où l’on tombe en attribuant l’état homme au sujet enfant. » (Bergson, Evolution créatrice, 338).
Comme nous l’avons indiqué plus haut, le besoin d’économie pousse le langage et la pensée à escamoter tout détaillage superflu, toute distinction qui n’est pas nécessaire à la compréhension. Même pour le professeur qui enseigne dans ses livres et de sa chaire que la terre tourne autour du soleil, 135il est plus commode dans la vie quotidienne de dire et de penser « le soleil se lève, le soleil se couche », etc.
Le défaut de correspondance, dû à la mobilité du signe, entre catégories grammaticales et catégories de pensée a conduit quelques savants à une conclusion que l’on pourrait appeler défaitiste. Puisque les catégories grammaticales ont un caractère aussi nettement trompeur, à quoi bon les étudier et pourquoi ne pas les laisser en dehors même de la recherche scientifique ? « Après épreuve, après des années passées à chercher la solution du problème, j’ai été amené à penser qu’aucune retouche à l’ancien plan ne pouvait suffire, qu’aucun reclassement des phénomènes grammaticaux ne saurait échapper aux défauts inhérents à la classification d’Aristote. Les parties du discours ont fait leur temps. C’est une scolastique qui doit à son tour disparaître. » (Brunot, Revue universitaire, 29, 166 ; v. dans le même sens, Sapir, Language, 125).
Il n’en est pas moins vrai que les catégories grammaticales, loin d’être une invention d’Aristote, sont réellement conçues comme telles par les sujets parlants, en vertu des rapports de forme et de fonction qui servent à classer les signes entre eux dans la mémoire et dans le discours.
La sociologie livre ici un parallèle frappant. Le cas du linguiste qui voudrait étudier le langage sans tenir compte des institutions grammaticales ressemble à celui du sociologue qui ferait fi des institutions de la société — Etat, Administration, Parlement, Partis, Armée, Droit, Mariage, Eglise, etc. etc. — sous prétexte que ce sont là des cadres imparfaits et trompeurs (ce qu’ils sont en effet).
Or cette mobilité du signe, cette faculté de pouvoir être transposé d’une valeur sémantique ou d’une catégorie grammaticale à l’autre, au lieu de faire le désespoir du linguiste, sont précisément ce qui devrait l’intéresser le plus. « Si la langue fait passer si aisément les signes d’une catégorie dans une autre, c’est par un ensemble de procédés transpositifs qu’elle met au service de la parole, et qui prouvent par contrecoup la réalité des catégories entre lesquelles se fait le passage. 136Mais la transposition n’a jamais été l’objet d’une étude méthodique [v. aujourd’hui Sechehaye, Structure logique de la phrase, 102 sv] ; elle plonge pourtant très avant dans le mécanisme de la langue, et souvent la manière dont un idiome opère ces échanges fonctionnels suffit à le caractériser. » (Bally, Bull. Soc. Lingu., 23, 119 n).
L’arbitraire du signe, et la mobilité qu’il permet, étant admis en principe, il faut bien reconnaître qu’en pratique cette mobilité est chose toute relative. La faculté de transposer un signe d’une valeur sémantique ou d’une catégorie grammaticale à l’autre peut être plus ou moins aisée ou difficile selon le degré d’invariabilité du signe
La variabilité du signe apparaît sous des formes très diverses. La variation peut être régulière ; ainsi le radical des verbes de la 2e conjugaison est variable, mais il se modifie en vertu d’une alternance régulière qui vaut pour l’ensemble des verbes de cette conjugaison (je fini-s / nous finiss-ons, etc.). La variation peut être partiellement ou totalement irrégulière ; dans ce dernier cas, on parlera de supplétion (ex. je vais, tu vas, nous all-ons, j’i-rai). La séquence peut être également variable ou invariable ; le dérivé compte-rendu jure avec le verbe composé dont il est tiré (rendre compte).
Le même problème peut se poser sur le plan du discours. Les diverses significations n’ont pas toujours une expression distincte, mais peuvent être exprimées cumulativement, pléonastiquement ou discontinûment. Leur, du, au, dont, etc., sont des signes mixtes cumulant deux ou plusieurs fonctions (leur « à eux », du « de le », au « à le », dont « que de lui », etc.), l’accord oblige au contraire à exprimer plusieurs fois ce qui n’est pensé qu’une fois (belle petite chatte blanche), et la discontinuité détruit la succession logique des éléments : les langues slaves de civilisation.
Le fait que le signe est obligé, en vertu des rapports qui le lient à d’autres signes logés dans la mémoire ou dans le discours, de changer constamment de forme, nécessite de la part des sujets parlants et entendants un effort supplémentaire 137de mémoire et d’attention. Le besoin d’invariabilité, un des plus impérieux du langage, tend à toujours conserver à un signe, en dépit des rapports mémoriels et discursifs qu’il soutient avec le reste du système, la même forme afin d’alléger autant que possible l’effort de mémoire et d’attention à fournir. Le moindre effort de mémoire est la raison d’être du signe mobile et invariable.
La marche des langues de grande communication vers l’invariabilité de plus en plus forte des pièces du système a été soulignée par divers auteurs. M. Bally a signalé et esquissé le problème en se plaçant au point de vue de la transposition, et a consacré quelques pages à montrer « l’interchangeabilité toujours plus aisée des fonctions avec un minimum de changement des signes ; les mots, parties de mots, membres de phrases et phrases entières qui sont appelés à d’autres fonctions que celle qui leur est habituelle, assument leur nouveau rôle sans modifier leur forme, ou en la modifiant très peu. Le phénomène se vérifie, par exemple, lorsqu’un verbe peut être indifféremment transitif ou intransitif (cf. anglais he stops a watch et the watch stops), quand un verbe devient, dans les mêmes conditions, un substantif (to stop, a stop) ou un élément de composé (a stop watch). Il suffit de comparer des passages semblables en grec et en latin pour voir que dans ces langues la transposition est fortement caractérisée, et par conséquent plus difficile (grec γαμέο « épouser » et γαμίζω « faire épouser », ἵππος, τρέφω et ἱπποτρόφος « qui nourrit des chevaux », etc.). Même constatation dans le régime de la phrase : c’est par des modifications toujours plus légères qu’une proposition indépendante peut devenir terme d’une phrase, ou phrase subordonnée (cf. d’une part latin erras et puto te errare, d’autre part anglais You are wrong et I think you are wrong). » (Bally LV 205-6).
Nous étudierons dans ce chapitre comment le besoin d’invariabilité, en réduisant les modifications formelles à un minimum, cherche à rendre la transposition linguistique 138aussi aisée que possible. Nous distinguerons trois types de transposition : la transposition sémantique, la transposition syntagmatique et la transposition phonique.
La transposition sémantique est le passage d’une valeur sémantique à l’autre. Par exemple, le passage d’une personne à l’autre (je/tu/il ; moi/toi/lui) est une transposition sémantique ; de même, le passage d’un nombre à l’autre (je/nous ; tu/vous ; il/ils).
La transposition syntagmatique est le passage d’une catégorie syntagmatique à l’autre. Par exemple, le passage du sujet à l’objet (je/me ; tu/le ; il/le ; ils/les) est une transposition syntagmatique ; de même, le passage de la syntagmatique libre (syntaxe) à la syntagmatique plus ou moins condensée (morphologie), par exemple la transformation d’un prédicat en un déterminant (la maison est à moi > ma maison) ou celle d’une phrase en un substantif abstrait (la rosé est belle > la beauté de la rosé), et ainsi de suite.
La transposition phonique est le passage d’une sous-unité à une unité, et inversement. Ainsi je et moi, tu et toi, il et lui, ils et eux, ne sont pas interchangeables ; nous, vous, elle, au contraire sont invariables à ce point de vue : ils peuvent fonctionner tantôt comme sous-unités (nous-allons, vous-allez, elles-vont) tantôt comme unités (nous, nous-allons ; vous, vous-allez ; elles, elles-vont).
Nous étudierons donc successivement : les transpositions sémantiques, abstraction faite de toute transposition syntagmatique ou phonique ; les transpositions syntagmatiques, abstraction faite de toute transposition sémantique ou phonique ; les transpositions phoniques, abstraction faite de toute transposition sémantique ou syntagmatique — en examinant chaque fois comment le besoin d’invariabilité cherche à rendre le passage aussi aisé que possible.
A) Transposition sémantique
La langue familière et la langue populaire aiment à se servir d’expressions vagues, dès que la compréhension n’exige pas de termes plus précis ; elles se dispensent de marquer par des termes spéciaux toutes les différences de signification. Il 139suffit, pour se rendre compte de ce fait, de comparer le vocabulaire journalier avec la terminologie technique et scientifique. Les langues spéciales tendent à restreindre l’extension sémantique des signes qu’elles emploient, les langues de grande communication tendent à la généraliser. Cette généralisation du signe comporte diverses variétés, telles que le signe générique, le signe indifférent, la figure effacée, la fausse figure.
Le signe générique — appelé aussi signe passe-partout ou signe à tout faire, par exemple homme, chose, faire, etc. — est un signe interchangeable d’une signification particulière à l’autre à l’intérieur d’une catégorie grammaticale donnée. Un mot comme véhicule peut fonctionner tour à tour à la place de char, voiture, camion, roulotte, auto, wagon, etc. ; le colis désignera selon l’occurence un paquet, une caisse, un panier, une valise, un ballot, et ainsi de suite. Parallèlement, dans le domaine du verbe la copule (par exemple être, avoir, devenir, faire) n’est pas autre chose qu’un verbe transitif générique.
Les grammairiens qui opèrent avec des jugements de valeur appellent le signe générique un terme « vague » et parlent de « confusions », d’« ignorance », etc. Comme nous l’avons signalé dans l’Introduction déjà pour la notion de l’oubli, le vague, la confusion et l’ignorance peuvent avoir leur raison d’être ; elles servent inconsciemment le besoin d’invariabilité. La fonction économique du signe générique est évidente : il dispense la mémoire de retenir une foule de signes particuliers dont l’emploi serait superflu, et forme ainsi la contre-partie, dans le domaine des associations de mémoire, de ce que nous avons appelé la brièveté sémantique.
Les signes indifférents (dans le jargon : voces mediæ) réalisent l’interchangeabilité des contraires, en permettant de faire l’économie des antonymes. Ainsi sentir est un verbe indifférent, parce qu’il permet de marquer aussi bien un procès qui part du sujet qu’un procès qui va vers lui : Tu sens comme ça sent ? Beaucoup de mots peuvent être pris indifféremment en bonne ou en mauvaise part (fr. av. grâce à cet échec, commettre un acte héroïque, jouir d’une mauvaise réputation, risquer de réussir, etc.) ; v. Nyrop, IV § 199 sv.140
La transposition sémantique ne doit pas être confondue avec la figure. Cette dernière, dont il sera reparlé, est un procédé expressif obtenu par l’association voulue de deux valeurs, la valeur première (ou sens propre) et la dérivée (ou sens figuré) ; la transposition sémantique pure postule au contraire l’oubli ou le refoulement du sens premier. Commettre des vers est une figure plaisante, dont l’expressivité repose sur le rappel de la valeur proprement péjorative du verbe commettre (commettre un crime, un pécher) ; commettre un acte héroïque est une simple transposition, rendue possible par l’oubli du sens premier.
On voit bien par là comment le point de vue descriptif (statique ou historique) et le point de vue fonctionnel diffèrent. Le premier se contente de signaler des « extensions de sens » et les conditions où elles se produisent. Le second va plus loin ; il considère ces extensions sémantiques comme des procédés dont il s’agit de rechercher la ou les fonctions. La transposition sémantique a pour fonction de faciliter l’effort de mémoire à fournir ; la figure, de satisfaire le besoin d’expressivité.
Cette distinction établie, il faut avouer qu’en pratique il peut être difficile de savoir si l’on se trouve en présence d’une transposition pure ou d’une figure. Il importe cependant de bien les délimiter, au moins en théorie.
Et d’abord, au point de vue évolutif, il y a souvent passage de l’une à l’autre, dans ce sens qu’une figure qui a commencé par répondre au besoin d’expressivité peut s’effacer, changer de fonction et verser finalement dans le domaine de la simple transposition. Le cas est banal ; il n’est plus question de métaphore, quand on parle du pied d’une table, ou d’une feuille de papier.
Les valeurs sémantiques que le langage est appelé à exprimer se classent en un certain nombre de catégories fondamentales dont la liste est difficile à dresser. Le lecteur ne trouvera pas, dans les rubriques rangées ci-après, une Table des Valeurs complète et détaillée. On se contentera de quelques points de vue, d’après les matériaux qu’offre le français avancé.
1) La substance et ses déterminations
Un substantif peut accroître ainsi le nombre de ses emplois jusqu’à devenir un signe générique. « J’écoute parfois une jeune personne qui gagne sa vie en cousant. Tout en cousant, elle parle, mais elle n’invente pas de mots ; au contraire, elle les supprime presque tous. Un seul vocable lui suffit à désigner cent objets. Elle dit : chose, machin, truc, et 142ces mots représentent presque toute la nature, telle du moins qu’elle l’aperçoit de ses yeux… Un jour, quelqu’un lui riposta : Mais quelle chose, quel machin, quel truc ? — Eh bien quoi ! dit la midinette agacée, vous ne comprenez donc pas le français ? Et cette jeune fille prenait sincèrement en pitié l’interlocuteur qui avait besoin d’un mot pour désigner chaque chose et chaque machin. » (J. Lefranc, Tribune de Genève, 28. 9. 26). D’autres mots, comme fourbi, bricole, etc., remplissent la même fonction.
On remarquera que les pronoms sont tous des signes génériques ; leur fonction est non seulement de remplacer un signe long par un signe plus court (économie discursive), mais encore de pouvoir se substituer à n’importe quel signe à l’intérieur d’une catégorie donnée (économie mémorielle). Dans bien des cas d’ailleurs, le signe générique fonctionne comme pronom ; ainsi ce qui est remplacé par chose qui : II n’a pas réussi, chose qui m’étonne beaucoup.
Il est intéressant d’examiner comment le français avancé cherche à supprimer les barrières formelles qui séparent les déterminations inhérentes à la substance.
La différenciation des êtres animés et des choses inanimées, qui a joué un grand rôle dans le passé des langues indoeuropéennes, semble perdre de son importance peu à peu. Le neutre, signe de l’inanimé (opposé à l’animé : masculin ou féminin), a disparu des langues les plus évoluées ; le français ne le conserve guère qu’à l’état de survivance (cf. pis, opposé à pire ; ceci et cela, opposés à celui-ci/celui-là et celle-ci/celle-là ; quoi, opposé à qui ; quelque chose opposé à quelqu’un, etc.).
Dans la langue familière, le générique chose est employé comme nominal pour désigner une personne déterminée, et s’oppose donc à quelqu’un : C’est Chose qui a sonné.
Le genre masculin ou féminin, en tant que répondant à une différence de sexe, est trop important pour être escamoté. Même les langues qui n’ont ni masculin ni féminin, comme le chinois et le japonais, et celles qui ont perdu le genre, comme l’anglais, disposent de procédés spéciaux pour marquer la différence. Le français actuel, il est vrai, présente des cas où la différence de genre est supprimée par nécessité — un professeur, un écrivain, un maître de conférences, un docteur, un auteur, etc. en parlant de femmes — mais ces exemples constituent plutôt une gêne.
La différence entre les trois personnes (je, tu, lui) n’est pas marquée formellement par toutes les langues ; le chinois et le japonais notamment, sauf en cas d’emphase, laissent toujours à la situation ou au contexte le soin de déterminer la personne. Les langues indo-européennes n’en sont pas encore là ; on y remarque toutefois la tendance à se passer de l’expression précise de la personne lorsqu’elle est superflue.
En français, on « remplace très fréquemment tous les autres pronoms, même dans la langue parlée. C’est ainsi qu’on dit volontiers on pensera à vous pour je penserai à vous, qu’on s’en aille pour va-t-en ou allez-vous-en, on m’a vu pour il ou elle m’a vu ou ils ou elles m’ont vu, où va-t-on pour allons-nous, etc. » (Martinon II 258). Le grammairien hollandais 146Robert (104-15) a réuni une riche collection d’exemples de cette tendance de on à servir de pronom personnel mobile.
Le grand avantage de ce on mobile est de réaliser, outre l’interchangeabilité des personnes, celle des genres et des nombres. Il remplit d’autres fonctions encore ; il évite par exemple la répétition fortuite des mêmes syllabes : nous, nous nous amusons > nous on s’amuse. Et surtout, il permet de faire l’économie de la terminaison verbale : nous nous amusons > on s’amuse.
Les formes du singulier sont plus rares, mais elles existent : Je s‘arrête, je s‘en fous, tu se feras bousiller (B III-2), Je s‘ai trompé, tu s‘en vas, je se fous de tout ça (B 133).
On peut ramener au même besoin la tendance à invariabiliser le pronom possessif (il leur est défendu de donner de ses nouvelles : APG), ainsi que le possessif nominalisé (c’est une bien grande peine pour nous d’être sans nouvelles des siens : id.).
2) Espace et temps
Il arrive souvent qu’un même signe puisse s’appliquer tour à tour à une notion d’espace ou de temps.
Une préposition spatiale, par exemple, est étendue au temps : aux environs de Pâques, de 8 heures ; d’ici là « jusqu’alors » ; je vois ça d’ici « d’avance », etc.
Ce classement est général et abstrait ; nous n’indiquons ci-dessous que quelques-uns des faits qui s’y rapportent.
Le français est très pauvre en matière de démonstratifs, et les traducteurs sont obligés de rendre indirectement des nuances comme hic, iste, ille, is. Il ne connaît plus que deux séries, la série en -i (ici, voici, ceci, celui-ci, cette maison-ci) et celle en -à (là, voilà, cela, celui-là, cette maison-là). Le français avancé semble devoir éliminer peu à peu la série 148en -i, mais sans pour cela abandonner la différence, qui est exprimée dès lors par la situation (gestes, etc.) ou le contexte : Laquelle vous voulez ? celle-là ou celle-là ? Cf. Voilà ce que j’avais à vous dire, Voilà ce que j’ai à vous dire. Ici tend à se faire remplacer par là, et là (sens premier) par là-bas (ici/là > là/là-bas).
Dans l’histoire des langues, les signes qui marquent le lieu (verbes locatifs, prépositions locatives) et ceux qui marquent le mouvement (verbes directifs, prépositions directives) s’échangent fréquemment. En général, c’est le sens locatif qui est étendu au directif.
3) Quantité et qualité
La distinction formelle du singulier et du pluriel n’appartient pas à toutes les langues ; beaucoup — par exemple le chinois et le japonais — s’en passent aisément, laissant à la situation ou au contexte le soin de déterminer la différence.150
La différence traditionnelle que fait la langue entre objets « comptables » (ex. 30 personnes) ou non (ex. un certain nombre de gens) se trouve quelquefois effacée formellement : Il faut avoir pitié des personnes, Il ne faut pas médire des personnes (Martinon II 20).
De même, la différence entre le singulier et le collectif n’est pas toujours rendue formellement : Manger un raisin (« une grappe ») ; Quand la feuille vient, quand vous voyez la feuille (« le feuillage, la verdure »).
Même échange entre la manière, ou qualité d’un procès, et le temps : Les tombes trop vite creusées de nos soldats (Godet XIII), Je suis venu trop vite (id. XIV), Elle s’est mariée trop vite (ib.).151
Enfin, les diverses catégories de la qualité sont échangeables, dans ce sens qu’un signe qui s’applique à tel ou tel aspect de la qualité est étendu à d’autres cas : Un enfant plus vieux qu’un autre (Martinon II 585) ; Elle est petite « mince » (B) ; et ainsi de suite.
4) Transitivité : inhérence et relation
L’inhérence est un rapport de transitivité intrinsèque, par exemple entre une substance et sa qualité (une rosé jolie), un procès et sa manière (il chante joliment), une substance et une substance dans l’état (Pierre est avocat) ou dans le temps (l’enfant devient homme). La relation est un rapport de transitivité extrinsèque entre deux substances, qui sont conçues par conséquent comme extérieures l’une à l’autre : Pierre frappe Paul, la maison du jardinier, etc. Cf. Sechehaye, Structure logique de la phrase, 54 sv, 66 sv.
L’inhérence et la relation, qui sont des catégories sémantiques, ne doivent pas être confondues avec les procédés grammaticaux de l’accord et de la rection, bien que dans un très grand nombre de cas ces deux couples soient synonymes. Dans le tour une boucherie chevaline, l’adjectif est accordé (procédé grammatical), mais le rapport sémantique est un rapport de relation (boucherie où l’on vend du cheval).
Il va sans dire que, comme la transposition peut se déployer dans plusieurs directions, ce qui est invariabilité dans un sens peut être variabilité dans l’autre. Ainsi la transposition sémantique d’un adjectif d’inhérence en un adjectif de relation peut être un déficit pour la transposition syntagmatique : il devient d’autant plus difficile de passer de la syntagmatique libre (syntaxe) à la syntagmatique condensée (il est prisonnier en Allemagne / prisonnier allemand).
Un autre cas d’interchangeabilité entre inhérence et relation est constitué par le passage de la préposition d’inhérence comme dans le domaine de la relation : Cet article est mauvais comme style ; Je vais bien comme santé et comme position (Martinon II 497 n).
5) Corrélation
La relation, qui est le rapport entre deux substances conçues comme extérieures l’une à l’autre, ne doit pas être confondue avec la corrélation. Cette dernière se développe 153toujours, directement ou indirectement, entre deux jugements.
Les rapports entre jugements peuvent être très variés. Des idées comme parce que, puisque, pour que, au point que, etc., trouvent leur expression dans la plupart des langues, et là encore le besoin d’invariabilité cherchera à rendre ces rapports à l’aide de procédés aussi simples que possible. Un même terme, par exemple, servira à l’expression de la causalité et de la finalité (J’espère que vos recherches ont eu un but « un résultat » : APG), et ainsi de suite.
Plus généralement la langue parlée, dans tous les idiomes, tend à exprimer la corrélation par la juxtaposition pure et simple des phrases, laissant au contexte et à la situation 154(gestes, mimique) le soin de faire les distinctions utiles : Il est venu (,) j’étais malade ; Je parlais (,) il n’avait pas fini ; Dépêche-toi (,) ça presse ; Elle est vilaine (,) ça fait honte. Ce procédé atteint son plus haut degré dans une langue comme le chinois parlé, où une suite de quelques mots, par exemple tʿā laî wò kʿiü (lui venir moi partir), peut traduire les corrélations les plus diverses : S’il vient, je pars ; Je partirai quand il viendra ; Il vient ou je pars ; Il vient et je pars, etc.
Parmi les divers cas de corrélation, le rapport de comparaison mérite d’être examiné à part. La comparaison n’est pas une simple relation entre substances ; on peut comparer des qualités (Elle est plus grande que lui) et des manières (Elle joue mieux que lui). En réalité ce rapport, malgré la forme plus ou moins condensée que le langage en donne, est toujours contracté entre des jugements.
La comparaison peut aussi porter sur les jugements de nombre (ordinalité) et de temps (temps relatifs).
L’ordinalité n’est autre chose que la numération comparée. Tandis que un homme, deux hommes, trois hommes, etc., répondent à de simples jugements de nombre, le premier, le deuxième, le troisième, etc., supposent la comparaison de tels jugements.
En face de la série compacte des ordinaux en -ième, premier et second sont irréguliers : un/premier, deux/second. Le français avancé abandonne second au profit de deuxième ; dans la mesure où second continue à exister, l’ancienne différence second « de deux seulement » / deuxième « de plusieurs » disparaît et fait place à une nouvelle : second « import relevé »/ deuxième « import commun ». Premier est remplacé par unième (le unième, la unième : B).
En outre, le substantif numéro peut fonctionner comme signe de l’ordinalité : le numéro un « le premier », la ligne numéro cinq « la cinquième ligne », et réalise ainsi avantageusement l’interchangeabilité entre le signe notionnel (substantif numéro) et le signe catégoriel (préformante numéro).
Enfin, l’ellipse permet d’atteindre l’interchangeabilité complète entre cardinal et ordinal : le un « le premier », le deux « le deuxième », le trois, etc.
On peut distinguer les mêmes trois traitements quand il s’agit de transformer l’interrogatif combien en un ordinal : 1. ça fait la combientième tourte qui vient nous barber ? (B 98) ; 2. le numéro combien ? ; 3. on est le combien aujourd’hui ? le combien es-tu ? la combien es-tu ? (Martinon II 503).
La comparaison des temps peut se marquer soit par des adverbes (avant / en même temps / après) ou des conjonctions (avant que, etc.), soit par des temps relatifs, marquant l’antériorité, la simultanéité ou la postériorité.
6) Modalité
La modalité est l’attitude adoptée par le sujet à l’égard de l’énoncé. On peut distinguer une modalité plus ou moins intellectuelle, par exemple l’affirmation et la négation, ou la détermination et l’indétermination, et une modalité plus ou moins affective : l’interrogation, l’ordre (impératif, vocatif), l’évaluation (péjoratif / laudatif), etc.
Comme pour la comparaison, le français présente des cas de supplétion entre affirmation et négation : bon/mauvais, joli/vilain, une fois/jamais, quelqu’un/personne, cher/bon marché, pareil/différent, etc. Le français avancé transforme ces couples en oppositions régulières : mauvais > pas bon, vilain > pas joli, jamais > pas une fois, personne > pas un, différent > pas pareil, etc. Le même passage se remarque pour les verbes : savoir / ignorer > ne pas savoir.
Dans la langue parlée, la phrase interrogative semble aujourd’hui, de par le pullulement des formes concurrentes, extraordinairement compliquée : Qui est-ce qui est venu ? Qui c’est qui est venu ? Qui c’est-i qui est venu ? Qui que c’est qui est venu ? etc. Si la phrase interrogative traverse une crise, tout ce désarroi s’explique cependant par les essais multiples que tente le langage avancé pour supprimer l’inversion, c.à.d. pour obtenir la même séquence que dans la phrase affirmative (affirmative = interrogative).
Ce type d’interrogation est le plus avancé de tous, mais en général il frappe peu, et de fait grammairiens et linguistes n’en parlent guère (v. M. Boulenger, Figaro, 7. 7. 28). Les évolutions les plus profondes se consomment parfois sans révolution apparente.
Si l’on fait abstraction de l’élément non-articulatoire, il suffit d’ailleurs de l’intonation pour obtenir l’interchangeabilité 159complète entre affirmation et négation : Elle vient = Elle vient ? La langue parlée possède aujourd’hui des signes qui peuvent être, selon l’intonation, affirmatifs ou interrogatifs (Parce que = Parce que ? ; A cause de = A cause ? ; Comme ça — Comme ça ? ; Ainsi = Ainsi ?), et qui remplacent heureusement l’ancien type supplétif : Parce que / Pourquoi ? ; A cause de / Pourquoi ?
On peut appliquer aux sujets qui parlent et écrivent le français avancé — en somme à chacun de nous lorsqu’il ne se surveille pas — ce passage d’un grammairien concernant le langage écolier : « Ecoutez-le parler et dressez l’inventaire de tous les mots qu’il emploie. A peine atteindrez-vous à un total de deux cents. Ce lexique rudimentaire lui suffit à la rigueur pour se faire comprendre, pour exprimer en gros toutes ses idées. A chaque moment reviennent sur ses lèvres ou même sous sa plume les termes les plus incolores et les 160plus vagues, être, avoir, faire, dire, mettre, pouvoir, vouloir, chose, homme, gens, ceci, cela, qui, que, quand, beaucoup, très, fort, toujours, souvent, tout à fait, etc. » (Legrand, Stylistique Française, V).
En résumé, le besoin d’invariabilité, en cherchant à faciliter la transposition des signes d’une valeur sémantique à l’autre, diminue le nombre des signes existants et travaille donc pour la « pauvreté du vocabulaire ». L’idéal de l’économie linguistique est en effet de restreindre le nombre des formes et en même temps d’accroître leur sphère d’emploi. Inversement, le besoin de différenciation cherche sans cesse à augmenter le nombre des formes existantes et à spécialiser leur usage. Ainsi, la pauvreté ou la richesse du vocabulaire ne font que refléter l’antinomie de deux besoins fondamentaux : le besoin de différenciation et le besoin d’invariabilité (économie mémorielle). Selon la langue considérée, selon le compartiment de la grammaire qui est envisagé, selon l’étage social, c’est l’un ou l’autre de ces deux besoins qui l’emportera.
B) Transposition syntagmatique
Tout syntagme suppose un rapport de transitivité, c.à.d. un terme déterminé et un terme déterminant reliés par un signe de rapport (explicite ou non). Qu’il s’agisse de linguistique statique ou de linguistique évolutive, la base de toute syntagmatique est la phrase, c.à.d. le rapport sujet (déterminé) + verbe (signe de rapport) + prédicat (déterminant). Les autres syntagmes dérivent, statiquement aussi bien qu’historiquement, de ce rapport primaire, par tout un jeu de transpositions que nous allons étudier.
1) Prédication (la phrase indépendante)
La fonction primaire du verbe est de servir de signe de rapport entre le sujet et le prédicat. Mais en dehors de ce rôle transitif, le verbe peut assumer d’autres fonctions encore : celle de prédicat, exprimée par le radical (ex. domus 161uac-at « la maison est vide ») ; celle de sujet, exprimée dans la terminaison (ex. uaca-t « elle est vide »).
Le besoin d’invariabilité exige : 1. que ces divers éléments soient exprimés distinctement et non en cumul ; 2. qu’ils soient invariables les uns à l’égard des autres ; 3. qu’ils se suivent dans un ordre constant et qui réponde à celui des significations.
a) Le sujet.
L’évolution des langues indo-européennes de l’antiquité à nos jours, est marquée par le passage graduel de la séquence régressive (prédicat + verbe + sujet) à la séquence progressive (sujet + verbe + prédicat). Le verbe latin, par exemple, où la personne, c.à.d. le sujet, est représentée par la terminaison, appartient au type régressif : canta-t « chante-il », qui répond à son tour à la phrase régressive : Canta(t) Petrus.
Le passage à la séquence progressive dans le régime de la phrase (Cantat Petrus → Pierre chante), a entraîné le même renversement dans l’ordre des éléments de la molécule : cant-o → je-chante, canta-t → il-chante, etc. Et la précession du sujet dans la molécule verbale (je-chante, tu-chantes, il-chante, etc.) provoque par ricochet l’élimination des terminaisons personnelles du verbe ; ces terminaisons, là où elles existent encore, sont en effet contraires à l’ordre progressif des éléments de la phrase : le besoin d’invariabilité exige que la séquence reste la même dans la phrase (Pierre chante) et dans la molécule (il-chante).
Cette élimination des anciennes terminaisons personnelles du verbe, désormais inutiles et irrégulières, s’opère par amuïssement (ex. nous, nous chantons > nous, on chante) ou par figement. Les deux phénomènes sont plus ou moins solidaires ; les terminaisons verbales se conservent à la faveur de la tradition, c.à.d. de la force d’inertie du matériel linguistique existant, mais le fait qu’elles ne sont plus « pensées » les transforme en poids mort et favorise souvent leur chute.
b) Le prédicat.
Accord et invariabilité répondent à des principes contraires ; le besoin d’invariabilité exige que le prédicat reste invariable par rapport au sujet.
Dans la phrase, le français ne fait pas de différence formelle entre le sujet et l’objet (prédicat de relation) : Pierre me voit = Je vois Pierre ; la langue moderne ne connaît donc plus de cas-sujet et de cas-régime morphologiques. Mais il n’en est pas de même pour la molécule : Il me voit / je le vois ; je le vois / il me voit. A l’exception de nous et de vous, qui peuvent servir indifféremment comme sujets ou objets, les pronoms personnels sont rigoureusement distingués par la forme : je/me, tu/le, il/le, ils/les. Dans ce domaine l’évolution est particulièrement lente, et l’exemple suivant n’est peut-être que dialectal : Vous mavé parlé de Pheulipp mais je vous dit ci vous chicanne de tros vous navé que lui envoyé promené (Bret. : Prein 69).
On trouve aussi : Il lui zy donne, Il leur zy donne, Faites-moi zy savoir, etc. Mais la solution radicale est : Il lui donne ça, Il leur donne ça, Faites-moi savoir ça, Lui dites pas ça !, etc.
c) Tendance au verbe à radical invariable.
Dans tous les verbes français irréguliers et dans tous les verbes autres que ceux de la première conjugaison, le radical est obligé de varier en fonction des déterminations de personne, de nombre, de temps et de mode qui l’accompagnent : nous faisons / vous faites ; il vient / ils viennent ; elle coud / elle cousait / elle coudra ; il peut / qu’il puisse. Aussi a-t-on proposé de distinguer entre la conjugaison vivante, formée par les verbes de la première conjugaison, et la conjugaison morte, comprenant tous les autres ; mais il ne faut pas être trop absolu, car seuls les syntagmes que la conscience linguistique ne reconnaît plus ou ne sait plus analyser peuvent être dits morts : souloir, tistre, issir sont des verbes morts.
La variabilité du radical comporte des degrés. Dans les verbes de la 2e, de la 3e et de la 4e conjugaison, les formes du radical sont variables, mais prévisibles ; ainsi nous finissons entraîne tu finis, que vous finissiez, etc., autrement dit les correspondances traditionnelles et conventionnelles permettent de dérouler sûrement toute la conjugaison, même si tel verbe en -ir n’a jamais été appris par un sujet parlant. La régularité des formules favorise donc l’effort de mémoire à fournir pour retrouver les diverses formes. C’est ce qui fait que ces verbes, malgré leur productivité réduite, résistent mieux que les irréguliers à l’action du besoin d’invariabilité.
Il n’est pas exagéré de prétendre que la grande majorité des fautes de conjugaison est dictée par le besoin d’unifier le radical du verbe ; il faut que ce dernier reste inchangé en dépit de toutes les déterminations de personne, de nombre, de temps et de mode qui l’atteignent. Cela revient à dire que le français tend à ramener tous ses verbes à la première conjugaison.167
Une étude complète des unifications analogiques à l’aide desquelles le français avancé cherche à réaliser l’invariabilité du radical — effort qui se poursuit depuis des siècles — dépasserait les dimensions d’un simple paragraphe. Mais le lecteur saura ajouter de son gré à nos cadres une multitude d’exemples.
La grammaire traditionnelle distingue un certain nombre de « temps primitifs » à partir desquels les formes de la conjugaison se groupent en séries de formes prévisibles. Ainsi l’Indicatif présent servirait de point de départ à l’imparfait, au subjonctif présent, à l’impératif, et au participe présent (j’aime : j’aim-ais, que j’aime, aime !, aim-ant) ; l’Infinitif commanderait le futur et le conditionnel (aimer : j’aimer-ai, j’aimer-ais) ; le Passé simple formerait le subjonctif imparfait (j’aimai : que j’aima-sse) et le Participe passé les temps composés.
Or, toutes les fautes de conjugaison semblent se laisser ramener à ceci : le français moderne tend à ne plus reconnaître qu’un seul radical invariable comme base sur laquelle viennent se greffer directement tous les temps. Quelle est cette base ? Là où le verbe appartient à la première conjugaison, le radical ressort de la simple comparaison des formes, de sorte qu’il n’est dès lors plus possible de parler d’un thème donné, par exemple l’indicatif présent, ou le participe présent, ou l’infinitif, dont seraient tirées les autres formes.
Mais il n’en va pas de même lorsque le verbe appartient à une conjugaison autre que la première ou lorsqu’il est 168irrégulier, c.à.d. là où le radical est obligé de varier d’un temps ou d’un groupe de temps à l’autre. En cas d’unification, on tend alors à partir du radical tel qu’il se présente dans une forme de conjugaison donnée, pour l’étendre analogiquement aux autres formes. Et ce radical-étalon n’est pas emprunté au petit bonheur à n’importe quelle forme : on peut poser comme principe d’explication que dans le 99% des cas d’unification c’est le radical du pluriel de l’indicatif présent — donc en général (mais pas toujours) le radical élargi — qui est transporté analogiquement au reste de la conjugaison.
Quelques exemples nous éclaireront. Le présent de défaillir (je défaus !) est refait sur le pluriel : nous défaill-ons, ils défaill-ent (elle défaille entre ses bras, Joran n° 88). De même pour mouvoir (je mouve, tu mouves, etc., B 132) et boire (nous boiv-ons, vous boiv-ez, formes rares). Faisez, disez et leurs dérivés, qui sont refaits sur la première du pluriel, n’appartiennent pas seulement au langage enfantin : Ceux qui satisfaisent à ces conditions (Godet XLVI).
L’imparfait, là où il est aberrant, se remodèle sur le présent : j’acquiers, ils acquièrent > j’acquiér-ais.
Enfin, tout cela s’applique naturellement aussi au conditionnel : je voudrais que vous m’écrive-riez le plus vite possible (lettre, Van Der Molen 57).
Le participe passé, et dans la langue écrite le passé simple, tendent, là où ils étaient formés sur un thème spécial, à se greffer directement sur le radical invariable du présent pluriel : les moutons ont paiss-é (Vincent 118) ; pouvoir fait quelquefois pouv-u et mourir mour-u (B 132). On rencontre dans la langue écrite : je riai, je concluai, les fièvres s’étaient résolvées, son appréhension se dissolva, ils se dissolvèrent ; un accueil aussi chaleureux que celui que nous recevâmes (Godet CVII), etc. Il y a là une masse de fautes, plus ou moins éphémères sans doute, mais qui ne se font pas n’importe comment.
Les tentatives d’unification de la conjugaison, dont nous avons donné quelques exemples caractéristiques, signalent une tendance qui se dessine nettement : effacer tout ce qui pourrait rappeler la répartition des radicaux entré plusieurs « temps primitifs » ou « bases » ou « thèmes de flexion » — pour ne laisser subsister qu’un radical unique et invariable, accommodable à n’importe quelle détermination de personne, de nombre, de temps ou de mode.
d) Tendance au verbe à radical interchangeable.
Ces dénominatifs ont de plus l’avantage de faire système avec les adjectifs de procès, les adjectifs de relation et les adjectifs potentiels correspondants : sélectif = sélectionnel = sélectionnable, etc.173
Les verbes décompositifs sont formés à partir de substantifs composés : circonstances atténuantes > circonstancier avec atténuation « accorder les c. a. » (Thérive NL 30.7. 27) ; court-circuit > court-circuiter (Lancelot 24. 3. 28) ; gelée blanche > geler blanc (Nyrop V § 110) ; répétition générale > répéter généralement ; vice-président > vice-présider (Thérive NL 31. 10. 25).
e) Tendance au verbe analytique et progressif.
Il faut ajouter que le verbe français héréditaire ne répond plus à l’analyse actuelle des termes dans la phrase, selon l’ordre sujet + signe de rapport + prédicat, Ou bien le signe de rapport et le prédicat sont confondus en un signe indécomposable (craindre « avoir peur », recourir « avoir recours », répondre « faire réponse »), ou bien, lorsque les éléments sont reconnaissables, leur séquence est archaïque (grand-ir « devenir grand », vieil-ir « devenir vieux », etc., banal-iser « rendre banal »).
Ces exemples, peu corrects mais courants, montrent que les groupes être + substantif, avoir + substantif, faire + substantif sont conçus comme des ensembles, modifiés globalement par l’adverbe. La même remarque s’applique aux fautes de si : J’avais si faim (Z une telle faim) et de beaucoup : J’ai beaucoup faim, Cela m’a fait beaucoup plaisir (Z grand faim, grand plaisir), qui achèvent de signaler la cohésion de ces syntagmes.
C’est d’ailleurs la même tendance au verbe analytique et progressif qui commande l’emploi de la formule être + adjectif transitif, si fréquente dans le français cursif et courant : Cet homme est représentatif de son époque (Z représente), cette lettre est symbolique de son état d’esprit (Z symbolise).
2) Condensation (phrase > mot, syntaxe > morphologie)
Logiquement, c.à.d. si le langage était rivé à la pensée, toute phrase se résumerait dans un rapport unique de sujet à prédicat. En réalité, une seule et même phrase peut, à l’aide de condensations variées, porter l’expression de ce rapport au multiple. Ainsi le verbe réciproque permet de condenser au moins deux phrases : Pierre et Paul se battent = Pierre bat Paul, et Paul bat Pierre. La comparaison porte toujours sur deux jugements, mais le langage peut résumer ce rapport en une phrase unique : Pierre est plus grand que Paul = Pierre a telle grandeur, Paul a telle grandeur, le rapport de grandeur de l’un à l’autre est tel. Dans tout le domaine du langage, le besoin d’économie remplace la série monotone de phrases simples alignées bout à bout, par des ensembles complexes dans lesquels les propositions sont subordonnées les unes aux autres pour former des phrases uniques.
La condensation a pour fonction de transposer une phrase en un membre de phrase, qui peut fonctionner dès lors à son tour comme terme dans une phrase complexe. 175Exemple : la rose est rouge > la rose rouge ; la phrase ainsi transposée en membre de phrase fonctionne à son tour comme sujet dans une phrase plus complexe : la rose rouge s’est ouverte, etc.
La condensation comporte naturellement des degrés variés, que nous examinerons. Mais on peut poser dès le début un trait commun à l’ensemble de la syntagmatique : le caractère dichotomique de tout syntagme. Précisément parce que toute syntagmatique se ramène, statiquement aussi bien qu’historiquement, au rapport initial de sujet à prédicat, les syntagmes, quel que soit leur degré de condensation, s’analysent toujours de deux en deux. Il y a toujours un terme déterminé, un terme déterminant, et un signe de rapport qui les relie ; le déterminé est un sujet ou un sujet, condensé, le déterminant un prédicat ou un prédicat condensé, le signe de rapport un verbe transitif ou un verbe transitif condensé. Exemple : la femme a le panier > la femme qui a le panier > la femme avec le panier > la femme au panier. Cet exemple provisoire montre que la préposition a pour fonction de condenser un verbe transitif, et que le régime de la préposition n’est autre chose que l’objet condensé de ce verbe. Nous dirons en résumé : Rien n’est dans les syntagmes étroits qui ne soit d’abord dans la phrase, rien n’est dans la morphologie qui ne soit d’abord dans la syntaxe.
Ce passage de la phrase au mot sera considéré, dans les pages qui suivent, du point de vue statique et notamment sous l’angle du besoin d’invariabilité ; ce dernier demande que la condensation s’effectue avec le minimum de changements dans la forme et dans la séquence des éléments.
Dans la forme. — L’idéal serait que le même élément puisse fonctionner dans la syntagmatique libre et dans la syntagmatique condensée. Cf. un homme politique (un politicien), une étoffe genre bleu (bleuâtre), la partie machines (la machinerie), manière d’agir (agissement), le fait de diminuer (la diminution), etc.
Dans la séquence. — Si l’on ne considère que le français traditionnel, il y a divergence séquentielle, sur la plupart des points, entre syntagmatique libre (syntaxe) et syntagmatique 176condensée (morphologie) : Cet homme fait de la politique > un politic-ien ; cette partie comprend les machines > la partie qui comprend les machines > la machine-rie, etc. Le français avancé cherche à établir au contraire le parallélisme sujet + prédicat > sujet condensé + prédicat condensé. Cf. un homme politique, la partie machines, etc.
L’interchangeabilité séquentielle peut être obscurcie par plusieurs faits. C’est par exemple l’intervention d’un autre besoin, comme en anglais ou en chinois, où le besoin de clarté oblige à différencier par la séquence la phrase et le groupe nominal : the man is great, chin. jên tá / the great man, chin. tá jên. Mais c’est aussi le fait que les diverses parties d’un système linguistique n’évoluent pas avec la même rapidité. Quand une langue adopte un nouveau type de séquence — et l’on sait que l’évolution de l’indo-européen aux principales langues modernes est en partie dominée par le passage de la séquence régressive (prédicat + sujet) à la séquence progressive (sujet + prédicat) — elle l’introduit d’abord dans la syntagmatique libre, et c’est ensuite seulement que le besoin d’invariabilité l’étend graduellement aux éléments de phrase condensés. Il en résulte que dans une langue donnée la morphologie peut être en retard sur la syntaxe : beaucoup de syntagmes du français traditionnel reflètent un type de phrase qui devait être celui de l’indo-européen.
a) Le subordinatif.
La préposition, avons-nous dit, est un verbe transitif condensé. Quelques distinctions sont à faire.
De même que le signe de rapport reliant le sujet et le prédicat peut être plus ou moins différencié (verbe transitif) ou générique (copule), la préposition reflétera à son tour cette différence ; il y a des prépositions plus ou moins « pleines » ou « vides » (cf. possédant, pourvu de, ayant, avec, à).
En outre, le signe transitif condensé, que nous appellerons désormais d’une manière générale le subordinatif, varie selon la nature de son régime : suivi d’un substantif ou d’un adjectif, le subordinatif est une préposition (après son départ) ; 177suivi d’une proposition, il se mue en conjonction (après qu’il est parti).
Si la préposition est bien un verbe transitif condensé, le besoin d’invariabilité exigerait que le passage de l’un à l’autre puisse s’accomplir avec le minimum de changements dans la forme et dans la séquence. Mais dans nos langues indo-européennes où le verbe et la préposition sont généralement séparés par une barrière formelle rigide, cette exigence ne se réalise que fort imparfaitement. Commencerions-nous à douter de la solidité de notre hypothèse ? L’exemple du chinois parlé, qui représente à peu près l’idéal de ce qu’une langue peut atteindre dans ce domaine, est là pour nous rassurer. La grande majorité des prépositions chinoises courantes (plus d’une cinquantaine) sont interchangeables avec le verbe correspondant. Selon le rôle qui leur est assigné dans la phrase, elles fonctionnent tantôt comme des verbes transitifs tantôt comme des prépositions : yèu « avoir, avec, à » ; yóṅ « se servir de, au moyen de » ; pì « comparer, comparativement à », ; taí « remplacer, à la place de » ; wàṅ « aller, vers (ad) » ; etc..
A défaut d’une solution aussi idéale, trouverait-on en français des cas montrant au moins la tendance à garder le contact entre la préposition et le verbe ? Les procédés traditionnels sont le participe présent (votre réclamation concernant la livraison), le pronom relatif (votre réclamation qui concerne…), l’adverbe transitif (il a agi inconsciemment de son acte) ou une préposition composée. Le rôle principal de cette dernière est de garder le contact avec le signe plein : à partir de, à cause de (= ayant pour cause), etc. Et de fait le sort de la préposition composée est lié à celui du verbe ou du substantif (verbalisé) correspondant. Ainsi fin dans la langue parlée ayant cédé la place à but, le lien entre fin et à fin de s’est effacé : le passage de fin à but entraîne celui de afin de à dans le but de (qqf. à but de).
Subordinatifs d’inhérence. — Si le subordinatif condense un transitif (verbe ou copule), il doit y avoir, parallèlement à la distinction entre transitifs de relation et transitifs d’inhérence (ex. être, se trouver, sembler, paraître, devenir), des subordinatifs 178de relation et d’inhérence. On aurait tort de croire que les prépositions et les conjonctions servent exclusivement à l’expression du rapport de relation. Cf. une chambre de libre (< qui est libre) ; on l’a engagé comme contremaître ; il a fait cela comme je le voulais ; il parle en connaisseur ; le vin s’est changé en vinaigre, etc.
Prépositions et postpositions. — Le besoin d’interchangeabilité (entre le v. transitif et le subordinatif) porte non seulement sur la forme mais encore sur la séquence. Si le v. transitif d’une part, le subordinatif de l’autre, sont parallèles, il en résulte une loi importante : Dans la mesure où l’interchangeabilité séquentielle est respectée, les langues à phrase progressive (v. transitif + prédicat) sont des langues à prépositions (et à conjonctions préposées), les langues à phrase régressive (prédicat + v. transitif) des langues à postpositions (et à conjonctions postposées).
Cette loi semble se vérifier grosso modo. La plupart des langues à verbe médial (l. européennes, l. bantoues, chinois, etc.) sont des langues à prépositions. L’hindoustani, le japonais et les langues turco-mongoles au contraire, où le verbe transitif est postposé au prédicat et termine la phrase, sont des langues à postpositions.
Un autre parallélisme, qui ne se vérifie en général qu’à très longue échéance, est celui entre le verbe postposé et la flexion terminale d’une part, le verbe préposé et la flexion initiale de l’autre. En effet, de même que le verbe transitif se joint à son prédicat en un groupe plus ou moins serré (domus uac-at, la maison est-vide), le subordinatif fait corps avec son régime (groupe prépositionnel ou postpositionnel : il travaille avec-moi, me-cum laborat). De là à l’affixation (préposition > préformante ; postposition > postformante), il n y a qu’une question de plus ou de moins. Le japonais et l’hindoustani d’un côté, le français et l’anglais de l’autre, fournissent l’exemple de langues dont l’évolution est arrivée à l’étape qui précède la flexion terminale, respectivement la flexion initiale.
On sait qu’un très grand nombre de langues indo-européennes ont perdu ou sont en train de perdre la flexion terminale héritée de l’indo-européen, et qu’elles l’ont remplacée, ou sont en train de le faire, par l’usage de prépositions. Le français a perdu la flexion casuelle. Deux théories se sont heurtées et se heurtent encore pour expliquer ce changement de front.
Les uns prétendent que c’est l’usure phonique (débilité des finales) qui a provoqué, par réaction, le développement des prépositions destinées à suppléer les terminaisons déficientes. Or il est remarquable que dans les états de langue les plus anciens, où le passage du type de phrase régressif (prédicat + verbe transitif) au type progressif (verbe transitif + prédicat) ne s’était sans doute pas encore opéré, les particules ajoutées aux cas débiles ou équivoques n’ont pas été des prépositions mais des postpositions 179(ci. le -ā renforçant les locatifs sanscrits et iraniens ; le -de du directif ajouté à l’accusatif grec : πόλιν-δε « ad urbem »).
D’autres prétendent que c’est au contraire la création des prépositions et la fixation de la séquence sujet + verbe + prédicat (servant de signe) qui a fait disparaître les terminaisons casuelles désormais inutiles (Sechehaye, Programme et Méth. de la Lingu. Théorique, 175 sv ; Horn, Sprachkörper u. -funktion, 112).
Il semble que l’élimination des terminaisons casuelles et la création des prépositions soient en gros des faits concomitants entre lesquels on ne peut voir ni dans un sens ni dans l’autre un rapport historique de cause à effet, mais que l’une et l’autre se laissent ramener à un seul principe : le passage de la séquence régressive (prédicat + verbe) à la séquence progressive (verbe + prédicat). La nouvelle séquence des éléments de la phrase a rendu archaïques les subordinatifs postposés (postpositions et terminaisons) et provoqué la création de subordinatifs préposés (répondant aux verbes préposés), en même temps que les postpositions disparaissaient et que les terminaisons casuelles se dévaluaient et tombaient à leur tour.
Il faut noter à part le cas, assez rare, où la conjonction est transposée en préposition à la suite d’une ellipse (mémorielle ou discursive) : Elle a été opérée quand moi « quand j’ai été opéré » > « en même temps que moi ».
Le subordinatif devant un infinitif est une préposition : le traitement de cette dernière est varié : Tantôt elle est rapprochée de la conjonction (avant de venir × avant qu’il vienne > avant que de venir), tantôt elle est solidaire de la préposition suivie d’un substantif (à force de travail > à force de travailler), tantôt elle manque (à cause de /… ; tout au plus a-t-on avec le passé : il a été puni pour avoir désobéi).
b) Les déterminants du substantif.
Le besoin d’invariabilité demande : 1. que le prédicat ne change pas de forme en devenant déterminant (exemple négatif : cette maison est ici > cette maison-ci) ; 2. que le verbe transitif ne change pas de forme en devenant subordinatif (ex. négatif : avoir du courage> courag-eux) ; 3. que la place du subordinatif (avant ou après le déterminant) corresponde à celle du verbe transitif (avant ou après le prédicat) (ex. négatif : faire impression > impression-nant).
Une phrase indépendante peut être transposée en un déterminant à l’aide de deux procédés : la proposition participiale (type ancien) et la relative (type moderne). Exemples : Il apporte le pain > Le garçon apportant le pain est arrivé, ou : Le garçon qui apporte le pain est arrivé. On aperçoit aisément la différence de séquence entre la participiale et la relative : apportant / qui apporte ; la première répond au type régressif (déterminant + subordinatif), la seconde au type progressif fsubordinatif + déterminant). Et de fait la proposition participiale a aujourd’hui un import écrit et archaïque ; le type vraiment moderne est la relative. On remarquera que pour transposer une phrase en un déterminant de verbe, le français n’a pas encore dépassé le stade de la proposition participiale (gérondif français) : le garçon est arrivé en apportant le pain (le nouveau type serait : *le garçon est arrivé qu’il apportait le pain).
Dans les propositions relatives « réfléchies », c.à.d. dans les phrases où le substantif que la relative détermine est en même temps l’objet du verbe de la relative (ex. la lettre que j’ai écrite), les grammairiens, à la suite d’un usage ancien, ont établi la règle que le participe passé doit s’accorder avec cet objet (la lettre qu’il a écrite).
On a beaucoup ferraillé sur ce problème, qui est en somme très simple. L’accord du participe passé est au fond un procédé de conformisme grammatical, qu’on peut mettre sur le même plan que la concordance des modes (Je veux qu’il 182vienne) et la concordance des temps (Je croyais que Genève était une belle ville). Seulement, et voilà le point important, l’accord n’est nullement indispensable à l’intelligence de la phrase, et le besoin d’invariabilité, qui exige que la transposition s’effectue avec le minimum de changements formels, cherche naturellement à se défaire de ces procédés qui augmentent inutilement l’effort de mémoire à fournir : Je veux qu’il vient, Je croyais que Genève est une belle ville, La lettre qu’il a écrit.
Que la suppression de cet accord s’imposera tôt ou tard, les faits qui le montrent ne sont plus à compter. Pour ne pas dire ou écrire : la peine qu’on a pris, la boîte qu’elle a ouvert, après toutes les injures qu’on s’est dit, les conséquences qu’il a craint, la personne que j’ai plaint, la récompense qu’il a promis, etc. etc., il faut savoir aujourd’hui d’avance, et uniquement en vertu des règles enseignées à l’école et dans les livres, que de tels tours sont incorrects.
On sait d’autre part que là où l’accord n’est marqué que par une particularité phonique — la longueur de la finale (la lettre qu’il m’a adressée, la lettre que j’ai reçue) — la langue parlée, à Paris tout au moins, n’allonge plus guère cette finale : la lettre qu’il m’a adressé, la lettre que j’ai reçu.
Une autre entrave au besoin d’invariabilité est dans la séquence. La proposition relative correcte présente des cas où le verbe, contrairement au type de séquence établi dans la phrase indépendante, précède son sujet, notamment lorsque ce dernier forme un groupe assez long : les gares que traverse la ligne directe de Paris à Lyon. Le français avancé tend à écarter cette survivance ; il ne dira jamais, par exemple : les propos que tiennent tous ces gens-là, ni guère : le travail que fait votre ami.
Le traitement du pronom relatif dans le langage populaire mérite une étude spéciale. Le français traditionnel n’a pas de pronom relatif invariable, applicable indifféremment à tous les cas, mais il est obligé de se servir de signes distincts, qui varient en fonction de leur contexte : la chose dont j’ai besoin / la rue où l’accident a eu lieu / l’homme qui est venu / 183le monsieur que j’ai vu / une chose à laquelle il faut faire attention, etc. Dans chacun de ces cas, le pronom relatif est obligé de changer de forme en fonction de la phrase qu’il est chargé de transposer en déterminant.
Dans certains cas, ce que s’est installé par assimilation au que de l’objet direct, grâce au caractère locutionnel du groupe auquel il se rapporte : une chose que j’ai peur (× que je crains), une chose qu’il faut faire attention (× qu’il faut remarquer). Mais cette explication n’a qu’une valeur limitée ; la généralisation du que répond au besoin de disposer d’un instrument invariable remplaçant tous les autres relatifs.
Mais la création et l’extension de ce que invariable ne satisfait pas encore pleinement le besoin d’interchangeabilité. Les matériaux que livre sur cette question le français avancé ont une portée plus étendue ; la définition et l’existence mêmes du pronom relatif sont en jeu.
On remarquera tout d’abord ce fait significatif que le pronom relatif n’est pas un rouage indispensable au fonctionnement du langage. Sans parler des langues où le relatif peut être sous-entendu (angl. the man I saw yesterday ; there is a man wishes to speak with you), certains idiomes, tels que le chinois et le japonais, ne le connaissent même pas.
C’est que le pronom relatif, par sa constitution, est contraire au besoin d’invariabilité. D’une part, en effet, il suppose le cumul d’un subordinatif (que) avec un pronom qui représente l’antécédent à un certain cas ; exemples : l’homme dont je n’ai pas de nouvelles « que (je n’ai pas de nouvelles) de lui » ; la maison où il habite « que (il) y (habite) » ; la femme qui est venue « que-elle (est venue) ». Ainsi donc, un seul et même signe tantôt a sa forme indépendante (de lui, y, elle), tantôt est logé par cumul dans ûri autre signe (dont, où, qui). Il y a cependant des cas où le relatif est bien un syntagme : lequel, duquel, auquel, à quoi, etc. ; même alors, il est contraire au besoin d’invariabilité. Car d’autre part il entrave l’interchangeabilité séquentielle entre la phrase 186indépendante et la proposition relative : l’homme dont (duquel, de qui) je n’ai pas de nouvelles / je n’ai pas de nouvelles de lui ; la maison où (dans laquelle) il habite / il y habite.
Après avoir signalé le décumul du pronom relatif aux cas obliques, nous allons constater la même tendance dans le traitement des cas directs. On aurait tort, par exemple, de parler de pléonasmes à propos de phrases du genre : C’est des types que le malheur des autres les amuse, Ceux que ça les intéresse pas n’ont qu’à s’en aller ; Vos enfants que j’ai toujours bien hâte de les voir (Prein 29). — Que doit être interprété ici non pas comme un accusatif (lat. quos), mais comme une simple conjonction vide. Sans doute, ces exemples sont empruntés à un étage de la langue taxé de trivial ; mais qui pourrait se vanter de ne jamais commettre de ces fautes, dans le parler déboutonné de tous les jours ? Et le type répond à une tendance si profonde qu’il vient s’introduire subrepticement jusque dans la prose de quelques grands écrivains : II est certaines choses que, une fois que nous les avons sues, nous les savons toujours (Malherbe, Stapfer 59) ; Sous ce nom, difficile à porter, et qu’il fallait tant d’espoirs pour oser le prendre, il a conquis la faveur de l’univers (Valéry, disc. de réception à l’Acad.).187
On voit nettement que le décumul du relatif et le libre échange entre l’indépendante et la relative se conditionnent réciproquement.
On notera aussi l’interprétation de qui par qu’il : Le vase qu’il est sur le piano, C’est eux qu’ils sont les riches (B 103), Le voilà qu’il s’amène (Joran n° 22). Ce décumul de qui en qu’il est notamment une des causes de l’ll redoublé, si caractéristique du langage populaire : Celui qui ll’a paumé, Celui qui ll’a fait venir (B 110) ; le découpage est en réalité : Celui qu’il l’a paumé, Celui qu’il l’a fait venir.
On sait d’autre part que la langue familière et surtout la langue populaire omettent souvent l’l : i vient. Il est donc permis de supposer que la conscience linguistique, là où la langue écrite découpe : C’est lui qui vient, analyse en réalité : C’est lui qu’i vient, Je les ai entendus qu’i discutaient, Je les ai vus qu’i venaient. La fausse liaison dans : Ils sont là qui-z-attendent, peut s’expliquer par le décumul : Ils sont là qu’i(l)s attendent.
Ce décumul en qu’il impersonnel est artificiel dans la mesure même où le il impersonnel est devenu artificiel en 189face de cela (ça) : Il m’ennuie de… > Ce qu’il m’ennuie, c’est de…
Ces exemples de dont, où et qui n’ont sans doute pas grand avenir, à côté de l’extension universelle du que. Ils montrent du moins les tâtonnements qui accompagnent d’ordinaire l’installation définitive d’un nouveau type.
Si les idées émises dans ces pages sont conformes à la réalité, le cas du pronom relatif est un bel exemple de la manière dont une tendance — ici le besoin d’invariabilité — en arrive à ses fins à travers une série de petits faits particuliers, dont chacun pris isolément reste inexplicable tant que tous n’ont pas été rattachés à un principe un. La suppression du pronom relatif est un moment de l’évolution irrésistible qui entraîne le français vers le libre échange des signes et des syntagmes d’une fonction à l’autre.
L’adjectif traditionnel peut être variable en genre et en nombre (un homme veuf / une femme veuve ; un effort moral / des efforts moraux), et par la liaison (vieux mur / vieil arbre).
L’adjectif en français avancé marche par des voies diverses vers l’idéal de l’invariabilité.
Un certain nombre d’adjectifs se terminant par c ou j sont invariables, qu’ils soient prédicats ou déterminants : une femme maladif, une balle explosif, une boisson sec, une 191femme veuf (B 94). Cette tendance se manifeste aussi pour d’autres espèces (ex. une femme perdue, Martinon II 270 n), notamment pour le type en -al/aux ; le français semble se montrer de plus en plus réfractaire au pluriel en -aux : v. D’Harvé PB § 156 (de banals parfums, des experts médicals, etc.).
La tendance à la non-liaison est tout aussi accusée : un gran artiste, un vieu arbre, un gro achat, un beau édifice, un nouveau immeuble, etc. Le besoin d’invariabilité l’emporte ici sur la répulsion du français traditionnel contre l’hiatus. Ce dernier n’est d’ailleurs que théorique : « A la vérité, en français il y a toujours liaison ; seulement, dans un cas comme celui-ci, la liaison n’est plus consonantique, elle est vocalique. » (Grammont, Prononc. fr., 136). La « liaison vocalique » ou « prononciation liante » représente donc un compromis entre le besoin d’invariabilité et la tendance à éviter l’hiatus.
La tendance à l’invariabilité de l’adjectif se manifeste aussi dans la réluctance du français avancé à décomposer les finales nasales : un bon (bõn) auteur, en plein (plẽn) air, etc. (bõ = bõn, plẽ = plẽn, au lieu de bõ / bòn, plẽ / plèn).
Il ne suffit pas que l’adjectif soit invariable par rapport à son entourage dans la chaîne parlée. Si l’adjectif déterminant est bien un prédicat condensé, il faut qu’il soit interchangeable avec ce dernier, et cette interchangeabilité doit porter aussi bien sur la forme que sur la séquence.
Beaucoup de langues, en effet, différencient le prédicat (ex. la rosé est rouge) et le prédicat condensé (la rosé rouge) l’un de l’autre, soit par la forme, à l’aide de terminaisons spéciales, soit par la séquence (anglais, chinois).
La place mobile de l’adjectif français, que tout le monde a signalée et décrite, sert à des fins toutes différentes. L’adjectif normal tend à être postposé (la rosé rouge, un brouillard épais, etc.), conformément à la séquence sujet + prédicat (la rosé est rouge, le brouillard est épais). Cette tendance est très forte ; même dans des combinaisons qui paraissaient se figer, le français cherche à supprimer l’antéposition de l’adjectif : la fois prochaine, la fois dernière (× la semaine prochaine, dernière), d’un accord commun (Vittoz 87), s’arrêter à un terme moyen (ib.), etc.192
L’adjectif préposé, au contraire, quand il n’est pas un simple préfixe (tit’fille, tit’maison, etc.), est considéré comme une inversion expressive : un épais brouillard, une verte prairie, une colossale entreprise, etc.
De même que tout prédicat est lié à son sujet par un verbe transitif, tout déterminant est lié à son déterminé par un subordinatif (verbe transitif condensé), exprimé ou non. Tel est le cas pour la préposition de chargée de former le lien entre un substantif actualisé et son prédicatif : une chambre est libre > une chambre qui est libre > une chambre de libre.
Les adjectifs tirés de substantifs marquent la même tendance à préposer le subordinatif : une femme en pleurs (Z éplorée ; type intermédiaire : épleurée, faute fréquente), un arbre en fleurs (fleuri), etc.
Particulièrement intéressants sont les cas où un suffixe 193semi-concret (ex. -âtre, -oïde) fait place à une préformante tirée directement du substantif, réalisant ainsi l’interchangeabilité séquentielle et formelle : une couleur genre bleu (Z bleuâtre), une teinte genre rouge (Z rouge-âtre), une forme genre œuf (Z ov-oïde), une courbe genre ellipse (Z ellips-oïde), etc.
Les adjectifs qualificatifs, qui sont des déterminants d’inhérence, doivent être distingués des compléments de relation. Tandis que les premiers remontent à un prédicat d’inhérence (la rosé est rouge > la rosé rouge), les seconds condensent un prédicat de relation (objet) ; ex. il commande le navire > le commandant du navire.
Le complément de relation (ou génitif objectif) est donc au prédicat de relation (ou : objet direct ou indirect, accusatif ou datif) ce que le déterminant d’inhérence (adjectif qualificatif, etc.) est au prédicat d’inhérence. Dans les deux cas, le besoin d’invariabilité demande que la séquence reste la même : le brouillard est épais > le brouillard épais ; il commande le navire > le commandant du navire ; le livre est à Pierre > le livre de Pierre.
Le même rapport vaut pour les langues en général, et pour leur histoire. Dans la mesure où l’interchangeabilité séquentielle entre phrase et membre de phrase est respectée, les langues à objet postposé sont des langues à complément de relation postposé, et inversement les langues qui comme l’hindoustani, le japonais et les langues turco-mongoles, préposent l’objet au verbe transitif, préposent aussi le complément de relation au substantif déterminé (et sont par conséquent aussi des langues à postpositions). De même, si l’on se place sur le terrain historique, l’évolution du génitif préposé (en indo-européen et en latin) au génitif postposé (l. romanes) apparaît en résumé comme le retentissement, sur la syntagmatique condensée, de l’évolution de la séquence accusatif + verbe transitif (en indo-européen et en lat.) à la séquence inverse : verbe transitif + accusatif.
Contradictions. — a) Cette théorie est en contradiction avec celle du P. W. Schmidt (Sprachfamilien u. -kreise der Erde, 194491-4), qui explique le passage du génitif préposé au génitif postposé, et en même temps le passage de la flexion terminale aux prépositions, par l’intervention d’un facteur externe : le contact avec des langues non indo-européennes. — La linguistique fonctionnelle, sans rejeter en principe l’explication externe, ne la fait intervenir qu’après avoir épuisé les possibilités d’explication par le fonctionnement même du système et par les besoins qui le commandent.
b) Lorsque l’interchangeabilité séquentielle est en défaut, c’est qu’elle est contrecarrée par la tradition (« puissance du matériel linguistique existant »), ou par l’action d’autres besoins, notamment du besoin de clarté. Un facteur important, dans ce dernier cas, est la prédominance de l’emploi de subordinatifs formels (désinences, prépositions, etc.) ou de la juxtaposition pure ; cette dernière pousse l’anglais à différencier par la séquence la phrase (my father is good) et le groupe nominal (my good father), tendance qui devient règle absolue en chinois (sujet + prédicat / adjectif ou complément de relation + substantif).
Mais l’idéal linguistique serait d’obtenir non seulement l’interchangeabilité séquentielle, mais encore l’interchangeabilité formelle entre l’objet et le complément de relation. C’est ce que réalisent certaines langues, sous leur forme parlée plus ou moins populaire (latin de Plaute, bas-latin, etc.) : Quid tibi nos tactio ‘st ? Quid tibi hanc curatio ‘st rem ? Iusta orator « celui qui demande des choses justes » ; Peccatorum ueniam promittor « celui qui promet la grâce des pécheurs », etc. (v. Vendryes, Lang., 150-1). Cf. : J’ai fait des demandes aux Commandants les Dépôts et le 3e Corps, il m’a été répondu présumé en bonne santé (APG).
Quant à l’objet indirect (datif), le type le canif à Pierre (< le canif est à Pierre) est dès longtemps attesté. C’est la même tendance à unifier la rection qui crée la construction si fréquente aujourd’hui : l’élection au Conseil National (Plud’hun 64), les contrevenants au présent arrêté, un adhérent à la Société (Joran n° 3), les morts pour la patrie.
Les adjectifs de relation, qui sont une autre manière de condenser le prédicat de relation (un témoin qui l’a vu de ses yeux > un témoin oculaire ; un concours qui a lieu sur route > un concours routier), intéressent la langue cursive. 195La langue parlée ne les favorise pas, car ils contrarient le besoin d’invariabilité.
D’une part, en effet, le passage du mot « populaire » au mot « savant » que nécessite la création de l’adjectif de relation, est souvent très abrupt : œil / témoin oculaire, sucre / teneur saccharine de la betterave, coupon / impôt cédulaire, poumon / pulmonaire, etc. D’autre part, l’adjectif de relation s’écarte presque toujours de la séquence des éléments de la phrase : le concours a lieu sur une route / routier.
En outre, la langue parlée tend, ici comme pour les adjectifs d’inhérence, à remplacer les suffixes par des prépositions, afin de ne pas changer de séquence dans le passage du prédicat de relation au complément. Les exemples de cette transformation ne sont d’ailleurs guère incorrects : un concours sur route (Z routier), des soldats à casques (Z casqués), un homme à courage (Z courageux), un voyage sur mer (Z maritime), par air (Z aérien), etc. Néanmoins, l’évolution est capitale.
Le déterminatif cumule un actualisateur (article) avec un déterminant (adjectif) de manière à former un signe unique, c.à.d. un syntagme non-analysable dans sa forme. Exemples : mon chapeau « le chapeau de moi », quatre personnes « des personnes au nombre de quatre », cette maison « la maison qui est là, » etc.
c) Les déterminants du verbe.
C’est à l’aide du gérondif que le français condense une phrase en une proposition déterminant le verbe : Il courait > Il est arrivé en courant. Un autre procédé est la proposition circonstancielle, introduite par une conjonction : Il est arrivé en même temps qu’il courait, pendant qu’il courait. Le gérondif et la proposition circonstancielle, qui déterminent le verbe, sont parallèles à la proposition relative qui détermine le substantif. Comme pour cette dernière, le besoin d’interchangeabilité cherche à rendre aussi aisée que possible la transformation de la phrase en une circonstancielle, et entre ainsi en conflit avec les exigences du conformisme grammatical, qui demande au contraire que le verbe varie en fonction de la conjonction qui le régit (cf. l’imparfait après si, le subjonctif après certaines conjonctions, etc.). On ne fera ici qu’effleurer ce vaste sujet.
L’imparfait après si est un procédé de conformisme inutile à l’intelligence de la phrase, et qui entrave l’interchangeabilité entre l’indépendante et la subordonnée. En même temps, il empêche l’expression du mode quand ce dernier demande à être exprimé ; dans ce cas, le langage populaire se sert du conditionnel d’éventualité, absolument comme dans la phrase indépendante : Je pourrais peut-être le voir > Si je pourrais peut-être le voir (Z Je pourrais peut-être le voir/ Si je pouvais…).
La conjonction peut être également obligée de varier, en fonction de son entourage : Quand (kã) je suis venu / Quand (kãt) il est venu. Le français populaire, poussé également par le besoin dé conservation des monosyllabes, unifie par la forme longue dans les deux cas : Quand’ je suis venu, Quand’ nous sommes venus, Quand’ je te dis que ce n’est pas vrai !
Les adverbes relatifs (conj. + adv. cumulés) sont parallèles aux pronoms relatifs. On commence à rencontrer, dans la langue parlée, des cas de décumul qui rappellent ceux du pronom relatif : Je serai parti quand vous viendrez > 200Je serai parti que vous viendrez alors ; Juste au moment où il sortait de chez lui, la lettre est arrivée > Juste qu’il sortait de chez lui à ce moment, la lettre est arrivée ; Il est parti sans qu’on sache pourquoi > Il est parti qu’on ne sait pas pourquoi.
L’adverbe est à la proposition circonstancielle ce que l’adjectif est à la proposition relative. Par métaphore, on peut dire que la fonction de la proposition relative est de condenser une phrase indépendante en un adjectif, tandis que celle de la circonstancielle est de condenser une ndépendante en un adverbe.
Les règles de séquence sont aussi parallèles. De même que le prédicat est postposé à son sujet, la relative et la circonstancielle sont postposées à leur déterminé ; le type régressif latin et pré-latin a été abandonné (filium amans pater → le père qui aime son fils) ; la circonstancielle placée avant le verbe est aujourd’hui désuète et littéraire, sauf dans les constructions absolues : Pour vivre, il faut travailler.
La place de l’adjectif déterminant le substantif et celle de l’adverbe déterminant le verbe, sont soumises au même sort. L’adverbe français tend à être postposé : Tu es maboule un peu ! On m’a dit même qu’il avait été transporté dans une ferme (APG), Je renouvelle aujourd’hui ma demande faite le g octobre, dont nous n’avions eu pas de réponse (id.), etc.
En raison de la même tendance, le subordinatif chargé de former l’adverbe et de le relier au verbe viendra se substituer en tant que « préformante » aux suffixes traditionnels. En effet, la plupart des adverbes de manière de la grammaire courante étant au fond des adverbes d’inhérence, ayant pour base la copule être, la place du suffixe -ment jure avec celle de la copule devant son prédicat : être joli / joli-ment. De là divers types nouveaux en voie de formation eu de développement.
On a cité comme remplaçants éventuels des adverbes en -ment « des formations telles que marcher d’un pas tranquille, d’un pied rapide, parler à voix basse, crier à tue-tête, etc. » (Bally LV 75). Le renversement de la séquence est frappant : claire-ment > d’une manière claire. Le type semble avoir pour le moment un import « écrit », mais il répond à la courbe d’évolution de la langue et il suffirait qu’un ou deux exemples se généralisent pour qu’on obtienne ainsi un préfixe de manière : d’un air…, d’un ton…, d’une manière…, d’une façon…
Parmi les types moins concrets, et par conséquent plus généraux, citons la préformante en, qui fournit des adverbes à peu près corrects : en héros (héroïquement), en douce (doucement), en moins fort, en grand, en clair, etc., et par extension en tête-à-tête et en sous-main (Lancelot 21. 7. 28). La préposition pour forme également des adverbes : pour sûr (sûrement).
Les circonstanciels et adverbes de relation condensent des prédicats de relation pour en faire des déterminants de verbes. Ainsi les adverbes de lieu et de temps sont des adverbes de relation ; on peut toujours leur substituer un verbe suivi d’un prédicat de relation ou une préposition de relation suivie de son régime : ailleurs « à un autre endroit », ici « à cet endroit », toujours « à chaque instant », etc. C’est surtout la préposition à qui sert à former les adverbes de relation : Vendre en ayant des pertes > avec des pertes > avec perte > à perte ; fermer avec une clef > à clef ; à deux mains, à quatre pattes, etc. Ce type est entièrement correct.
d) Adjectif = adverbe.
e) Déterminants affixés.
A un degré de condensation ultérieur, le déterminant est affixé à son déterminé de manière à former avec lui plus ou moins un seul mot : très-grand, si-joli, in-connu, etc. Le besoin d’invariabilité demande naturellement que le passage du déterminant lâche au déterminant étroit s’effectue avec le minimum de changements dans la forme et dans la séquence des éléments.
Le français avancé présente des cas où un adverbe lâche est employé comme adverbe serré (Ici joint quelques timbres pour la réponse, Ici joint vous trouverez dix francs, APG), et inversement un adverbe serré (adverbe de déterminant) comme un adverbe lâche : On a très applaudi sa causerie. Je me suis très amusé ; Tu t’ennuies si de ne pas avoir de mes nouvelles (Prein 75).
Le traitement des préfixes négatifs doit être mentionné à part. Le préfixe traditionnel in- contrecarre de diverses manières le besoin d’invariabilité. D’abord, il est obligé de varier en fonction de l’initiale du mot : in-capable, im’-mangeable, in’-négociable, il-lassable, ir-remplaçable.
La langue populaire, où le besoin d’interchangeabilité prévaut, réagit en généralisant l’une des deux négations, ordinairement l’adverbe libre. Ce type d’unification, que n’ignorent pas les autres langues, est absolument courant dans le français familier et populaire : un homme pas content, un élève pas attentif, une fille pas adroite, etc.
Il ne faut pas oublier que ces schèmes n’ont qu’une valeur théorique, car à mesure que l’on descend dans la morphologie l’invariabilité devient de plus en plus difficile.
f) La substantivation.
Tout syntagme peut être condensé en un substantif : être blanc > la blancheur, marcher > la marche, faire de la politique > un politicien, beau > le beau, etc. Cette fonction que le substantif a de condenser les syntagmes, est essentiellement économique ; la concrétisation et l’abstraction facilitent la manipulation des signes. Mais il faut naturellement que la substantivation, pour être économique, puisse jouer avec le minimum de changements dans la forme et la séquence des éléments.
Nous examinerons successivement le substantif réel, désignant un être ou une chose, et le substantif abstrait.
Tandis que le radical du verbe, en français traditionnel, est obligé de fortement varier, le radical du substantif, plus évolué, est devenu à peu près invariable. Il résiste encore à l’invariabilité dans certains cas, notamment par le nombre et le genre, mais il s’agit là de survivances : cheval / chevaux, fou / folle, etc. Malheureusement, l’élimination de ces vestiges est extrêmement lente ; les formes divergentes se disputent pour servir de modèle à l’analogie (bals, chacals, régals, mais : bateau, chapeau, seau), et les fautes actuelles dues au besoin d’unifier le radical appartiennent à plusieurs types. Ainsi l’on trouve non seulement des amirals, des caporals, élever des bétails, et même : des journals, des œils, mais encore un bestiau, un animau, un hopitau, etc.
Le pluriel des monosyllabes est soumis à un traitement conséquent : le français avancé adopte dans tous les cas la forme à consonne finale prononcée (un œuf = des œuf’, un bœuf = des bœuf’, un os = des os’) ; le besoin d’invariabilité 207marche ici de pair avec le besoin de différencier les monosyllabes en les étoffant.
Qu’il s’agisse du nombre ou du genre, le français tend donc à abandonner les vieilles différences formelles (cheval / chevaux, fou / folle), pour marquer les idées de détermination en dehors du radical.
En français traditionnel, les pronoms également sont souvent obligés de varier en fonction de leur entourage ; tel est le cas pour le pronom ça : Regardez-ça / ce n’est pas vrai / c’est vrai. Le français avancé cherche à le maintenir invariable : On verra voir si ça est vrai, ça (B 153) ; ça n’est pas vrai ; ça n’est pas ça ; c’est pourquoi faire, ça qu’il a derrière ?
Les substantifs composés et dérivés ont pour fonction de condenser une phrase en un substantif : il fait de la politique > un politicien, il cultive la terre > un cultivateur, le pot est pour le lait > le pot à lait, ce timbre sert de réclame > un timbre-réclame, etc. Pour rendre aussi aisé que possible le passage de la phrase au composé ou au dérivé, il est clair que le besoin d’invariabilité cherchera à réaliser, d’une manière plus ou moins approchante, l’identité formelle et séquentielle de l’une à l’autre.
En outre, puisque le point de départ des composés et des dérivés est la phrase, la séquence sujet + prédicat devrait, en vertu du besoin d’invariabilité, fournir l’ordre radical + affixe (postfixe ou postverbe). Nous avons donné plus haut quelques exemples de cette tendance : progresser > marcher en avant, rétrograder > marcher en arrière, poursuivre > courir après, etc. ; roue avant, roue arrière, centre demi, etc.208
La langue cursive s’est créé un type qui permet l’interchangeabilité entre syntagmatique libre ou étroite : les produits miniers méditerranéens, la science chimique allemande, le mouvement poétique moderne, etc. (v. Thérive FLM 109 sv). Il ne s’agit pas là d’adjectifs accumulés, mais de groupes nominaux (substantif + adjectif) fonctionnant comme des composés qualifiés en bloc par un adjectif suivant, et ainsi de suite. Par exemple, un groupe comme des théories sociologiques révolutionnaires s’analyse en un composé (théories sociologiques) suivi d’un adjectif qui le qualifie globalement. De la sorte, un même syntagme peut fonctionner tantôt comme un groupe syntaxique (les langues isolantes, all. die isolierenden Sprachen) tantôt comme un composé (les langues isolantes monosyllabiques, all. die einsilbigen Isoliersprachen).
Les substantifs décompositifs sont formés à partir de substantifs composés ; ce sont des dérivés de composés : linguistique générale > linguiste général ; statistique du travail > statisticien du travail ; pomme à couteau > pommier à couteau ; accident du travail > accidenté du travail ; médaille militaire > médaillé militaire, etc. Ces formations sont caractérisées formellement par le fait que le substantivateur est infixé dans le syntagme (statisticien du travail, médaillé militaire) ; mais le langage populaire tend à supprimer les discontinuités qui se présentent dans l’agencement des signes : chemin-de-ferr-ier (Z cheminot).209
Le substantif abstrait, au lieu de désigner une chose ou un être réels, a pour fonction de condenser une phrase en une entité fictive : la mort « le fait de mourir », la beauté « le fait d’être beau », le professorat « le fait d’être professeur », etc.
Ce procédé favorise éminemment la maniabilité des pièces du système. Le fait n’est pas une chose, ni un être, mais un condensé de phrase construit par le langage ; il n’existe pas tout fait dans la nature : ce sont les sujets pensants et parlants qui le créent pour des raisons de commodité.
Mais cette économie est soumise à des limites ; en français, le substantif abstrait héréditaire pèche doublement — par la forme et par la séquence — contre le besoin d’invariabilité.
Le problème se présente sous beaucoup d’autres faces encore. Ainsi il comporte un aspect phonique : babil est prononcé babiy pour garder contact avec le verbe dont il est tiré. D’autre part, le substantif abstrait héréditaire, pour être compris, suppose souvent la connaissance d’un verbe qui n’existe pas dans la langue même : acception ← lat. accipere, médication ← lat. medicare, etc. ; le français avancé refait ces substantifs à partir de bases connues : dans l’acceptation défavorable du terme, médicamentation, etc.210
Le préfixe comme le suffixe peut être obligé de varier en fonction du radical : enflammer / inflammation, d’où : inflammation (Joran n° 165). « La plupart de nos suffixes ont peu de valeur intrinsèque ; il en est même qui sont interchangeables, sinon au regard du linguiste, du moins dans la pratique : et les étrangers ne sont pas seuls à hésiter sur tel mot qui peut se terminer en age, en erie, en ement, en ité, en ion, en ure… » (Vittoz 55). Et de fait, qui n’a entendu parler de la conformité (Z conformation) d’un objet, de la dentition (Z denture) d’une personne, etc. ?
Le substantif abstrait traditionnel, avons-nous dit, pèche contre l’interchangeabilité par la forme et par la séquence. Par la séquence : l’abstracteur — c’est ainsi qu’on peut appeler le signe chargé de condenser la phrase en un substantif abstrait — est en effet un suffixe (beau-té, professor-at, ven-ue, etc.)
Les propositions qui périphrasent le substantif abstrait sont seules conformes à la séquence actuelle des éléments de la phrase : le fait d’être beau, le fait d’être professeur, le fait d’être venu, ou : de venir, etc. L’abstracteur peut naturellement être plus ou moins générique ou spécialisé ; cf. ac-tion / agisse-ment, le fait d’agir / la manière d’agir (« le fait d’agir ainsi »).
La proposition substantive est en effet l’équivalent moderne du substantif abstrait héréditaire ; elle suppose, explicitement ou à l’état latent : 1. un abstracteur ; 2. un subordinatif (que + proposition fléchie, de + proposition infinitive) ; 3. une proposition, à verbe fléchi ou non.
La linguistique fonctionnelle semble ainsi pouvoir résoudre, par l’étude du langage spontané contemporain, un problème qui était réservé jusqu’ici à la linguistique de musée : l’antériorité historique du substantif abstrait ou de la proposition substantive. Au point de vue du chargement de séquence, le remplacement graduel des substantifs abstraits héréditaires par des propositions substantives peut d’ailleurs être mis en parallèle avec le passage de la proposition participiale traditionnelle à la relative moderne : ex. la préparation du pain > le fait de préparer le pain = le boulanger 211préparant le pain > qui prépare le pain. Il s’agit là, comme pour tant de choses dans le langage, d’une évolution longue et lente, où le remplaçant et le remplacé coexistent pendant des siècles.
La présence de l’abstracteur est d’ailleurs normale dans le domaine des conjonctions de subordination, car chacune au fond transforme son régime en un substantif abstrait : Elle est fâchée de ce qu’il est parti = du fait qu’il est parti = de son départ ; cf. à ce que = au fait que, en ce que = dans le fait que, etc.
On remarquera — nous insistons sur ce point que les manuels ignorent — le parallélisme des subordinatifs de et que, chargés de relier l’abstracteur à la proposition qu’il substantive : Je promets que je viendrai demain = je promets de venir demain (théoriquement : le fait que, le fait de). La seule différence est d’ordre normatif ; le que est obligatoire, tandis que le de n’est pas encore toléré devant tous les infinitifs.
L’infinitif précédé de de a été condamné par divers grammairiens. « Si l’infinitif-su jet est parfaitement admissible et s’il est excellent de dire : Pleurer est lâche, Faire sa soumission eût été logique, nous ne conseillerons jamais d’écrire : De pleurer est lâche, De faire sa soumission eût été logique, D’aller à pied est hygiénique » (Albalat, Comment il ne faut pas écrire, 41-2). Cette tournure rejoint pourtant l’usage classique, et répond à la tendance profonde de marquer explicitement les rapports grammaticaux.
Par ricochet, ce de s’étend aux prépositions, à commencer par pour : C’est pour de rire (Joran n° 84), et plus explicitement : Je pense toujours à vous tous pour ça de travailler les chevaux enfin faites votre mieux (Prein 68).
Note. — Le parallélisme des subordinatifs de et que est d’ordre général ; on en trouve l’équivalence dans d’autres langues : all. dass — zu ; angl. that = -ing, etc.
3) Transposition linéaire
Les types transpositifs étudiés dans les pages qui précèdent sont des procédés permettant de condenser la densité des syntagmes. La transposition linéaire consiste à modifier l’étendue ou la direction syntagmatiques des éléments agencés, leur densité et leur signification étant censées rester les mêmes.
a) Changements d’étendue : élargissement et rétrécissement.
Tout verbe intransitif, c.à.d. tout verbe fonctionnant comme prédicat, peut être élargi en admettant un prédicat à sa suite, c.à.d. en devenant à son tour un signe de-rapport ou verbe transitif ; ex. le troupeau sort > on sort le troupeau. Inversement, tout verbe transitif peut être rétréci en un verbe intransitif absolu, par l’ellipse (mémorielle ou discursive) de son prédicat ; ex. il boit du vin > il boit.
Le verbe intransitif absolu diffère du verbe intransitif neutre par le fait que ce dernier constitue toujours plus ou moins un syntagme dans lequel le rapport de copule à prédicat n’est pas analysable par la forme. Exemples : vivre « être en vie », exister « être là, être qch. », évoluer « devenir qch. », agir « faire qch. », etc. etc. Dans le domaine de la syntagmatique étroite, nous verrons que les adverbes synthétiques sont parallèles au verbe neutre (ensuite « après ça », néanmoins « malgré ça », ainsi « comme ça », etc.) et les adverbes absolus parallèles au verbe absolu (après « après ça », malgré « malgré ça », avant « avant ça », etc.).
Essence et existence. — Les discussions des scolastiques et des modernes sur la différence entre essence et existence ou entre 214être et exister (v. Lalande 217, 222, 228), ne sont qu’un problème de langage projeté dans la philosophie. Il s’agit simplement de la distinction entre le verbe transitif (Dieu est grand), le verbe intransitif absolu (Dieu est « existe » ; Je pense donc je suis « existe ») et le verbe intransitif neutre (Dieu existe). De même : devenir / évoluer « devenir qch. » ; avoir / posséder « avoir qch. » ; faire / agir « faire qch. ».
Le même mécanisme d’élargissement ou de rétrécissement peut s’observer dans le domaine de la syntagmatique condensée. De même que tout verbe intransitif peut devenir transitif par l’adjonction d’un prédicat, tout déterminant (adjectif ou adverbe) peut devenir à son tour, par addition d’un complément, un subordinatif ; inversement, tout subordinatrf peut, par ellipse (mémorielle ou discursive) de son régime, fonctionner comme un déterminant.
Le français traditionnel possède tout un stock d’adverbes et de prépositions qui diffèrent par la forme : à / y « à qch., à un endroit », après / ensuite « après cela », dans / dedans « dans cela », de / en « de qch., de qn. », sur / dessus « sur qch. », etc. etc. Dans une langue à interchangeabilité suffisamment développée, on verrait le même signe fonctionner tour à tour comme préposition ou comme adverbe (cf. certains emplois de of « de = en » et de to « à = y » en anglais).
Les grammairiens qui combattent ces adverbes font souvent intervenir l’argument du « germanisme » (Est-ce que vous venez avec ? < Kommen Sie mit ?, etc.) ; mais il s’agit bien plutôt de coïncidences, car le besoin d’unifier la préposition et l’adverbe est commun à toutes les langues.
Le passage de la conjonction à l’adverbe n’est pas aussi fréquent : Il est venu quand même (l. familière, Z tout de même, néanmoins) ; Pourquoi est-ce qu’il n’est pas venu ? Parce que.
Les cas d’élargissement ou de rétrécissement syntagmatiques étudiés jusqu’à présent portent sur l’échange entre un signe de rapport (verbe transitif, subordinatif) et un terme (prédicat, déterminant). Une étude complète du sujet devrait tenir compte d’autres cas encore ; le plus important est l’interchangeabilité entre le substantif et l’adjectif, ou d’une manière plus générale entre le déterminé et le déterminant.
Tout déterminant peut être transformé en un déterminé par l’ellipse de ce dernier, qui est pour ainsi dire absorbé par son déterminant. Exemples : un (homme) politique éminent, un (soldat) porte-drapeau, le vrai (Z ce qui est vrai), surveiller le mental d’un malade (Z l’état mental), la ligne des avants 218(Z des joueurs avants), etc. Ces quelques exemples montrent qu’en réalité ce n’est pas l’article, malgré l’opinion vulgaire, qui substantive le déterminant ; il ne le fait que par ricochet, en signalant le substantif sous roche.
Il s’agit là du type latin bien connu Post urbem conditam « après la fondation de la ville ». Cf. aussi : Ce succès fort modeste ne l’a pas empêché de continuer ; On a fêté les cinquante ans de la société X (Z le cinquantenaire), etc.
Il y a également substantivation lorsque le déterminatif chaque est suivi d’un groupe déterminant + déterminé : Chaque dix minutes « chaque intervalle de… », chaque vingt mètres « chaque espace de… », etc.
Ces nominalisés, comme les substantivés examinés plus haut, servent simultanément le besoin de brièveté et le besoin d’interchangeabilité, le même signe pouvant fonctionner soit comme un déterminant ou par ellipse comme un substantif, soit comme un déterminatif ou par ellipse comme un nominal.
On pourrait comparer les changements d’étendue étudiés dans ce paragraphe, à l’élasticité physique : un seul et même syntagme se distend et se resserre à tour de rôle ; et mieux encore à la contractilité physiologique, en vertu de laquelle la substance organisée se raccourcit dans un sens pour augmenter de dimension dans un autre et vice-versa : le syntagme qui se rétrécit formellement s’enrichit sémantiquement (par absorption de l’ellipse), et inversement le syntagme qui s’élargit formellement s’appauvrit sémantiquement.220
b) Changements de direction : Conversion.
Un autre type de transposition linéaire contribue également à accroître la maniabilité des signes. Nous désignerons sous le terme de conversion l’ensemble des transpositions qui supposent un changement de direction entre les signes agencés, notamment entre le sujet et le prédicat.
Le passif n’est pas une catégorie sémantique. C’est un simple instrument syntagmatique servant à transposer l’objet en sujet, la signification de la phrase étant censée rester la même : Pierre bat Paul Z Paul est battu par Pierre.
Ici comme ailleurs le phénomène de la supplétion induit en erreur. On prétend par exemple que le verbe avoir n’a pas de passif (Brunot PL 362) ; mais si en effet le passif formel du verbe avoir est inusité ou en tout cas artificiel (être eu par…), c’est qu’en réalité il y a supplétion. Le véritable passif du verbe avoir est, au fond, le tour être à : Pierre a le livre Z le livre est à Pierre. Il y’a cependant une nuance : avoir est généralement suivi d’un régime indéterminé (Pierre a un livre), tandis que être à demande un sujet déterminé (le livre est à Pierre). Nous retrouverons ce « décalage logique » a propos de l’impersonnel : les dieux existent Z il y a des dieux.
Le passif en se, qui constitue un gallicisme admis aujourd’hui par la plupart des grammairiens (la maison se construit, cela ne se refuse pas, etc.), n’est pas l’équivalent exact du passif traditionnel ; il sert à convertir un actif à sujet indéterminé : les maçons bâtissent la maison Z la maison est bâtie par les maçons ; mais : on bâtit la maison Z la maison se bâtit, on dit ça Z ça se dit, on le saurait Z ça se saurait, etc.
Au lieu du passif en se, il arrive que la langue moderne se serve directement de la forme active : les meilleures voitures graissent à la Kervoline, l’huile qui s’impose (Z on graisse…) ; ce corsage boutonne par derrière (Z on boutonne…). Cette tournure, qui réalise l’interchangeabilité complète, 221rejoint le type anglais : the book reads well « l’ouvrage se lit aisément », qui sert également à convertir le sujet indéfini.
La confusion formelle de l’agent et de l’objet 2 favorise évidemment l’économie, mais il ne semble pas qu’elle constitue un échange naturel pour le langage : l’agent et l’objet 2 ne sont pas des catégories grammaticales complémentaires.
Il est naturel de retrouver la distinction entre actif et passif dans le domaine de la syntagmatique condensée : une mère soignant ses enfants Z une mère soignée par ses enfants. Mais au passé la différence est surtout écrite : ayant soigné Z (ayant été) soignée par ses enfants.
Le passif à agent indéterminé peut être condensé dans un participe présent : On tache facilement cette étoffe Z Cette étoffe se tache facilement > Une étoffe tachante. Ce type est très employé (une couleur tachante, voyante, salissante, etc.) et n’entraîne guère d’équivoques.222
Le passif 2 sert à convertir l’objet 2 (datif) en un sujet. On a souvent nié l’existence d’un passif de l’objet indirect. Ici encore, c’est le défaut d’interchangeabilité qui cache la réalité du phénomène : Pierre a donné une pomme à la jeune fille Z La jeune fille a reçu (ou : a été gratinée d’) une pomme de Pierre. Dans certaines langues, le verbe actif et le passif 2 sont à peu près interchangeables ; cf. chinois maì « acheter » Z maí « vendre » et, sans différence de ton : tsié « emprunter » Z « prêter ». Cet idéal se réalise rarement dans nos langues ; cf. le propriétaire a loué l’appartement au locataire Z le locataire a loué l’appartement au propriétaire.
En anglais, la forme du passif 1 sert à exprimer également le passif 2 : The boy promised an apple to the girl Z The girl was promised an apple from the boy ; The boy showed the gentleman the way Z The gentleman was shown the way from the boy.
Ces tournures, correctes ou non, permettent au français de transposer assez facilement l’objet 2 en sujet, et doivent donc être mises à l’actif de l’interchangeabilité.
L’échange entre objet 1 (accusatif) et objet 2 (datif) est lié de près au problème du passif 2. Exemple (avec verbe non-interchangeable) : Il lui a donné une montre Z Il l’a gratifié d’une montre. Là encore, l’interchangeabilité est 223chose toute relative, selon les langues. L’allemand possède dans le préfixe be- un transpositeur assez régulier : Er hat ihm eine Uhr geschenkt Z Er hat ihn mit einer Uhr beschenkt, qui lui permet en même temps d’avoir un passif 2 : Er ist mit einer Uhr beschenkt worden.
Il est curieux de constater que la conversion de l’actif en passif ne peut se faire qu’avec les verbes de relation. Pourquoi n’y aurait-il pas aussi un passif de l’inhérence ? Or le rôle du verbe dit impersonnel est précisément de convertir un prédicat d’inhérence en un sujet : Une maison est là Z Il y a une maison, Quelqu’un est-il ici ? Z Y a-t-il quelqu’un ici ? De l’argent m’est nécessaire Z Il me faut de l’argent, Une parole imprudente vous a échappé Z Il vous a échappé une parole imprudente, Mentir est honteux Z Il est honteux de mentir, Vivre n’est plus possible Z Il n’y a plus à vivre, etc.
Selon la curieuse distribution signalée à propos de la conversion du verbe avoir (Pierre a un livre Z le livre est à Pierre), on dit : la neige tombe, mais : il tombe de la neige, Dieu existe Z il y a un Dieu, etc. Ce décalage logique ne doit pas masquer la véritable fonction de l’impersonnel, qui est d’être le passif de l’inhérence.
Nous n’avons cité dans ces pages que les principaux types de conversion. Signalons pour terminer, la conversion du complément de relation en un sujet : Ses cheveux sont 224foncés Z Il a les cheveux foncés, Ton estomac est faible Z Tu as l’estomac faible, etc.
Le type des adjectifs en de (rouge de teint, belle de taille, faible d’estomac, pauvre d’esprit, etc.), qui semble être une innovation de la fin du XIXe siècle (D’Harvé PB § 45, suppl. § 222), permet de convertir une relation possessive : Elle a le teint joli Z Elle est jolie de teint. Ce type est absolument courant et, bien que la littérature l’affectionne, n’a rien de particulièrement littéraire ; cf. Quand on est bas de vue, dit le cycliste, on porte des lunettes (Trib. de police, G.). On remarquera, si l’on tient compte de l’ensemble, qu’entre les deux termes de la transposition il n’y a pas de véritable différence sémantique (teint joli « inhérence » > joli de teint « relation ») ; elle est compensée par le passage inverse de avoir à être (« relation > « inhérence »).
Suppléments
Après avoir étudié les principaux types de transposition grammaticale, nous indiquerons ici les directions dans lesquelles le problème de la transposition peut être élargi encore.
La coordination est un rapport de sujet à prédicat entre deux phrases indépendantes ou leurs équivalents (termes coordonnés), tandis que la subordination ne forme au contraire un rapport de sujet à prédicat qu’entre les parties d’une seule 225et même phrase. Le critère de la différence entre subordination et coordination réside donc dans la portée des signes, l’élément subordonné ne portant jamais que sur une partie de la phrase, tandis que l’élément coordonné s’applique toujours à une phrase entière. Exemple : Je suis resté chez moi parce qu’il pleut (parce qu’il pleut ne porte que sur le verbe : rester parce qu’il pleut = subordination) / Je suis resté chez moi, car il pleut (car il pleut porte sur l’ensemble de la phrase précédente = coordination).
Le rapport de coordination n’est pas autre chose qu’une sorte d’élargissement de la subordination et l’on peut retrouver dans celle-ci, transportés sur une autre échelle, les principaux mécanismes transpositifs valables pour la subordination ; condensation, transitivation, etc.
La coordonnée-prédicat, ou prédicat psychologique, peut être définie comme un prédicat dont le sujet est une phrase indépendante : Il est parti, c’est malheureux. Par condensation, ce prédicat peut être logé dans un adverbe (« adverbe de phrase ») : Il est parti, malheureusement — adverbe séparé de son déterminé par une pause marquant qu’il porte sur la phrase entière.
Le coordinatif, ou conjonction de coordination, a pour fonction de relier deux coordonnées sujet et prédicat l’une de l’autre. Le coordinatif peut être latent, c.à.d. un signe zéro ou sous-entendu. Dans les coordinations du type Il est parti (,) malheureusement, c’est la pause qui remplit l’office de coordinatif. Pour expliquer la formation du coordinatif explicite et pour comprendre son rôle, il faut faire appel aux notions de condensation et de transitivation.
La formation du coordinatif par transitivation d’une prophrase constitue un cas limite : Ils sont jaloux, pire, ils s’en veulent à mort ; Il ne veut pas se repentir, bien plus, il récidive ; cf. lat. magis → mais. L’adverbe de phrase étant lui-même une prophrase, les deux cas sont au fond identiques.
Le fait que la coordonnée, en français héréditaire, doit subir une inversion, est au fond un de ces nombreux exemples de conformisme grammatical que nous avons signalés dans les parties précédentes du livre : le signe est obligé de varier en fonction du rapport grammatical qui le lie au reste de la chaîne parlée. La lutte contre l’inversion n’est ici qu’un épisode du conflit qui met aux prises le conformisme et le besoin d’invariabilité.
Les phrases coordonnées peuvent être condensées d’une manière plus ou moins étroite en termes coordonnés. Il y a par exemple des groupes coordinatifs (Pierre et Paul sont partis ; Il a examiné, fouillé et retourné tous les tiroirs), des substantifs coordinatifs (père et mère), des adjectifs coordinatifs (rouge-blanc-bleu ; franco-suisse), des ordinaux coordinatifs (le un deux et troisième jours de novembre ; c’est la cinq ou sixième fois qu’il recommence), etc.
Comme on le voit, la coordination asymétrique est fréquente dans le langage courant et cursif de nos jours ; mais il va sans dire qu’on en trouve des exemples tout au long de l’histoire du français.
Quant à l’échange entre subordination et coordination, il est relativement aisé. En principe, le français permet de transformer au moyen d’une simple pause n’importe quel adverbe de verbe en un adverbe de phrase : Il est parti rapidement (subordination) > Il est parti (,) rapidement (coordination). Parallèlement, toute conjonction de subordination peut être transposée en une conjonction de coordination au moyen d’une pause précédente : Il est parti parce que vous l’avez voulu > Il est parti (,) parce que vous l’avez voulu (on voit pourquoi car tend à disparaître de la langue parlée). Dans la langue écrite, la pause qui permet cette transposition est 229signalée soit par une virgule soit par un point (procédé de style) : Il est parti. Rapidement | Il est parti. Parce que vous l’avez voulu.
Transposition discursive. — La transposition telle que nous l’avons étudiée, et telle qu’on la rencontre ordinairement, est un procédé d’ordre mémoriel ; la catégorie de base n’est pas énoncée précédemment dans le discours, mais se trouve logée dans la mémoire. Il y a des cas cependant où le point de départ est dans la chaîne parlée même et vient à être transposé, à l’aide d’une représentation ou d’une ellipse discursives, dans une autre catégorie. Voici quelques exemples de cette curieuse alliance entre la brièveté et l’interchangeabilité.
Considérée du point de vue normatif, la transposition discursive choque en général comme une incorrection des plus grossières. Les gens bien parlants ont de la peine à admettre ce double rôle accordé simultanément à un seul et même signe. Mais du point de vue fonctionnel on aurait tort de voir un fait pathologique dans cette alliance de la brièveté et de l’invariabilité, qui constitue au contraire un des points culminants de l’économie linguistique
Transposition phonique. — Le problème de la transposition comprend tout un aspect phonique, qu’une étude plus complète que la nôtre ne devrait pas négliger. Il s’agit notamment de l’échange entre unités et sous-unités ; selon les cas, le passage de l’une de ces catégories phoniques à l’autre peut supposer un changement de forme ou non : moi / je, toi / tu, lui / il, eux / ils, soi / se, quoi / que, etc. ; mais : 231nous = nous (ex. nous, nous nous amusons), vous = vous (ex. vous, vous vous amusez). On voit que nous et vous, au rebours des autres pronoms, peuvent fonctionner correctement tantôt comme unités tantôt comme sous-unités.
Le français avancé présente des exemples montrant le besoin de supprimer la barrière formelle entre unité et sous-unité : Dépêche-te ! Le passage inverse est plus fréquent ; ainsi dans le type : Je ne sais pas quoi faire, Il ne savait pas quoi répondre, le quoi — normalement une unité — fonctionne en qualité de sous-unité (quoi = quoi, au lieu de quoi / que).
Transposition interlingue. — L’emprunt de mot, et le calque ou emprunt de syntagme, ne sont pas autre chose que des transpositions de langue à langue. D’un point de vue large, on pourrait appeler soit l’emprunt une transposition interlingue, soit la transposition (sémantique ou syntagmatique) un emprunt intralague. Car le besoin d’invariabilité tend non seulement à faciliter le passage des signes d’une catégorie à l’autre à l’intérieur d’une même langue, mais encore à permettre leur passage invariable d’une langue à l’autre : immense sujet, dont nous ne faisons qu’indiquer le principe, et la place dans l’ensemble.
Dans le domaine de la transposition intralingue, le besoin d’économie cherche à créer des signes invariables et mobiles, c.à.d. interchangeables d’une case de l’échiquier à l’autre. Dès lors que l’on considère l’ensemble des langues de grande communication comme un tout unique — et cette considération, au train dont va la civilisation moderne, semble devoir s’avérer — on peut s’attendre à une marche parallèle vers l’invariabilité d’une langue à l’autre : les emprunts et les calques, si fréquents dans les langues modernes (européennes ou non), marquent la préoccupation de créer un vocabulaire de caractère international, formé de signes internationaux.232
Chapitre V Le besoin d’expressivité
Les besoins étudiés dans les chapitres qui précèdent peuvent tous se grouper plus ou moins sous un chef unique : le besoin de communication. Les signes qui servent à la communication doivent être assimilés les uns aux autres et classés en catégories, en même temps ceux qui ne sont pas du même ordre doivent pouvoir être aisément distingués lés uns des autres ; en outre, ils doivent être économiques, c.à.d. brefs et invariables. Mais « la pensée tend vers l’expression intégrale, personnelle, affective ; la langue cherche à communiquer la pensée vite et clairement : elle ne peut donc la rendre que dans ses traits généraux en la dépersonnalisant, en l’objectivant. Plus les échanges se multiplient, plus la communication travaille à l’encontre de l’expression personnelle. » (Bally LV 148).
Examiné du point de vue de l’évolution, le langage présente un passage incessant du signe expressif au signe arbitraire. C’est ce qu’on pourrait appeler la loi de l’usure : plus le signe est employé fréquemment, plus les impressions qui se rattachent à sa forme et à sa signification s’émoussent. Du point de vue statique et fonctionnel, cette évolution est contre-balancée par un passage en sens inverse : plus le signe s’use, plus le besoin d’expressivité cherche à le renouveler, sémantiquement et formellement.233
Bally, Traité de Stylistique Française, 19213.
Bally, Mécanisme de l’expressivité linguistique (LV 139 sv).
Lorck, Die Erlebte Rede, 1921.
Ogden and Richards, The Meaning of Meaning, 19272, chap. VII : The Meaning of Beauty.
Paulhan, La double fonction du langage (Rev. Philos., 1927, 22 sv).
Terminologie. — L’antinomie entre la communication et l’expressivité est bien connue, mais la terminologie diffère d’auteur à auteur : Verstandesrede/Phantasierede (Lorck), langage-signe/ langage-suggestion (Paulhan), symbolic/evocative (Ogden and Richards), etc. — Nous opposerons le signe arbitraire et le signe expressif.
Le besoin d’expressivité n’est pas un besoin simple ; il comporte de multiples aspects. D’une manière générale, on peut distinguer le besoin d’agir sur l’interlocuteur et le besoin de le ménager, c.à.d. le langage actif et le langage passif. Le langage actif embrasse surtout les divers procédés dus à l’exagération ; le langage passif comprend les expressions qui tendent à atténuer la pensée ou le sentiment, les euphémismes, les signes de politesse, etc. Une autre opposition est celle qu’on peut faire entre l’expressivité du langage populaire et celle de la langue littéraire ; leurs procédés sont parallèles, de ce point de vue, et se laissent ramener au même besoin général. — Il va sans dire que dans ce chapitre, qui ne doit constituer qu’une première approximation, on n’insistera qu’incidemment sur ces divers aspects sous lesquels le besoin d’expressivité peut se présenter ; on s’attachera à considérer le phénomène dans sa généralité.
Quand on définit la stylistique comme l’étude du langage affectif, on entend par là d’une manière générale l’étude des sentiments, des émotions, des volontés qui se dégagent des faits de langage. Mais cette affectivité peut être de deux 235espèces. Elle est fortuite lorsqu’elle est dégagée uniquement, et à l’insu du parleur ou malgré lui, par la situation. Ainsi les faits d’évocation de milieux (tels que la prononciation d’un étranger, les termes d’argot échappés accidentellement à un homme de bonne société, la lecture d’un exploit d’huissier, etc.) rentrent souvent dans cette catégorie. L’affectivité par la situation doit être nettement séparée de l’expressivité ; cette dernière, c’est l’affectivité que le parleur cherche à transmettre à son interlocuteur d’une manière plus ou moins volontaire. Tandis que l’affectivité, fortuite, ne relève que de la causalité, l’expressivité suppose au contraire un acte de finalité, c.à.d. un rapport de moyen à fin (de procédé à besoin). La linguistique fonctionnelle ne peut naturellement s’occuper que de cette dernière, qui seule répond à la finalité du signe : le langage simplement affectif n’est pas un langage.
La même opposition peut être formulée en d’autres termes, plus généraux : tout ce qui est affectif n’est qu’un processus, tout ce qui est expressif au contraire est un procédé. La création même du langage — création qu’il ne faut pas chercher à surprendre dans la nuit lointaine des origines mais dans le fonctionnement quotidien de la langue d’aujourd’hui — n’est pas autre chose que le passage du processus au procédé. Un phénomène reste un simple processus fortuit tant qu’il n’a pas été mis, par un acte de volonté du sujet parlant, au service d’un besoin donné. C’est ce qu’a clairement vu M. Grammont à propos des combinaisons de sons expressives : « … Un moyen d’expression n’est jamais expressif qu’en puissance, et ne devient impressif que si l’idée le lui permet et le met en évidence. Sans l’idée qui le féconde et le vivifie, le moyen matériel n’est qu’une possibilité irréalisée. » (Vers fr., 31-2 ; v. Bally LV 277). Ainsi tictac et tinter sont expressifs, tactique et teinter, composés des mêmes phonèmes, ne le sont pas.
La même distinction s’applique naturellement aussi aux oppositions sémantiques. Pour qu’une opposition de ce genre soit expressive, il faut qu’elle réponde à l’intention du sujet parlant d’être expressif, sinon elle reste un pur processus (à moins de correspondre à un autre besoin). Ainsi, parmi les exemples de figures que donne la rhétorique, beaucoup 236ne sont pas des procédés expressifs ou ne le sont plus : une voile (bateau), le pied d’une table, les bras d’un fauteuil, etc.. sont aujourd’hui de simples transpositions (« fausses figures »).
Comment définir le procédé expressif ? On sait que d’après la théorie de Saussure le langage est constitué par un système d’oppositions, c.à.d. d’identités et de différences. Or le besoin d’expressivité tend constamment à remplacer les oppositions usuelles, à mesure qu’elles deviennent automatiques et arbitraires, par des oppositions neuves, chargées par leur imprévu de mettre en éveil l’attention de l’interlocuteur et de faire jaillir chez lui un minimum au moins de conscience. Ces oppositions inédites qui font l’essence du procédé expressif, peuvent atteindre aussi bien la signification que la forme des signes. En résumé, les faits qui constituent le langage expressif peuvent être considérés comme un ensemble de déformations plus ou moins fortes et plus ou moins conscientes que le parleur fait subir au système normal de la langue ; il n’y a donc pas deux grammaires, une grammaire intellectuelle et une grammaire expressive (v. Sechehaye, Structure logique de la phrase, 212).
L’essence de l’expressivité est de jouer avec la norme — sémantique ou formelle — exigée par la logique ou la grammaire normatives. Quand on dit d’un homme : c’est un chiffon, on remplace la notion de qualité demandée par la logique (« il est mou ») par celle de substance ; mais si l’on dit de lui : c’est un ramolo, au lieu de : c’est un ramolli, on ne heurte plus la norme de la signification mais celle du signe.
Les grammairiens protestent souvent contre l’« illogisme » de certaines tournures. Exemple : « Promettre, comme espérer, suppose l’avenir. On ne dira donc pas : Je vous promets qu’il s’est bien amusé ; mais, Je vous assure qu’il s’est bien amusé. Il est vrai que promettre, pour assurer, est une expression familière, citée par l’Académie et employée par de bons auteurs. Elle n’en reste pas moins illogique, promettre signifiant faire une promesse. » (Vincent 141-2). En réalité, promettre pour assurer est une figure, et rejeter une figure comme 237illogique, c’est rejeter toute figure, car toute figure est illogique par définition.
Parleur et entendeur ne sont naturellement pas dupes de ces illogismes et de ces agrammatismes : le contraste entre la signification logique, c.à.d. conforme à la norme de la logique, et la signification illogique, respectivement entre le signe grammatical, c.à.d. conforme à la norme de la grammaire, et le signe agrammatical, constitue précisément le secret de l’expressivité.
A) Expressivité sémantique (figures)
La transposition sémantique et la figure ne doivent pas être confondues ; elles diffèrent par deux caractères importants.
Dans la figure, les deux valeurs sémantiques, le sens propre et le sens figuré, sont associées l’une à l’autre, et d’une manière plus ou moins implicite. La simple transposition sémantique postule au contraire l’oubli (ou, dans le cas de la « fausse figure », le refoulement) du sens premier. Le pronom on fournit des exemples intéressants des deux emplois. Dans des tournures comme Nous on aime le vin, ou : Venez voir : : C’est bon, on y va, le pronom on est une sorte de pronom personnel interchangeable d’une personne à l’autre, et relève de la transposition plus ou moins pure. Dans d’autres emplois, les valeurs propre et dérivée sont au contraire associées l’une à l’autre et forment figure ; tel est souvent le cas lorsque on est substitué à tu ou à vous : On n’a pas été sage à l’école, on est rentrée tard, on ne fait plus ses devoirs, qu’est-ce que cela veut dire, tout ça ?
En outre, et cela ressort en partie de ce qui vient d’être dit, il faut faire intervenir le facteur téléologique, car tout dépend en effet de l’intention du parleur. Si l’on admet que toute opération linguistique est accompagnée d’un jugement de valeur — généralement inconscient — porté sur elle par le sujet parlant, on peut, de ce point de vue, définir la transposition sémantique comme le déplacement « réel » d’un signe d’une valeur à l’autre, et la figure comme l’interversion 238« irréelle » (ludique) de deux significations. Cette attitude des sujets à l’égard des opérations linguistiques qu’ils effectuent devient d’ailleurs consciente en cas d’équivoque : « Comment entendez-vous cela, au propre ou au figuré ? »
Bref, on transpose par commodité, et d’une manière aussi mécanique que possible : la transposition est un instrument au service de l’automatisme grammatical. Si l’on transfigure, c’est au contraire pour frapper l’attention de l’interlocuteur et la tenir en éveil, ce qui oblige les parleurs à des innovations incessantes et les entendeurs à un effort d’interprétation ininterrompu. Mais on aurait tort, évidemment, de croire que ces procédés sont artificiels, comme si l’étude du langage expressif tenait tout entière dans l’énumération des figures de rhétorique et des recettes de style : ces dernières ne sont que la contre-partie littéraire des figures que crée la langue parlée plus ou moins spontanée.
Selon le besoin à satisfaire, l’expression linguistique des catégories de la pensée peut donc différer du tout au tout. S’agit-il du besoin de différenciation, on exprimera autant que possible les valeurs à l’aide de signes distincts (ex. « homme / bêtes » : cheveux / poils, nez / museau, pied / patte, mourir / crever, etc.). S’agit-il du besoin d’invariabilité, on traduira les valeurs différentes par des signes identiques (ex. le nez d’un chien, le pied d’un animal, etc.). S’agit-il d’être expressif, on intervertira à dessein les valeurs (ex. Enlève tes pattes !, Quel vilain museau il a !, Ah il te caresse le poil ?, On finira par tous crever !, etc.).
Nous essayerons ici de passer en revue les principales espèces d’interversions sémantiques que l’on peut observer dans le français familier et dans le français avancé, en étudiant en même temps leur retentissement sur la grammaire. M. Bally a montré « combien ce côté de la théorie grammaticale est encore peu poussé, et quelle étude féconde s’offre à qui veut raccorder systématiquement la grammaire et la logique, plus exactement : les transpositions grammaticales et les échanges logiques. » (LV 171). Quant au classement des faits, nous garderons les rubriques adoptées pour la Transposition sémantique.239
1) La substance
Nous examinerons d’abord les échanges que le besoin d’expressivité fait subir aux divers s variétés de la substance ; ensuite, nous passerons à l’étude des interversions qui se produisent entre la substance et une autre catégorie.
On emploie aussi, dans l’usage plaisant, l’impersonnel en parlant d’une personne ; exemple : Il fait soif !, à quelqu’un qui boit.
Inversement, la langue a de tout temps, et à tous les étages du langage, personnifié les choses de la nature ; l’animation de la nature est un des procédés les plus courants du langage expressif. La poésie en fait un usage constant, mais le langage populaire ne l’ignore pas non plus (cf. un cadavre pour désigner une bouteille vide, les noms d’animaux donnés aux outils, etc.).
L’interversion des notions d’homme et d’animal alimente la plus grande partie des injures et des expressions fortes de la langue familière et populaire : cochon, vache, chameau, bécasse, corbeau (prêtre), singe (patron), etc. Le procédé s’étend naturellement aussi aux attributs de ces notions : « On entend fréquemment dire cuir ou couenne pour « peau », lard pour « graisse », vêler ou fondre pour « accoucher », etc., avec l’intention évidente de comparer l’homme à la bête. » (B 26). Cf. gueule, museau, faites, poils ; crever, etc.
Le même procédé peut d’ailleurs comporter une valeur caritative, car tout dépend de l’intention du parleur. Certains noms d’animaux semblent particulièrement portés à fournir les termes de l’amitié et de l’amour : mon chien, mon loup, mon rat, mon lapin, ma chatte, mon poulet, etc.240
L’interversion des notions d’homme et de plante fournit et des injures (Vous me prenez pour une poire ; Faire le poireau « attendre longtemps, comme un imbécile ») et des termes caritatifs (mon chou, ma vieille branche, sucer la pomme à qn., etc.).
Beaucoup de termes caritatifs reposent en outre sur l’interversion des sexes. C’est par figure, par exemple, qu’on dira à une personne du sexe féminin : mon petit, mon chéri, mon mignon, etc. Le cas inverse, qui est plus rare, frise le sarcasme Dépêche-toi, ma belle ! De même, on peut substituer un suffixe masculin à un féminin, d’où l’expressivité plus ou moins forte des noms propres féminins en -on : Madelon (Madeleine), Louison (Louise), Margot, Margoton (Marguerite), Jeannot (Jeanne), etc. La même figure joue pour les noms communs en -on, corrects pour la plupart : une bougillon, une demoisillon, une frétillon, une graillon, une grognon, une laideron, une louchon, une souillon, une tâtillon, etc. Toute l’expressivité de ces termes repose sur le chassé-croisé entre féminin et masculin, et c’est dans la mesure où celle-ci s’efface qu’ils tendent à admettre le suffixe féminin : une tatillonne, etc.
Le cas classique dans ce domaine est d’ailleurs la 3e personne de politesse : Madame veut-elle…, Monsieur désire-t-il… Cf. : J’ai déjà eu le plaisir de rencontrer ces dames ; Et ces jeunes gens, ils parlent sport, je parie !, etc.
Enfin, le langage populaire emploie bibi avec la 3e personne quand il s’agit de quelqu’un qui se désigne soi-même : Bibi aime bien le bon vin, C’est pour bibi (B).
Dans la langue écrite, l’interversion se fait entre l’auteur et ses personnages ; mais la racine du procédé — comme d’ailleurs de tout procédé littéraire — doit être cherchée dans l’idiome parlé. C’est là ce qui placera le problème dans 242sa vraie lumière (v. E. Richter, compte-rendu de l’ouvrage de Mlle Lips : Herrig’s Archiv, t. 153, 149 sv).
En français, l’article placé devant un nom propre « caractérise » la personne désignée. Cela peut se faire de différentes manières. Devant un prénom par exemple, l’article donne un ton de familiarité : la Louise, la Jeanne, la Marie, etc. Devant un nom de famille, il exprime généralement le mépris, procédé bien connu des polémistes : le Clemenceau, le Caillaux, le Poincaré, etc., … et des concierges : Voilà encore une lettre pour le Martin. La forte expressivité qui se dégage de cet emploi est due à l’interversion des notions de nom commun et de nom propre, ce dernier étant assimilé par figure à un nom commun. On sait que dans le langage populaire et rural, cet usage de l’article avec un nom propre a perdu en grande partie sa valeur expressive.
Un autre groupe de figures consiste à intervertir la substance avec la qualité, la manière, l’évaluation (mode), etc.
On remarquera que le substantif ainsi transfiguré dans le domaine de la qualité s’accompagne volontiers de l’adverbe tout, à la place de très : un style tout nature, il est tout chose, tout enthousiasme, etc.
Il peut y avoir chassé-croisé entre la transposition de l’adjectif en un substantif et la figure qui prend la substance pour la qualité : Pierre est un timide. Autrement dit, l’adjectif, en même temps qu’il est transposé en substantif, est transfiguré en sens inverse dans le domaine de la qualité. Les exemples de ce type sont multiples, et en général corrects (pendant plus ou moins « écrit » : son étude la préférée, les soldats pour qui la mort est la toujours présente, etc.).
Introduction à la linguistique fonctionnelle
O. Funke (sur Marty) : Innere Sprachform, 36 sv, 128 sv ; Satz u. Wort, 83 sv ; Studien zur Geschichte der Sprachphilosophie, 129 sv.
E. Goblot, Traité de Logique, chap. XV-XVI : « Le raisonnement téléologique ».
W. Havers, Die Unterscheidung von Bedingungen u. Triebkräften beim Studium der menschlichen Rede, Germ. Roman. Monatsschrift, 16 (1928), 13 sv.
O. Jespersen, Energetik der Sprache, Scientia 1914 ; Language, 324 sv.
A) Linguistique fonctionnelle contre grammaire normative
1) La fonction opposée à la norme
La distinction du correct et de l’incorrect est une des premières difficultés auxquelles s’achoppe le grammairien qui étudie un état de langue. Qu’appelle-t-on un fait de langage « correct » et, lorsqu’on parle d’une « faute », que veut-on dire par là ?
En somme, ces termes recouvrent des notions assez vagues. Il suffit de penser aux discussions souvent acharnées auxquelles se livrent puristes et grammairiens au sujet de la correction ou de l’incorrection de tel et tel cas litigieux.
Un grand nombre d’auteurs définissent le correct par la conformité avec la norme sociale : « On entend par langage 17correct le langage tel qu’il est exigé par la collectivité, et par fautes de langage les écarts à partir de cette norme — abstraction faite de toute valeur interne des mots ou des formes ». (Jespersen, Mankind, Nation and Individual from a linguistic point of view, 140). Cette conception du correct est la conception normative : est correct ce qui correspond à la norme établie par la collectivité ; et la grammaire qui constate et codifie les règles du commun usage, est dite grammaire normative (sans que d’ailleurs ce terme suppose qu’elle soit impérative, comme si elle cherchait nécessairement et toujours à exercer une pression en vue de leur observance).
Mais est-ce là le seul point de vue possible ? Une autre conception, que nous appellerons la conception fonctionnelle, fait dépendre la correction ou l’incorrection des faits de langage de leur degré de conformité à une fonction donnée qu’ils ont à remplir. Tandis que le point de vue normatif caractérise surtout l’école française (Durkheim) et l’école genevoise (De Saussure), le point de vue fonctionnel est mieux représenté par les Scandinaves : « le plus correct est ce qui, émis le plus aisément, est compris le plus aisément » (Tegnér : Jespersen, livre cité). M. Noreen a proposé une formule analogue : « ce qui, pouvant être compris le plus exactement et le plus rapidement par l’entendeur, peut être émis le plus aisément par le parleur » (ib.).
Il va sans dire — nous y reviendrons plus loin — que la compréhension aisée n’est qu’une des fonctions, multiples et souvent contradictoires, que le langage ait à remplir.
Selon qu’on se place au point de vue normatif ou au point de vue fonctionnel, on tablera donc aussi sur une définition différente de l’incorrect : 1. est incorrect ce qui transgresse la norme collective ; 2. est incorrect ce qui n’est pas adéquat à une fonction donnée (par exemple : clarté, économie, expressivité, etc.). Dans le premier cas, on parlera de fautes ; dans le second, de déficits.
Une des thèses de ce livre sera de montrer que dans un grand nombre de cas la faute, qui a passé jusqu’à présent pour un phénomène quasi-pathologique, sert à prévenir ou à réparer les déficits du langage correct. Partant de faits que le point de vue normatif taxe généralement de fautes, nous chercherons donc, en nous plaçant sur le terrain fonctionnel, à déterminer les fonctions que ces fautes ont à satisfaire. Au contraire, la question de savoir si, et dans quelle mesure, un fait 19donné est correct ou non, ne nous intéressera que d’une manière secondaire : les ouvrages de purisme abondent, sur ce point.
2) La finalité empirique
Les linguistes, hantés de la préoccupation de faire de leur discipline une science aussi rigoureuse que possible, ont toujours marqué une certaine réluctance à l’égard de la finalité. Ils n’osent pas l’aborder franchement ; elle leur semble insaisissable, antiscientifique et presque métaphysique.
Mais tous les savants ne sont pas également réfractaires à cette notion qui de toutes parts s’infiltre dans leur science. Le linguiste allemand Marty a beaucoup insisté sur le rôle joué par la finalité dans le langage (empirisch-teleologische Sprachbetrachtung, tastende Auslese ; v. Funke, livres et passages cités). Bien que ses vues s’appliquent à l’histoire du langage et spécialement à son origine, il ne semble pas difficile de montrer que les forces qui ont présidé à la naissance du langage se retrouvent, en vertu d’une sorte de « création continuée », et sans doute avec un dosage différent, dans le fonctionnement linguistique d’aujourd’hui.
Le dialectologue Gilliéron a orienté la linguistique vers l’étude du besoin de différenciation qui semble dominer dans les parlers populaires : « A tous les degrés, le langage est l’objet de préoccupations où se mêlent à la volonté d’être pleinement intelligible, la conscience de la diversité des parlers individuels ou locaux, le sentiment confus d’une hiérarchie des parlers et des formes, un désir obscur du mieux-dire. » (Etudes de Géographie linguistique, 73-4).
M. Millardet a admis et montré l’existence de cas « où la phonétique semble réagir elle-même, par ses propres moyens et sans sortir de son domaine, contre les dangers que les forces destructives d’assimilation font courir à la langue ». (Linguistique et Dialectologie romanes, 290). « Certaines innovations, qui ont le caractère le plus général et ne peuvent être considérées comme des applications de règles plus ou moins artificielles imposées par une élite ayant la prétention de parler correctement, dérivent, si l’on y regarde de près, d’une 20tendance collective en vertu de laquelle la langue répare instinctivement le trouble que les assimilations, les amuïssements et autres principes d’inertie ont introduit dans son système. » (ib. 300).
L’idée de finalité est donc bien « dans l’air ». Il reste à lui accorder la place exacte à laquelle elle a droit dans les théories linguistiques : Loin de s’ajouter au langage comme un facteur externe, elle en constitue le principe et la raison d’être. La définition même du langage (système de moyens d’expression « destinés à » transmettre la pensée), celle de la phrase (jugement « destiné à » être transmis à l’entendeur), celle du signe (procédé « destiné à » transmettre une signification donnée à un entendeur donné), relèvent du principe de finalité.
Une propriété d’un phénomène est dite fonction quand ce phénomène est agencé en vue de cette dernière ; inversement, un phénomène est dit procédé quand il sert de moyen destiné à satisfaire une fonction donnée. Le signe, la phrase, le langage ne sont pas des processus, engagés dans de simples rapports de cause à effet, mais des moyens, des procédés.
Examinée du point de vue des fautes et des innovations, la finalité apparaît sous deux aspects opposés, quoique solidaires :
a) La sélection.
La sélection se contente d’opérer un tri parmi les faits existants, laissant subsister ceux qui répondent à la fonction exigée, et éliminant les autres. De ce point de vue, les fautes et les innovations de la parole ne seraient que des « propositions individuelles », obéissant à des tendances individuelles, et que la sélection collective accepterait ou rejetterait après coup. Autrement dit, les fautes et les innovations ne passeraient que dans la mesure où elles se trouvent coïncider avec un besoin général, mais cette coïncidence ne serait pas voulue. C’est peut-être ainsi qu’il faut interpréter ce que F. de Saussure disait du caractère toujours fortuit d’un état de langue (CLG 125).
Les linguistes n’ont pas encore insisté suffisamment sur 21le rôle fonctionnel joué dans la vie du langage par l’oubli, qui est la face négative de la sélection. L’oubli ne frappe pas n’importe quel élément ; la mémoire laisse tomber les signes et les formules qui, pour une raison ou pour une autre, sont inaptes à une fonction donnée (élimination des monosyllabes homophones, oubli du sens correct par suite de l’absence de liens formels rattachant le signe à son ancienne famille, oubli de la forme correcte d’un signe par suite de son irrégularité, etc.).
De plus, l’élimination des inaptes peut être plus ou moins consciente et volontaire. Des faits parfaitement corrects autrefois tendent aujourd’hui, pour des raisons quelquefois précises, à être conçus comme incorrects, et sont refoulés (cf. Il a fait un voyage à la Chine ; Il est un avocat ; A cause que, en cas que, dans le cas que).
D’une manière générale, c’est l’oubli ou le refoulement qui donne le champ libre au choix et à la création des procédés destinés à mieux satisfaire une fonction. Car la sélection n’est qu’une des étapes de la finalité ; dans bien des cas, elle se contente de préparer ou d’accompagner
b) L’adaptation créatrice.
M. Goblot a montré (§§ 219, 228 sv) que la finalité comporte toujours un rapport d’au moins trois termes : un terme initial, un moyen ou une série de moyens, et une fin. Le terme, initial ou excitant, né sous l’influence des causes qui compromettent la fonction, fait apparaître le moyen destiné à satisfaire la fin : l’excitant crée la fonction, et la fonction l’organe.
Dans nombre de cas, le fonctionnement du langage relève de la même interprétation. Là aussi, le cycle fonctionnel est constitué par un excitant : les déficits ; un moyen : les procédés ; une fin : les besoins linguistiques. Et de même qu’en biologie l’excitant crée la fonction, et la fonction l’organe, en linguistique le déficit éveille le besoin (d’ailleurs toujours latent) et ce dernier déclenche le procédé qui doit le satisfaire. Nous avons cité plus haut l’équivoque de quila : c’est lui quila fait venir. Une faute assez fréquente aujourd’hui dans le langage populaire consiste à accorder l’auxiliaire faire 22lorsque l’objet est un féminin : c’est lui qui l’a faite venir. Ici, où le besoin de clarté a supprimé toute équivoque, l’incorrect peut être considéré comme un procédé servant à réparer un déficit du langage correct.
Terminologie. — Il va sans dire que de tels phénomènes s’opèrent généralement d’une façon ni consciente ni systématique. La finalité que nous postulons n’est, la plupart du temps, qu’une finalité inconsciente et empirique, agissant dans l’obscurité et comme à tâtons. Aussi le terme de besoin ne devra-t-il pas être pris trop à la lettre.
3) La loi opposée à la règle
Ces cycles fonctionnels (déficits — besoins — procédés) sont-ils impératifs et nécessaires ? Il ne s’agit sans doute que de possibilités. Mais entre ces possibilités, il est loisible d’établir des lois, énonçant que si l’une de celles-ci se produit telle autre se réalisera nécessairement aussi. La tâche de la linguistique est d’expliquer les phénomènes du langage à l’aide de lois constatant des rapports de mutuelle dépendance entre les faits.
Cette conception de la loi scientifique concorde avec les définitions qu’on en donne généralement : Une loi est une dépendance conditionnellement nécessaire entre deux termes (Naville, Classif. des sc., 22) ; Une loi naturelle ne peut être qu’un jugement hypothétique (Goblot § 218) ; Une loi n’est rien autre chose qu’une relation constante entre des faits (ib. § 182).
Formules. — La manière de formuler la loi varie : Si le fait A a le caractère M, le fait B a le caractère N ; Si A a le caractère M, il a aussi le caractère N ; Le degré de M varie avec le degré de N. On peut aussi se servir de la formule de la quatrième proportionnelle A : B = M : N.
Mais la loi ainsi conçue dans le sens constatatif où l’entendent les sciences naturelles, diffère radicalement de la règle grammaticale qui, elle, appartient à un tout autre plan (la conception saussurienne de la loi exposée dans le Cours, p. 133 sv, intéresse uniquement la règle grammaticale). 23Cette dernière est un principe impératif imposé par la contrainte de l’usage collectif et par le grammairien qui en est l’interprète. La règle grammaticale n’a rien de commun avec la loi linguistique ; la première est conventionnelle (θέσει ὄν), la seconde naturelle (φύσει ὄν).
La comparaison avec la vie sociale montre aisément la différence entre les deux ordres. La règle des grammairiens fait pendant aux lois juridico-parlementaires, aux usages et coutumes de la société ; la véritable loi linguistique, au contraire, est parallèle aux lois de la sociologie.
Tandis que le grammairien et le législateur prescrivent et codifient ce qui doit être, le linguiste et le sociologue constatent et enregistrent simplement les rapports de mutuelle dépendance reliant les faits : une Grammaire normative n’est pas un Traité de linguistique, de même que le Code civil n’est pas un Traité de sociologie ni le Code pénal un Traité de criminologie.
En outre, les règles grammaticales et les lois sociales sont limitées dans l’espace et dans le temps. Ne s’appliquant toujours qu’à une société donnée et à une époque donnée, elles changent de société à société et d’époque en époque. Les lois de la linguistique et de la sociologie, au contraire, doivent pouvoir se vérifier toujours et partout.
Enfin, les règles de la grammaire ou de la société peuvent être transgressées et comportent des sanctions plus ou moins rigoureuses et plus ou moins directes, tandis que les lois scientifiques sont intangibles. Cette dernière assertion, il est vrai, n’est exacte qu’en théorie ; mais les exceptions aux lois scientifiques proviennent en réalité de l’interférence des lois entre elles, c.à.d. de la difficulté qu’il y a de constater, à l’intérieur d’un système de valeurs, l’interdépendance de deux phénomènes abstraction faite des autres facteurs qui agissent sur eux.
Sciences normatives ou constatatives. — La dualité entre la règle (norme) et la loi (fonction) pourrait se poursuivre dans d’autres domaines. Ainsi la logique, dans sa définition ordinaire (théorie normative de l’entendement), s’oppose à la psychologie de l’entendement ; la morale s’oppose à la psychologie de réaction, 24la dogmatique à la science des religions, le canon esthétique à la science de l’art, etc.
L’opposition entre norme et fonction d’une part, règle et loi de l’autre, entraîne deux conséquences importantes pour le classement des disciplines.
D’une part, la grammaire normative est une science purement descriptive ; elle décrit les règles du système, sans les expliquer. La linguistique fonctionnelle est une science explicative ; elle prétend expliquer les phénomènes qui constituent le fonctionnement du langage, par les rapports de mutuelle dépendance qui les relient, et, du point de vue spécial qui nous occupe dans ce livre : par les rapports de mutuelle dépendance entre besoins, procédés et déficits. C’est la linguistique fonctionnelle qui devrait expliquer, en dernier ressort, l’existence, le maintien ou le remplacement des règles du système.
D’autre part, la grammaire normative est une discipline spéciale ; elle n’étudie toujours qu’une langue donnée, à une époque donnée : il n’y a pas de « grammaire générale ». La linguistique fonctionnelle, au contraire, est dans chacune de ses démarches une science générale.
B) Linguistique fonctionnelle contre linguistique historique
L’opposition entre description et explication est souvent présentée sous un autre angle particulièrement important. On prétend que l’histoire du langage est seule à constituer une véritable explication, tandis que la linguistique statique ne serait qu’une discipline descriptive.
1) L’explication fonctionnelle opposée à l’histoire
Chez les adeptes de la « méthode historique », expliquer veut dire : découvrir le fait ou la série des faits antérieurs. On « explique » le français père en disant qu’il vient du latin 25pater, on « explique » un tour comme pour l’amour de en le faisant remonter au latin per amorem ou pro amore. C’est le sempiternel raisonnement du « post hoc, ergo propter hoc ».
Grâce à cette méthode, la linguistique historique a sur la linguistique statique l’avantage de prédire à coup sûr, et d’annoncer toujours les événements après qu’ils sont arrivés ; cela fait que tout s’y sait assez bien, et ce n’est pas étonnant.
En réalité, description et statique d’une part, explication et évolution de l’autre, sont des termes qui ne se recouvrent pas. Qu’il s’agisse de phonétique, de syntagmatique ou de sémantique, une succession historique, loin de constituer une explication, est un fait qui demande lui-même à être expliqué. L’histoire n’est donc pas une méthode, mais une simple constatation ou reconstitution de faits.
Au lieu d’établir des successions historiques, la linguistique fonctionnelle, plus modeste, se place d’emblée sur le terrain statique et cherche à expliquer les faits en les ramenant aux fonctions (besoins, instincts, etc.) qu’ils sont censés satisfaire.
En principe, besoin et procédé sont asymétriques. Un procédé ne correspond pas nécessairement à un besoin donné, mais peut obéir à des tendances diverses ; inversement, un besoin peut utiliser plusieurs procédés. Il y a donc, par analogie avec ce qu’on appelle la polysémie du signe, un « polytélisme » du procédé, ce terme désignant la multiplicité des fins qu’un même moyen permet d’atteindre, et inversement (v. Lalande 1047).
Exposant les faits d’une manière déductive, nous partirons des besoins et diviserons notre étude en autant de parties que nous croyons reconnaître de besoins fondamentaux.
Cette méthode présente un double avantage. D’une part, allant du simple au composé, elle permet un exposé plus clair ; les procédés linguistiques sont en effet si variés que partir de ceux-ci pour rechercher les fonctions auxquelles ils répondent serait aboutir au chaos. D’autre part, descendant du principe à la conséquence, elle est aussi plus probante : la possibilité de reparcourir dans le même sens les phénomènes étudiés est l’indice qu’on les a compris.26
Les besoins fondamentaux qui commandent le fonctionnement du langage sont en nombre relativement restreint et varient en somme assez peu d’une langue à l’autre ou d’une époque à l’autre de la même langue. On pourrait les appeler les constantes du langage.
L’Analogie est un des premiers faits qui attirent l’attention de celui qui étudie le langage. F. de Saussure a admirablement montré comment son mécanisme se confond avec le mécanisme même de la parole. Nous verrons cependant que le procédé de l’analogie, ainsi compris, est encore plus vaste que ne le concevait le fondateur de la linguistique statique. Car, si la création analogique ou, ce qui revient au même, le jeu quotidien de la parole, « suppose un modèle et son imitation », les cas si variés qu’on appelle « étymologie populaire », « contamination », « contagion », etc., doivent également ressortir, d’une manière ou de l’autre, au principe général de l’analogie. Et même, prise au sens large, l’analogie est un fait qui dépasse la portée d’un simple procédé. Nous parlerons plutôt d’un besoin général qui tend à assimiler les uns aux autres les signes par leurs formes et par leurs significations pour les ordonner en un système — et nous dirons que ce besoin utilise des procédés variés, tels que l’analogie proprement dite, l’étymologie populaire, etc. (Chapitre I : Assimilation).
La réduction des signes en une masse homogène a sa contre-partie dans le besoin de Différenciation ou de Clarté (Chapitre II). Ce dernier nous fournira quelques-unes des meilleures illustrations de la finalité linguistique (v. l’exemple donné plus haut : c’est lui qui l’a faite venir).
Le besoin d’Economie exige que la parole soit rapide, qu’elle se déroule et soit comprise dans le minimum de temps. De là les abréviations, les raccourcis, les sous-entendus, les ellipses, etc., que la langue parlée présente en si grand nombre (Chapitre III : Brièveté). En outre, pour que les associations engagées dans le jeu de la parole puissent fonctionner avec le moindre effort de mémoire, il faut que le signe ne change 27pas ou change le moins possible de forme en passant d’une combinaison syntagmatique, respectivement d’une catégorie grammaticale à l’autre (Chapitre IV : Invariabilité). Les verbes irréguliers, par exemple, sont un défi à la mémoire (je vais, tu vas, vous all-ez, j’i-rai, que j’aille — en face de : je chante, tu chantes, vous chant-ez, je chante-rai, que je chante). Seules la haute fréquence d’emploi et la contrainte collective réussissent à maintenir de telles anomalies.
Un autre besoin, en grande partie opposé aux précédents, c’est l’Expressivité (Chapitre V). Le besoin d’agir sur l’entendeur soit pour le forcer à tenir compte de ce qu’on lui dit soit pour le ménager, domine tout l’usage de la conversation. Le déficit qui déclenche ordinairement les procédés expressifs est l’usure sémantique ou simplement l’absence de signes suffisamment frappants.
Il faut ajouter que ces besoins tantôt s’associent tantôt se heurtent les uns aux autres. L’harmonie et l’antinomie relatives entre les besoins est un fait dont on n’a pas encore tiré toutes les conséquences, mais qui constitue sans doute le facteur principal de la stabilité ou de l’instabilité des systèmes linguistiques. La stabilité d’une langue correspond à un état d’ « équilibre des besoins », dans lequel aucun de ceux-ci n’est assez fort pour modifier appréciablement le système ; tandis que la direction dans laquelle une langue évolue n’est en fin de compte que la résultante du « parallélogramme des besoins » qui agissent sur elle. S’il est permis de traduire une notion assez précise par un terme vague, cette proportion des besoins linguistiques est au fond ce qu’on appelle le « génie de la langue ».
En attendant des études plus détaillées, nous nous contenterons d’une première approximation pour considérer successivement chacun des besoins comme si son action était indépendante de celle des autres.28
2) Le changement opposé à l’évolution
On s’accorde aujourd’hui à reconnaître que c’est la linguistique du fonctionnement (« linguistique de la parole ») qui forme le pont reliant la linguistique statique ou science des états de langue, à la linguistique évolutive. Mais tandis que pour le système de la langue la distinction entre statique et évolutif tend, après les travaux de Marty en Allemagne et de Saussure à Genève, à être reconnue et admise de plus en plus universellement, son application à l’étude du fonctionnement rencontre des difficultés.
« En pratique, un état de langue n’est pas un point, mais un espace de temps plus ou moins long pendant lequel la somme des modifications survenues est minime. Cela peut être dix ans, une génération, un siècle, davantage même… Un état absolu se définit par l’absence de changements, et comme malgré tout la langue se transforme, si peu que ce soit, étudier un état de langue revient pratiquement à négliger les changements peu importants, de même que les mathématiciens négligent les quantités infinitésimales dans certaines opérations, telles que le calcul des logarithmes ». (Saussure CLG 146).
Il serait utile néanmoins pour étudier le fonctionnement du langage de disposer d’un critère précis permettant de dire dans chaque cas particulier si un rapport linguistique donné appartient au présent ou à l’histoire.
Nous appellerons changement statique, ou changement tout court, tout passage réversible, c.à.d. dont le terme initial peut être spontanément rétabli par les sujets. Dans le cas inverse, nous parlerons d’évolution.
Quelques exemples nous éclaireront. On sait que l’emploi fautif de fortuné au sens de « riche » est très courant aujourd’hui. Mais pour la majorité des sujets le passage de fortuné 1 à fortuné 2 reste réversible : « heureux » = « riche ». Pour un petit nombre d’entre eux, au contraire, le rapport de l’un à l’autre n’est plus saisi et forme par conséquent une évolution, 29c.à.d. le passage d’un fait du passé à un fait du présent : fortuné « heureux » → « riche ».
Lorsqu’une abréviation appartient au présent, le rapport entre le signe plein et le signe abrégé doit être senti spontanément. Ainsi des raccourcis comme perm’, prof’, math’, etc., relèvent de la statique, parce qu’ils se laissent immédiatement ramener aux originels correspondants : permission, professeur, mathématiques, etc. L’explication d’un mot comme dèche, par exemple (être dans la dèche « dans la misère »), appartient au contraire au passé ; les sujets ne savent plus instinctivement que dèche a été un jour l’abrégé de déchéance ou le substantif verbal de déchoir.
Il en va de même pour les figures. Toute figure conserve son caractère dans la mesure où le sens figuré est rattaché spontanément au sens propre, c.à.d. dans la mesure où elle reste statique ; dans le cas inverse, elle perd son caractère de figure pour devenir un signe plus ou moins arbitraire. Des mots comme étrange, stoïque, cynique, etc., ont été des figures : « qui a le caractère de ce qui est étranger, de celui qui appartient à l’école stoïcienne, à la secte des Cyniques » ; aujourd’hui, ces signes sont arbitraires, leur sens figuré n’étant plus compris que par les historiens de la langue.
Pour éviter tout malentendu, il convient d’ajouter que notre définition du statique et de l’évolutif dérive d’une interprétation uniquement psychique de ces faits, qu’il ne faut pas confondre avec la simultanéité et la succession proprement dites, qui sont des notions physiques. Car au point de vue physique tout fait linguistique — une phrase, un mot, un simple phonème — se déroule dans le temps : la statique linguistique n’a rien de commun avec la simultanéité physique. Dans ce sens, on pourrait donc appeler la statique un mode de l’esprit, c.à.d. une manière de concevoir les phénomènes, puisque l’esprit ne semble pouvoir saisir qu’en les immobilisant les faits qui physiquement se déroulent dans le temps.
La linguistique du fonctionnement ne peut être que statique. « La première chose qui frappe quand on étudie les faits de langue, c’est que pour le sujet parlant leur succession dans le temps est inexistante : il est devant un état. 30Aussi le linguiste qui veut comprendre cet état doit-il faire table rase de tout ce qui l’a produit et ignorer la diachronie. Il ne peut entrer dans la conscience des sujets parlants qu’en supprimant le passé. » (Saussure CLG 120). La tâche actuelle de la linguistique est de reprendre les problèmes qui ont longtemps paru comme le fief de la linguistique historique, pour les transposer sur le plan du fonctionnement statique ; car un fait d’évolution reste inexpliqué tant qu’il n’a pu être ramené à un rapport ou à une série de rapports statiques de mutuelle dépendance (= loi).
Rôle du latin. — Une objection souvent présentée par les historiens contre l’étude statique de la langue est qu’il est impossible de comprendre le français sans connaître le latin. Il s’agit naturellement des emprunts du français écrit au latin savant : « … Un Français qui ne sait pas le latin est hors d’état de comprendre les rapports que soutiennent les mots français entre eux. On peut parler, entendre, écrire le français sans savoir un mot de latin ; mais on ne peut se rendre compte des rapports des mots entre eux si l’on n est pas latiniste. » (Meillet, Les Langues dans l’Europe nouvelle, 164).
Cette constatation, d’ailleurs très juste, ne concerne qu’une variété d’un cas général : le rapport entre une langue qui reçoit et une autre qui fournit l’emprunt. Or ce rapport est loin d’être nécessairement d’ordre généalogique, comme entre le français et le latin. Il suffit de penser au grec, pourvoyeur du latin ; à l’arabe, fournisseur du persan et de l’ourdou, qui ne lui sont pas apparentés ; au chinois, réservoir lexical du japonais cultivé, etc.
Le rapport culturel (de langue classique à langue tributaire) ne doit pas être confondu avec le rapport généalogique : Une étude approfondie du français exige la connaissance du latin non pas en tant que ce dernier constitue une étape antérieure de la langue, mais simplement dans la mesure où il lui fournit ses emprunts.
C) Le choix des faits
Une conception linguistique comme celle que nous venons d’exposer oblige à tabler de préférence sur des matériaux qui n’appartiennent ni à la langue normalisée ni au passé de la langue.31
Nous avons donc procédé à une enquête sur le « français avancé », en comprenant sous ce terme tout ce qui détonne par rapport à la langue traditionnelle : fautes, innovations, langage populaire, argot, cas insolites ou litigieux, perplexités grammaticales, etc.
Si l’on admet en effet que la faute assume, dans le jeu de la parole, un rôle fonctionnel, elle aura par là même, pour le linguiste, une valeur documentaire de premier plan. Destinée à satisfaire certains besoins, elle devient par ricochet l’indice de ces besoins et comme l’écran sur lequel vient se projeter tout le film du fonctionnement linguistique.
1) Correct et incorrect
Une exagération courante consiste à croire qu’une innovation commence nécessairement par être une faute. Mais le langage avancé ne comprend pas seulement les faits dûment constatés comme incorrects.
Dans une langue de grande communication telle que le français, où la conscience linguistique est très sensible et où la contrainte collective réprime immédiatement les écarts trop hardis, les besoins se réalisent souvent d’une manière plus heureuse sous forme de procédés détournés — semi-corrects ou corrects — que sous forme de fautes brutales transgressant violemment les règles reçues. Le langage populaire manifeste par exemple une tendance très forte à unifier le radical du verbe. Mais tandis qu’il dit déjà je vas à la place de je vais (cf. je vas, tu vas, il va, on va), j’est pour je suis et j’a pour j’ai sont des formes encore très risquées. En revanche, il construit couramment : c’est moi qui est, c’est moi qui a (de même pour l’auxiliaire : c’est moi qui l’a vu), il n’y a que vous qui peut faire ça, c’est pas nous qui peut y aller, etc. On peut considérer dans ces exemples le tour c’est qui comme une ruse — façon de parler — permettant, là où la solution directe serait trop osée, l’unification du radical.
Comme, dans une langue, l’importance de ces procédés détournés semble croître en raison directe de l’impérativité de l’usage, il est nécessaire de donner à l’enquête une tournure 32aussi large que possible. Pour se faire une idée claire du langage incorrect, il faut non pas le distinguer du langage correct par des caractères arbitrairement choisis, mais l’en rapprocher au contraire, selon ce principe de Claude Bernard que le pathologique n’est que l’exagération du normal.
La sociologie connaît des distinctions analogues. Une innovation sociale ne commence pas nécessairement par une émeute ; la révolution n’est souvent qu’un feu de paille, auprès d’évolutions profondes qui passent inaperçues et dont on n’aperçoit le vrai sens que longtemps plus tard.
2) Mémoire et discours
Pour qu’un besoin linguistique soit général, il doit se manifester dans tous les compartiments du langage, à commencer par ce qu’on peut appeler les deux axes de son fonctionnement : les rapports mémoriels, contractés entre les éléments donnés dans la chaîne parlée et ceux logés dans la mémoire, et les rapports discursifs, que soutiennent les éléments enchaînés le long du discours (c’est ce que F. de Saussure a appelé, avec une terminologie moins précise, la différence entre rapports associatifs ou syntagmatiques : CLG 176 sv).
Nous verrons par exemple que la Brièveté (chap. III) et l’Invariabilité (chap. IV) ne sont pas autre chose que les deux faces du besoin d’Economie, selon qu’il se réalise dans le discours ou dans la mémoire. La même division s’impose pour l’étude d’autres besoins. Ainsi l’Instinct analogique, qui est un fait de mémoire (Assimilation mémorielle) a sa contre-partie dans la discours : l’Assimilation discursive — que nous appellerons le Conformisme — exige que les éléments qui se suivent dans la chaîne parlée s’adaptent étroitement les uns aux autres et varient par conséquent les uns en fonction des autres (et cela, nous le verrons, se manifeste aussi bien dans le Sandhi, ou conformisme phonique, que dans l’Accord entre catégories grammaticales, la Concordance des Temps, etc.).33
3) Grammaire et phonologie
Les besoins généraux qui sont à la base du fonctionnement linguistique ne se manifestent pas seulement dans la grammaire (science des rapports entre signes et significations) ; leur action se prolonge dans tout le domaine de la phonologie (science des phonèmes et de leur combinaison, abstraction faite des significations).
L’instinct analogique, par exemple, intéresse autant la phonologie que la grammaire. Le sandhi n’est que le pendant phonique de l’accord entre catégories grammaticales (accord de l’adjectif avec son substantif, du verbe avec son sujet ; concordance des temps et des modes, etc.). Les faits de différenciation grammaticale ont leur contre-partie dans les divers problèmes concernant la différenciation phonique : délimitation des unités et des sous-unités, dissimilation, netteté de syllabation, etc. La sous-entente d’éléments significatifs provoquée par le besoin de brièveté, et les mutilations de mots et amuissements de phonèmes qui caractérisent le langage populaire, ne diffèrent pas quant au principe. Le besoin d’invariabilité, qui se manifesta principalement dans le domaine des transpositions grammaticales (transpositions sémantiques et transpositions syntagmatiques), présente aussi un aspect phonique, problème délicat que nous effleurerons. De même, il y a une expressivité sémantique (= figures) et une expressivité formelle.
Phonologie et grammaire sont donc parallèles, en ce sens que les besoins qui atteignent les rapports entre signes et significations doivent également se réaliser dans les éléments matériels pris isolément. En outre, comme il est plus facile de constater l’action des besoins en grammaire qu’en phonologie, il y aura avantage à placer l’étude de cette dernière après celle des autres parties du langage. Agencée sur le modèle de la grammaire, elle n’en sera que moins rébarbative.
Bibliographie. — L’interdépendance de la grammaire et de la phonologie a été soulignée par M. Sapir (Language, 196-7). M. Sechehaye a insisté sur la nécessité de faire intervenir l’étude de la phonologie après celle de la grammaire (Programme et Méthodes de la Linguistique Théorique, 131 sv, 161 sv).34
La recherche, faite d’un point de vue fonctionnel, des coïncidences entre mémoire et discours d’une part, grammaire et phonologie de l’autre, est peut-être la meilleure méthode pour démontrer la cohésion des facteurs en apparence si divers qui composent l’unité d’une langue.
Le même problème peut être posé sous un autre angle également important.
4) Langue parlée et langue écrite
Une personne à qui nous exposions notre idée d’utiliser les fautes de français pour la linguistique, nous avait demandé : Quel français étudiez-vous : le français populaire ? le français écrit ? le français de Paris ? celui de Genève ? le français des petites villes ? etc.
Il est évident qu’une enquête portant sur le français avancé doit tenir compte de l’« état-civil » des faits de langage. L’antinomie qui se présente tout de suite est celle entre la langue écrite et la langue parlée, ou d’une manière plus frappante entre la langue littéraire et la langue populaire. Où faut-il chercher le vrai français ? :
… En somme, en fin, en fait, le français, le vrai français, agréable ou non à l’ouïe, commode ou non pour l’expression de la pensée, est par essence celui que parle le peuple. Le peuple de France a créé le français ; il l’a fait, il l’a enfanté en ce qu’il a de véritablement français ; il l’a mené jusqu’à nos jours au point où nous l’entendons aujourd’hui ; et les écrivains et les savants, malgré une très grande influence dans la fabrication des mots nouveaux, n’ont fait que marcher à sa suite. En réalité, le vrai français, c’est le français populaire. Et le français littéraire ne serait plus aujourd’hui, à ce point de vue, qu’une langue artificielle, une langue de mandarins — une sorte d’argot… (B 30-1).
Bien que le latin vulgaire, dont le français est issu, soit évidemment un exemple en faveur de cette thèse, certains sont d’un avis différent :
Le langage littéraire et l’idiome populaire d’aujourd’hui, tout pétri d’argot, sont […]à peu près impénétrables l’un à l’autre. Et s’il y a contagion, c’est du premier sur le second, non le contraire. Quoi qu’en disent certains politiques qui conçoivent encore 35le peuple comme une classe en soi, les gens du peuple sont de plus en plus imprégnés d’âme bourgeoise, et en ce qui nous intéresse, de dialecte journalistique. L’école commence cette action que le journal achève ; et surtout à Paris, la discussion sociale, qu’on peut surprendre n’importe où, en termes nobles, fût-ce le samedi, entre deux prolétaires titubants… (Thérive FLM 58).
Les grandes langues modernes de civilisation ont été façonnées par des élites intellectuelles qui les enrichissent depuis de longues générations (Meillet, Les Langues dans l’Europe nouvelle, 262).
Pour nous cependant, qui nous plaçons au point de vue fonctionnel, la langue parlée formera la base de l’étude ; car les besoins fondamentaux se manifestent le mieux dans la langue parlée, qui est plus spontanée, moins entravée par la tradition que la langue écrite. En linguistique, toute vérité entre par les oreilles, toute sottise par les yeux.
Mais il ne s’agira pas pour cela de renoncer à la langue écrite. L’essentiel est de considérer l’une comme l’autre en fonction d’un petit nombre de besoins, en somme identiques, qui s’y manifestent avec un dosage et des procédés variables.
Voici un exemple qui illustre d’une manière frappante l’identité de principe des besoins qui commandent les deux pôles du français avancé. Soit une phrase correcte : Ce qui importe dans un pays, c’est le nombre. Le français avancé parlé dira : Ce que ça importe dans un pays, c’est le nombre ; tandis que le français avancé écrit aura : Ce qu’il importe dans un pays, c’est le nombre. Or un seul et même besoin est à la base de ces deux fautes ; le besoin d’invariabilité demande que la transposition de la phrase indépendante en une proposition relative s’effectue avec le minimum possible de changements. C’est donc le type de l’indépendante qui dans chaque cas commande la forme nouvelle : Ça importe > Ce que ça importe ; Il importe > Ce qu’il importe.
Par ces sortes de coïncidences, nous tâcherons de montrer que certains faits du français avancé, malgré l’aspect chaotique qu’ils présentent au premier regard superficiel, sont réductibles à des types, dont l’importance dépasse celle des altérations particulières.
De ce point de vue, la langue parlée et la langue écrite, 36par certains de leurs aspects, diffèrent moins qu’on ne le croit ; la différence est davantage dans les procédés mis en. œuvre que dans les besoins. La langue commune, ou langue de grande communication, est définie par le besoin biologique qui en est la raison d’être : la transmission rapide et étendue de la pensée entre le plus grand nombre d’individus malgré leur hétérogénéité. Au sein de cette langue, on peut distinguer la langue courante (parlée) et la langue cursive (écrite). La seconde, qui est surtout la langue des affaires, de la publicité, de la presse, etc., ne diffère de la première que par les procédés. Ce n’est pas un paradoxe de dire que la langue courante est plus proche de la langue cursive que de l’argot, et la langue cursive plus proche de la langue courante que de la langue littéraire et poétique.
Ce sont les journaux surtout qui servent aujourd’hui de pont entre l’écrit et le parlé ; étudiés dans les limites et avec les réserves nécessaires, ils nous fourniront un très grand nombre d’exemples.
Il serait difficile aussi de ne pas tenir compte de l’opinion des puristes et des grammairiens. Notre attitude à leur égard est délicate. Placés sur le plan fonctionnel et non, comme eux, sur le plan impératif et normatif, nous éviterons par cela même toute polémique. En revanche, nous les utiliserons largement à titre documentaire. Beaucoup d’entre eux fournissent en effet de véritables répertoires de faits, qu’il est très utile de consulter (en prenant garde, toutefois, que la majorité de leurs exemples appartient à la langue écrite).
Mieux que les journaux et les puristes, c’est l’enquête parlée et les lettres populaires qui livrent les faits les plus abondants et les plus sûrs. Outre les lettres publiées par M. Van Der Molen et par M. Prein, nous avons pu consulter une partie des lettres parvenues à l’Agence des Prisonniers de Guerre (Comité International de la Croix-Rouge, Genève 1914 sv). Rédigées le plus souvent par des personnes de culture rudimentaire — généralement des femmes du peuple — expédiées de tous les coins de France, ces lettres reflètent assez fidèlement l’état de la langue courante et populaire d’aujourd’hui.37
5) Coïncidences interlingues
L’idéal de la linguistique fonctionnelle serait de poursuivre la recherche des coïncidences non seulement entre les différentes parties d’une langue donnée, mais encore d’une langue à l’autre. Voilà évidemment une tâche de l’avenir, à laquelle on ne pourra pas encore songer ici.
Mais il ne sera pas inutile de terminer cette Introduction par une perspective qui dépasse l’étude présente, en montrant comment notre manière de concevoir la comparaison des langues s’oppose — radicalement — à la grammaire comparée traditionnelle.
Tandis que cette dernière recherche des correspondances de langue à langue, qu’elle interprète en les ramenant à un type ancestral unique dont elles sont le développement, la linguistique fonctionnelle recherche des coïncidences, qu’elle explique en faisant appel à un besoin identique qui les détermine. Deux conséquences importantes résultent de cette opposition.
D’une part, la méthode de la grammaire comparée ne peut être qu’historique et ne peut porter naturellement que sur des langues de même famille, c.à.d. qu’on suppose dériver d’une origine commune. La linguistique fonctionnelle, sans exclure la comparaison entre des langues généalogiquement ou culturellement parentes, a pour exigence idéale la recherche de coïncidences entre des langues qui ne soient reliées ni par des liens généalogiques ni par des emprunts.
D’autre part, la grammaire comparée doit, pour être fructueuse, tabler sur les éléments les plus archaïques et les moins spontanés. La linguistique fonctionnelle, au contraire, ne peut s’intéresser qu’aux faits les plus avancés et les plus spontanés que puisse présenter un état de langue.
6) Coïncidences inter-sémiologiques
6) Une tâche plus vaste et plus lointaine sera la recherche de coïncidences inter-sémiologiques, c’est-à-dire entre les divers systèmes de signes (langage articulé, langage gestuel, art, cultes, rites symboliques, formes de politesse, signaux, monnaies, etc.) dont l’ensemble constitue l’objet de la Sémiologie. Cette science, définie par F. de Saussure (CLG 33), nous dira peut-être 38un jour si les besoins fondamentaux qui sont la raison d’être de tout idiome, ne forment pas aussi la base de tout système de signes.
Telle est la méthode que nous soumettrons, dans ce livre, à une première application.
Arrivé au terme de cette Introduction, le lecteur se demandera peut-être si la linguistique ainsi comprise est encore une science autonome, ou si nous ne retournons pas tout simplement à l’ancienne « psychologie du langage ». On sait que le Cours de Linguistique Générale de F. de Saussure se termine par cette phrase, qui en marque l’idée fondamentale : « la linguistique a pour unique et véritable objet la langue envisagée en elle-même et pour elle-même ».
Mais dès que l’on considère la langue comme un instrument agencé en vue de fins données, la conception saussurienne devient trop étroite. Comment une science pourrait-elle étudier un instrument envisagé en lui-même et pour lui-même ? Nous dirons pour notre part que la linguistique fonctionnelle a pour unique et véritable objet le langage, envisagé comme un système de procédés qui est organisé en vue des besoins qu’il doit satisfaire.39
Interdépendance : assimilation et différenciation
Une langue n’est pas simplement une collection de signes existant chacun pour soi, mais forme un système de valeurs en vertu duquel chacun des éléments est solidaire des autres, c.à.d. dépend de la structure de l’ensemble et ne peut être ce qu’il est que dans et par sa relation avec le reste. Dans un tel système, la création, la modification ou la perte d’une seule valeur entraîne, l’altération des autres valeurs et détermine un regroupement général.
Tout système de valeurs suppose un ensemble d’oppositions formées d’identités partielles et de différences partielles. Les deux besoins opposés, mais solidaires, qui tendent en partie à assimiler les éléments les uns aux autres (chap. I) et en partie à les différencier (chap. II), sont à la base de tout système de signes.41
Chapitre premier Le besoin d’assimilation
Tout fait de langage tend à créer et à s’associer les faits qui peuvent entrer en système avec lui. Le besoin d’assimilation est la forme linguistique de l’instinct d’imitation, facteur tout-puissant dans la vie sociale ; tel ou tel élément, qui s’impose avec plus de force que ses concurrents, fait tache d’huile. C’est dans ce sens que l’on peut parler d’une « force d’imitation inhérente au système lui-même » (Systemzwang).
Selon la séparation du fonctionnement en deux axes établie dans l’Introduction, nous distinguerons l’assimilation mémorielle et l’assimilation discursive.
La première consiste à modifier ou à créer un élément par imitation d’un modèle logé hors du discours, dans la conscience linguistique. On peut appeler cette forme d’assimilation l’Instinct analogique.
L’assimilation discursive, ou Conformisme, oblige les éléments — grammaticaux aussi bien que phoniques — qui se suivent le long de la chaîne parlée, à varier les uns en fonction des autres (Accord, Concordance des Temps, Attraction des Modes, Sandhi, etc.).
A) L’instinct analogique
L’instinct analogique ainsi défini est un principe un qui se manifeste sous des formes variées comprenant, outre l’analogie proprement dite, tous les faits si divers qu’on appelle 43étymologie populaire, contamination, attraction homonymique, etc.
On a voulu séparer l’analogie des autres variétés, en ne reconnaissant qu’à la première un rôle important dans le fonctionnement du langage. M. Millardet a cependant montré qu’il n’y a pas antinomie absolue entre analogie et étymologie populaire. Ce « sont deux phénomènes comparables en ce sens que, sur une forme A, agit une forme B, par suite d’une association d’idées plus ou moins complexe, d’où naît une forme C ». (Linguistique et Dialectologie romanes, 396 sv).
D’autre part, des termes comme étymologie « populaire », contamination, contagion, etc., font trop souvent croire qu’il s’agit de formes essentiellement pathologiques. Cela suppose un malentendu constant, car l’incorrect (point de vue normatif) est loin d’être nécessairement un déficit (point de vue fonctionnel).
Le plus simple sera de distinguer l’instinct analogique selon qu’il agit sur la signification (Analogie sémantique) ou sur le signe (Analogie formelle).
1) Analogie sémantique
2) Analogie formelle
L’action d’un signe sur un autre peut aller jusqu’à substitution complète : Valoir > Falloir (Il faut mieux que vous y alliez : Joran n° 130), Voie > Voix (Ayant appris, par la voix des journaux, que vous vous chargiez de…, APG), etc.48
L’analogie formelle n’intéresse pas seulement le vocabulaire. Beaucoup de fautes de syntaxe s’expliquent par le croisement de deux formules ; il en est ainsi pour la négation explétive et autres faits semblables, d’ailleurs bien connus : La plus formidable facilité qui n’ait jamais été offerte à la clientèle, Elle se gêne avec d’autres qu’avec moi, Racontez cela à d’autres qu’à moi, Il ne l’accepterait de personne excepté de son fils ; etc.
Outre les croisements, il faut mettre à part les cas d’analogie formelle dus au besoin instinctif de classer les signes en un certain nombre de familles plus ou moins logiques. Cet instinct classificateur, base de tout système linguistique, se manifeste sous des formes variées.
Les agences parlent de voyages par Terre, Air, Mer et Fer. Les transports se font par rail ou par route. Les statistiques de navigation opposent le moteur et la vapeur. A la houille blanche produite par les chutes d’eau, est venue s’ajouter la houille verte (rivières et neuves), la houille bleue (vagues et marées) et même la houille incolore (vent). Après l’Internationale rouge, nous avons connu une Internationale jaune, une noire (Eglise), une verte (agriculture), une blanche (réaction), etc.
Cette lutte de la sémantique contre la morphologie se manifeste mieux encore comme une révolte de la logique contre l’illogisme de la catégorie morphologique, dans le « singulier sémantique » — par exemple la revue Les Lectures pour Tous désignée dans le peuple La Lecture pour Tous (B 25 n) — et dans le « masculin sémantique » : Un ordonnance, Un clarinette (Vincent 35), Il a été le dupe dans cette affaire (id. 59), etc.
L’action féminisante de la consonne finale se vérifie aussi pour certains adjectifs. Pécuniaire, interprété comme un féminin (*pécunière), donne un nouveau masculin : L’argument 51Pécunier ne me touche pas (Joran n° 211), Le soldat N. a-t-il souffert d’embarras pécuniers ? (Godet xxv). De même, tiède entraîne un masculin tied (B 94), et inversement bleu un féminin bleuse (ib.).
On aurait tort de considérer tous ces « accidents » comme des cas pathologiques ; ils ne méritent pas tant de dédain. Considérés dans leur ensemble, ils ont leur raison d’être, en ce qu’ils répondent à une tendance organique du système : le besoin de ramener l’inconnu au connu.52
On peut même dire d’une façon générale que la prononciation « correcte » (c.à.d. à l’anglaise, à l’allemande, etc.) des mots empruntés est sentie par les Français comme pédante. 53Qui oserait prononcer knockout, etc. comme les Anglais (nokaut) ?
La francisation des noms propres, fréquente depuis la guerre, se fait soit par traduction (Hirsch > Cerf) soit par assimilation phonique et graphique (Dreyfus > Tréfousse ; Seligsohn > Zéligzon ; Ullmann > Oulman ; Frey > Fret, etc.).
L’analogie sémantique et l’analogie formelle ont pour caractère commun l’imitation d’un modèle prédominant dans la conscience linguistique. Déclenchées l’une et l’autre par la laxité des associations de mémoire qui rattachent un élément au reste du système, elles répondent au besoin de limiter cet arbitraire en motivant l’inconnu par le connu.
Mais le besoin d’assimilation, qui tend à combiner ainsi les éléments du langage en un vaste ensemble aussi homogène que possible, ne borne pas son action aux rapports mémoriels.
B) Le conformisme
Le conformisme embrasse tous les procédés par lesquels le besoin d’assimilation cherche à adapter les uns aux autres les divers éléments, grammaticaux aussi bien que phoniques, qui se suivent le long de la chaîne parlée. La linguistique fonctionnelle ne saurait trop insister sur l’identité de principe qui relie des faits aussi différents en apparence que l’Accord, la Concordance des Temps, l’Attraction des Modes, — et le Sandhi ou Conformisme phonique.
Le conformisme grammatical comprend, outre l’Accord proprement dit par lequel le genre et le nombre de l’adjectif ou du verbe varient en fonction du genre et du nombre du substantif auquel ils servent de déterminant ou de prédicat, tous les procédés à l’aide desquels les signes sont obligés de varier catégoriellement les uns en fonction des autres dans le discours.54
C’est ainsi que le verbe de la proposition subordonnée se règle temporellement et modalement sur la subordonnante (concordance des temps et des modes) : Il doute qu’il soit venu > Il doutait qu’il fût venu ; Je sais qu’il viendra > Je savais qu’il viendrait. Ces modes et ces temps de concordance n’ont pas ici de valeur temporelle ou modale par eux-mêmes ; ce sont de simples procédés d’assimilation discursive.
De même, le subordinatif doit changer de catégorie grammaticale en fonction de son régime, c.à.d. qu’il est préposition devant un substantif (après son départ) et conjonction devant une proposition (après qu’il est parti).
Le déterminant varie d’une manière analogue. Adjectif quand il accompagne un substantif (une chanson gaie), il se transforme en adverbe pour déterminer le verbe : chanter gaiment.
Le conformisme porte d’ailleurs aussi bien sur la coordination que sur la subordination. C’est lui qui exige que deux ou plusieurs termes, s’ils sont coordonnés, appartiennent à la même catégorie grammaticale : Je déteste de boire et de fumer (et non : *Je déteste la boisson et de fumer).
Il y a bien d’autres cas encore. Il faudrait mentionner particulièrement les divers phénomènes d’attraction, par exemple en grec ancien l’attraction du relatif par son antécédent : ἔσεσθε ἄνδρες ἄξιοι τῆς ἐλευθερίας (ἧς) κέκτησθε (Xénophon, Anab., I, 7, 3). Certains dialectes allemands connaissent l’attraction de la conjonction avec le verbe : obst du hergehst, dassen wir kommen, obben wir gehen, obt ihr geht (Gabelentz, Sprachwissenschaft, 214, 398). Mais l’exemple classique en cette matière est fourni par les classificateurs des langues bantoues : « Le classificateur de chaque mot a une telle importance qu’il se répète au cours de la phrase pour tous les mots qui s’y rapportent : on dirait que le mot principal impose la couleur de son uniforme à tous les mots qui dépendent de lui » (Vendryes, Langage, 113).
Le conformisme est donc un procédé général d’assimilation discursive, qui caractérise d’une manière ou de l’autre la plupart des idiomes. Nous examinerons d’après les matériaux 55du français avancé quelques-uns des problèmes qui s’y rapportent.
La question des fautes d’accord peut se poser de deux manières : I. L’accord se fait-il selon la catégorie, et dans ce cas avec le sujet ou avec l’objet ? (on a prétendu que dans le langage populaire l’accord tend à se faire spontanément avec le sujet : Brunot PL 335) ; 2. L’accord se fait-il « mécaniquement », c.à.d. selon la séquence, et dans ce cas avec l’élément qui précède ou avec celui qui suit ?
La fréquence et la similarité de ces faits prouvent qu’il ne s’agit pas de simple lapsus ou coquilles ; on voit aussi par là que l’Accord continue à répondre, même et surtout sous des formes incorrectes, à une tendance spontanée et vivante.
Grammatici certant… — L’imparfait est interprété comme temps de concordance par M. Bally (Germ. Roman. Monatsschrift, 6, 418) et M. Brunot (PL 787). Cette théorie est rejetée par M. Lorck, qui attribue à cet imparfait, conformément au psychologisme qui caractérise l’école romaniste allemande, une valeur sémantique en soi (Erlebte Rede, 45 sv ; v. Neutre Sprachen, 35, 460 sv).
Psychologisme. — On sait combien, pour ce genre de problèmes, l’explication psychologiste est chère aux romanistes allemands, de Tobler à nos jours ; v. E. Lerch, Die halbe Negation im Französischen (Die Neueten Sprachen, 29, 6 .sv). Le besoin d’expressivité a peut-être son mot à dire ici ; mais dans l’ensemble et quant au fond il s’agit surtout d’un phénomène de conformisme : la négation se répète au cours de la phrase pour tous les mots qui s’y rapportent. On peut dire d’elle ce qu’on a dit des classificateurs bantous : elle impose la couleur de son uniforme à tous les éléments de la chaîne parlée.
L’attraction du comparatif formait une tournure correcte en latin : verior quam gratior « plus vrai qu’agréable ». On la retrouve dans le français spontané : Plus il vieillit, plus il est meilleur ; La stabilisation sera faite probablement plus tôt que plus tard (R. Poincaré : Thérive NL 4. 8. 28).59
La syllepse du pluriel est la plus fréquente, mais il y a d’autres cas. Ainsi l’accord peut se faire au singulier et au féminin (Plus des trois quarts de sa population est constituée par la classe paysanne ; all. Das Weib verwandte ihre ganze Kunst darauf). Nous connaissons même un curieux exemple de syllepse d’après le temps : Cette ère de mille ans supposait un Etat puissant (historien).
Le conformisme phonique — ou sandhi (sens large) — est l’assimilation qui se produit entre les éléments phoniques dans la chaîne parlée. Le sandhi, qui comporte de multiples variétés, peut se faire notamment d’après la sonorité (azaziner, tranzvormer, etc.), le mode d’articulation (pendant > pen-n-ant) et le timbre (harmonie vocalique, ex. j’aimais = jèmè, j’ai aimé = jéémé).60
Pour l’étude détaillée du phénomène, nous renvoyons le lecteur aux traités spéciaux. Ce qui nous importe ici est de signaler le parallélisme entre le conformisme grammatical et le conformisme phonique, que le point de vue fonctionnel permet de ramener à un principe un.
L’assimilation discursive exige également que les signes qui entrent en combinaison dans la chaîne parlée, fassent partie du même stock linguistique. Ainsi, un élément appartenant au stock populaire ne peut se combiner qu’avec un élément de même couleur, un élément savant qu’avec un élément savant : règle-ment / régul-ation ; avant-coureur / pré-curseur, etc. (v. Bally LV 203-4). Le même fait s’étend au domaine de la graphie : rationnel / rational-isme, donner / don-ation, consonne / conson-ant-isme, etc.
Ce besoin, que nous appellerons faute d’un terme meilleur le conformisme lexical, est senti très vivement par la langue contemporaine. Nous verrons cependant que l’emprise croissante du besoin d’invariabilité sur les autres besoins et notamment sur le conformisme, tend à faire abandonner l’ancienne réluctance du français pour les hybrides.
L’antinomie entre l’invariabilité et le conformisme éclate d’ailleurs sur toute la ligne. La multiplicité des formes qu’engendre l’assimilation discursive augmente en effet l’effort de mémoire à fournir, et provoque par conséquent des réactions en sens contraire. Selon les idiomes, cette lutte se résout dans la victoire de l’un ou de l’autre des deux besoins. Dans le langage avancé d’aujourd’hui, c’est le besoin d’invariabilité qui semble devoir l’emporter de plus en plus.61
Chapitre II Le besoin de différenciation (clarté)
J. Gilliéron : Pathologie et Thérapeutique verbales, I-IV, 1915-21.
J. Gilliéron : Généalogie des Mots qui désignent l’Abeille, 1918.
J. Gilliéron : La Faillite de l’Etymologie phonétique, 1919.
G. Millardet : Linguistique et Dialectologie romanes, 1923.
Le besoin de clarté cherche à distinguer les éléments linguistiques les uns des autres pour éviter les confusions, latentes ou réelles, qui surgissent dans le fonctionnement de la parole. Ici comme ailleurs, le rapport de finalité est constitué par trois termes : le besoin (clarté), le déficit (confusions, équivoques) et le procédé (différenciation).
Le rôle d’initiateur dans ce domaine appartient à Jules Gilliéron, dont les études sur la Pathologie et la Thérapeutique verbales fournissent la meilleure illustration de la finalité empirique du langage telle que nous la concevons. Il faut avouer cependant que l’effort de ce dialectologue s’est concentré presque exclusivement sur les faits de lexique ; tandis que nous aurons l’occasion de constater que le besoin de clarté porte sur tous les éléments du langage : signe et signification, valeurs lexicales et catégories grammaticales, — jusques et y compris la phonologie.
A première vue, il semblerait que le problème à résoudre consiste simplement à chercher comment le langage s’y prend pour détruire les équivoques existantes ; c’est le point 63de vue de la « thérapeutique ». Une vue plus complète devra tenir compte aussi du rôle très important joué par la « prophylaxie ». Lorsqu’il s’agit d’une langue de grande communication telle que le français, parlée avec moins de liberté et plus de conscience que le patois, et subissant de plus l’influence conservatrice de la langue écrite, il est à supposer que dans bien des cas l’équivoque, dépistée dès qu’elle est sentie sous roche, ne pourra guère monter jusqu’à la surface. C’est ce genre de faits que Gilliéron appelait dans sa terminologie pittoresque les « fantômes lexicaux », les « places gardées », etc. (Abeille, 259 sv) ; nous parlerons plus simplement d’équivoques latentes et d’incompatibilités que le besoin de clarté cherche à éviter à l’aide de divers procédés préventifs.
Dans le livre qu’il a consacré à l’influence du journalisme sur le vocabulaire, M. Vittoz classe parmi « les principaux éléments de conservation de la langue… l’obligation de se faire comprendre, et de se faire comprendre exactement » (181). Et de fait la « clarté française » a toujours été un des principaux arguments des défenseurs de la langue. Mais la question serait de savoir si la langue correcte ne présente pas elle-même des équivoques intolérables et si quelques-unes des innovations que l’on reproche au français avancé ne sont pas dues précisément au besoin de prévenir ou de détruire les équivoques, latentes ou déclarées, que présente le français traditionnel. Dans ce cas le besoin de clarté, par les procédés de différenciation qu’il déclenche, constituerait au contraire un des facteurs du changement linguistique.
A) Pathologie et thérapeutique
1) L’équivoque
Le principal déficit qui amène le besoin de clarté à recourir aux procédés de différenciation, est l’équivoque. Celle-ci peut être constituée, dans le jeu de la parole, soit par la rencontre sur un signe unique de deux ou de plusieurs significations, 64entre lesquelles l’entendeur ou le lecteur devra choisir (= bisémie, polysémie), soit par la ressemblance ou l’identité phoniques de signes incompatibles quant au sens (= homophonie).
On entend soutenir quelquefois que l’équivoque n’existe jamais qu’à l’état d’abstraction, par exemple dans les colonnes des dictionnaires, mais qu’elle ne se produit guère dans l’usage hic et nunc que l’on fait de la langue.
Il suffit de prêter l’oreille au jeu quotidien de la parole — dans la rue, au magasin, au téléphone, à table — pour se convaincre du contraire : J’aimerais acheter des plumes (des porte-plume ou des becs ?) ; Passe-moi la pomme (pomme-fruit ou pomme d’arrosoir ?) ; Les indigènes se sont révoltés (les troupes de couleur ou les autochtones ?) ; On a oublié de mettre le timbre sur cette lettre (le timbre-poste ou l’oblitération ?) ; J’ai vu sé lettres (les lettres de lui ? d’elle ? ces lettres ?) ; Il a permis à séz ouvriers de partir (à ses propres ouvriers ? à ceux d’un autre ? à ces ouvriers ?) ; C’est une vue de loteldülak (une vue de l’Hôtel du Lac ? une vue de l’hôtel à partir du lac ?) ; et ainsi de suite.
Gilliéron a montré l’étroit rapport de cause à effet qui bien souvent lie le monosyllabisme à l’homophonie. En effet, plus le signe est court, et petit le nombre des différences phoniques qui le constituent, plus le danger de confondre ce signe avec d’autres signes soumis aux mêmes conditions augmente. On sait à quels procédés spéciaux les langues monosyllabiques (chinois) et les langues monosyllabisantes (anglais) sont obligées d’avoir recours pour remédier à cet inconvénient : complications phoniques (tons distincts à valeur sémantique et morphologique, aspirations, etc.), complications graphiques (orthographe anglaise, idéogrammes chinois), complications grammaticales (composés formés de synonymes juxtaposés, suffixes et déterminatifs distincts pour chaque homophone différent, etc.). On sait aussi que les signes courts ou monosyllabiques que le besoin de clarté, pour une raison ou pour une autre, n’a pas réussi à différencier, sortent de l’usage, vieillissent et finissent par disparaître.
Nous ne nous éloignerons pas trop du sujet de cet ouvrage 65en énumérant ci-après les principaux monosyllabes qui ont disparu du français ou sont en train de le faire. La linguistique fonctionnelle s’intéresse aussi bien aux moribonds qu’aux nouveau-nés : aux uns, pour découvrir les causes de leur agonie ; aux autres, pour connaître les raisons de leur naissance. « C’est surtout dans la nécropole des mots qu’il faut chercher la vérité biologique [= fonctionnelle]. — C’est par l’étude de ces mots que devrait débuter l’historien de la langue pour asseoir ses connaissances et ses principes biologiques, pour savoir les conditions de vie et de mort des mots : seuls les morts peuvent nous permettre de tracer un tableau d’une vie lexicale complète, eux seuls nous révèlent infailliblement la cause qui les a frappés à mort. » (Abeille, 283-4). Quant aux mots que nous appelons vieillis, « à l’égal des mots disparus du français, ils ont l’avantage d’étaler devant nous une vie lexicale complète, mais une vie encore à son dernier souffle, à l’agonie, et celle-ci est souvent seule à pouvoir nous révéler la cause de leur mort prochaine, et celle-ci que dans les mots disparus nous ne pouvons étudier que d’après les dires de nos aïeux, plus ou moins sujets à caution, dans les mots vieillis nous pouvons l’étudier sur nous-mêmes, sur le vif, en pleine connaissance de leur vitalité déclinante. » (Pathologie et Thérapeutique, III, II).
Cette liste montre que la chute des verbes est provoquée par deux déficits principaux : leur irrégularité, et leur homophonie avec d’autres verbes. Que l’irrégularité n’est pas le facteur principal, les défaillances et l’extinction progressive d’un certain nombre de verbes réguliers, appartenant à la première conjugaison, suffisent à le prouver (cf. celer en face de seller et sceller ; bailler « donner » et bayer « béer » en face de bâiller ; conter en face de compter, ouvrer en face de ouvrir, voyer en face de voir, etc.).
2) Les procédés différenciateurs
Outre la revivification des consonnes finales, d’autres procédés encore peuvent intervenir pour grossir le volume des monosyllabes et différencier les homophones.
C’est ainsi que du verbe haïr, quand ce dernier n’est pas tout simplement remplacé par détester, les trois formes du passé (je tu haïs, il haït) sont transportées au présent (au lieu de je tu hais, il hait).
L’adverbe hier « se distend chez les Parisiens pour paraître avoir plus de corps : le provincial — celui de l’Est du moins — est surpris de les entendre dire hi-er. » (Pathol. et Thérap., IV 11). Cette prononciation est même recommandée : « L’adverbe hi-er a deux syllabes depuis le XVIe siècle, et ne doit pas se prononcer yèr. » (Martinon I 195).71
Pour distinguer la pomme d’arrosoir de la pomme-fruit, il arrive qu’on ferme et allonge l’o : Passe voire la paume pour la mettre à l’arrosoir !
Contrairement aux efforts du français avancé pour l’unification du radical verbal, le futur populaire du verbe trouver est aberrant : je trouvérai, tu trouvéras, il trouvéra, etc. (Martinon I 165, B 119). Cette exception semble attribuable au besoin d’éviter la confusion avec le verbe trouer, par suite de l’affaiblissement graduel de la consonne v en langage populaire : je trou(v)erai > < je trouerai.
On sait depuis les études de Gilliéron (Abeille, 189 et passim) le rôle important joué par les pseudo-diminutifs — diminutifs par la forme mais synonymes — dans la différenciation des monosyllabes homophones : ovis → ovicula → ouaille, auris → auricula → oreille, acus → acucula → aiguille, etc. Dans la langue de nos jours, on dit : un grain de mil, mais : du millet.
D’une manière plus générale, les pseudo-dérivés — dérivés par la forme mais synonymes — remplissent la même fonction différenciatrice. C’est ainsi que le français populaire élargit fin en finition, plant en planton (Wissler 796), etc.
Un moyen beaucoup plus fréquent, c’est le renforcement sémantique, à l’aide de procédés syntaxiques ou morphologiques variés qui précisent le sens du terme équivoque : la Sainte-Cène, un ouvrage de vulgarisation dans le meilleur sens du terme, un ouvrage de haute vulgarisation, etc. ; sa famille à lui / à elle ; ou bien / là où, etc.
Ainsi et et est, dangereusement homophones, sont soumis à un traitement bilatéral. La conjonction et s’adjoint diverses particules qui l’étoffent : vivre et puis mourir, et alors, et ensuite, et maintenant. Plus personne, d’autre part, n’ose dire : Vivre est apprendre à mourir ; le remplacement de est par c’est (sans pause : Vivre c’est apprendre à mourir) est devenu une condition indispensable à l’intelligence de ce type de phrases.
Le dernier cas (de > depuis) est davantage une substitution qu’une explicitation. La substitution est le remède radical qui s’impose toutes les fois que les autres procédés sont inapplicables ou inexistants.
Une maison d’édition publie une Collection de Diffusion, qu’elle appelle ainsi sans doute pour éviter l’import péjoratif du mot vulgarisation.
Le traitement du comparatif plus par la finale (pluss) a été souvent signalé. Mais ce procédé, qui n’est qu’un pis-aller, est senti à la longue comme insuffisant. Le remède radical est dans la substitution du mot davantage : J’en ai davantage, Il a davantage de temps, Il en a davantage que lui, etc.
Le déterminatif quelque n’est plus employé au singulier, dans la langue parlée : quelque personne ferait équivoque avec le pluriel. Mais quelque a trouvé des remplaçants, qui permettent en outre de faire une distinction précieuse, connue du latin : une certaine personne (lat. quidam) / une personne donnée (lat. aliquis), et qui répond à l’opposition des lettres N et X dans les formules scientifiques.
Revivification des finales, renforcements divers, fausse diminutivité, explicitation, substitution, — telles sont les principales armes employées par le besoin de clarté contre l’équivoque. Mais une étude détaillée du problème devrait tenir compte de bien d’autres procédés encore. Ainsi une des fonctions actuelles du genre, catégorie en grande partie inutile au point de vue sémantique, est la différenciation 73des homophones : le père / la paire, le maire / la mère, le livre / la livre, etc. Le pluriel, quand l’idée s’y prête, réussit également : avoir des fonds, payer les frais, etc.
Le chinois parlé, langue où le monosyllabisme fait de l’équivoque une question de tous les instants, a dû se créer des procédés multiples : composés synonymiques, c.à.d. formés de monosyllabes synonymes juxtaposés, déterminatifs (particules numérales) variant pour chaque substantif homophone, tons différents pour chaque monosyllabe homophone, etc. On remarquera que l’accent français, par le fait qu’il porte toujours sur le prédicat, respectivement sur le déterminant, sert entre autres à différencier le déterminatif numéral de l’article indéfini : Donnez-moi une pomme (angl. one) / une pomme (angl. a).
Une étude plus complète aurait encore à mentionner le côté graphique du problème. Le langage, tirant parti des hasards et des artifices de l’évolution, distingue en effet les unités homophones en leur donnant à chacune un « orthogramme » différent : fond / fonds, du / dû, dessin / dessein, conter / compter, différencier (différenciation) / différentier (différentiation), etc. etc. L’analogie de ces orthogrammes avec les idéogrammes de l’écriture chinoise a été entrevue notamment par M. Paul Claudel : « … L’étude de la forme des caractères français me passionne : j’y trouve autant d’idéogrammes qu’en japonais. Le mot toit par exemple est vraiment le dessin de la chose représentée. En écrivant les mots, je pense leur forme… » (NL 4. 8. 28).
Comme l’a signalé dès longtemps M. Bally dans ses cours, c’est dans le besoin de clarté qu’il faut chercher la véritable raison d’être d’une bonne partie des chinoiseries de l’orthographe française. Celles-ci apparaissent dans la mesure où le danger d’homophonie est imminent ou, ce qui revient le plus souvent au même, dans la mesure où le volume des mots se rétrécit. Et ces procédés de visualisation des signes ne répondent pas simplement à une tendance artificielle de la langue écrite. Les auteurs qui connaissent l’écriture populaire 74remarquent « l’habitude d’ajouter des lettres qui n’existent ni en français correct écrit ni dans la prononciation populaire. Car le peuple, lorsqu’il fait des fautes d’orthographe, pèche plus par complication que par simplification ». (B 178).
Certains idiomes marquent à l’égard de ce problème une coïncidence qui n’est pas due au hasard. Les langues monosyllabiques comme le chinois et les langues monosyllabisantes telles que l’anglais et dans une moindre mesure le français, sont réputées pour la difficulté de leur phonétique et de leur orthographe. Le chinois différencie les homophones par le ton, la quantité, l’aspiration, etc. ; l’anglais par le timbre des voyelles, etc. ; le français, par exemple par la série des voyelles ouvertes ou fermées, ou par la riche gamme des voyelles nasales qui font le désespoir des étrangers.
Il s’agit donc d’un conflit entre deux besoins fondamentaux : la trop grande brièveté entraîne des équivoques, que le besoin de clarté corrige par des « chinoiseries » de prononciation et d’orthographe. En figurant la différenciation par D et la brièveté par B, on peut noter le phénomène par la formule D = f(B). Cette loi se vérifie pour le chinois, le japonais savant, l’anglais et, dans une certaine mesure, le français.
Réforme de l’orthographe. — La visualisation du signe est en désaccord avec la lutte pour la simplification de l’orthographe et montre combien cette lutte, pour certaines langues du moins, est artificielle. Aucune des tentatives entreprises tant en Chine qu’au Japon pour supprimer les caractères chinois n’a réussi ; pareillement, les tolérances orthographiques autorisées par l’Académie française depuis 1905 ont échoué, parce que contraires au génie spontané de la langue : « Concessions fort modérées, et cependant encore excessives. Latitude dont ni ceux qui l’ont accordée, ni ceux qui l’ont réclamée, ne songent à se prévaloir. Qui s’avise en effet, malgré la permission officielle, d écrire et dévoument, et confidenciel, et enmener, enmitoufler, enmailloter, et pié, et échèle, et dizième, et sizième, et pous, joujous, chous, genous, etc., etc. ? On s’était persuadé que l’insurrection contre l’orthographe traditionnelle avait tout le pays avec elle : l’événement a tout de suite démontré qu’on n’était en face que de quelques « intellectuels » en mal d’innovation ». (Joran. p. 144).75
Après avoir étudié la pathologie et la thérapeutique linguistiques en prenant comme point de départ le cycle fonctionnel, c.à.d. sous l’angle successif des équivoques et des procédés différenciateurs mis en œuvre pour y remédier, nous allons passer à l’examen d’une série de faits montrant comment le besoin de différenciation se réalise dans tous les principaux éléments du système : valeurs lexicales et catégories grammaticales, signe et signification, mémoire et discours, grammaire et phonologie.
B) Différenciation mémorielle
1) Différenciation formelle
Les cas de différenciation étudiés par Gilliéron concernaient surtout le lexique ; dans la suite, nous insisterons davantage sur la différenciation des catégories. Il arrive souvent en effet que les hasards de l’évolution phonétique et grammaticale finissent par mêler, dans une partie ou dans la totalité de leurs emplois, des catégories grammaticales distinctes. Le besoin de clarté est sans cesse à l’affût pour éviter toute équivoque dans ce domaine.
La langue moderne tend par exemple à ne plus distinguer les finales longues et les courtes, et cela entraîne des confusions entre le singulier et le pluriel (il croit > ikrwa < ils croient) ou entre l’indicatif et le subjonctif (qu’il croit > kilkrwa < qu’il croie). La tendance populaire à ajouter un yod aux formes du pluriel et du subjonctif ne doit pas être étrangère à ce fait : Ikrwa (croit) / ikrway (croient), Ivwa (voit) / ivway (voient), Il n’est pas possible qu’un homme ne krway pas ce qu’il krwa, qu’il ne vway pas ce qu’il vwa, etc.
Outre ces cas, il y en a où l’indicatif fait normalement équivoque avec le subjonctif (sans que cela soit dû à l’évolution 76phonétique moderne). Des formes comme qu’il ouvre, qu’il s’y intéresse peuvent appartenir aussi bien au subjonctif qu’à l’indicatif. Les auxiliaires qui supplantent peu à peu le subjonctif traditionnel peuvent intervenir utilement ici pour faire la différence : Et voici qu’il est question que la mariée doit ouvrir le bal (Thérive FLM 94), Il n’y a qu’un public restreint qui peut s’y intéresser (Van Der Molen 97).
De même, le présent et l’imparfait sont identiques dans certaines de leurs formes : nous croyons > nukrwayõ < nous croyions, et c’est une des raisons qui favorisent l’emploi de on : Nous on croit / nous on croyait.
Une source fréquente d’équivoques, dans tout le domaine de la langue, c’est la fermeture progressive de l’e final (è > é) : L’é fermé de mes, tes, ses, ces, les, des (qui se prononçaient autrefois avec è ouvert) appartient désormais à la « bonne prononciation » ; billet, désormais, excès, gai, geai, jamais, mai, mais, quai, je tu il sait, succès, sujet, etc., sont en train d’installer l’é fermé. Cette évolution entraîne de fâcheuses confusions entre certaines formes de la conjugaison. Le passé simple ne se distingue plus de l’imparfait (je mangeais > imàžé < je mangeai), ce qui crée un motif de plus au remplacement du temps simple par le composé (j’ai mangé). Le conditionnel ne se distingue plus du futur (je mangerai > žmãžré < je mangerais), d’où création et extension de formes de futur et de conditionnel composées : j’aimerais manger, je voudrais manger, etc., opposés à je veux manger, je vais manger, etc. Le passé composé de l’indicatif ne se distingue plus du subjonctif passé (que j’ai mangé > žé < que j’aie mangé), et cette équivoque nécessite la prononciation : que j’aye (ey, qqf. ay) mangé.
Dans la langue écrite, l’homophonie de plusieurs formes du passé et du présent motive la création de passés incorrects : Je jouissai d’avance du supplice que j’allais faire subir à ma victime et je choisissai mon moment (Curnonsky et Bienstock, Musée des Erreurs, 17), Le Conseil fédéral les exclua (Godet XXIII), Il conclua bientôt que… (id. LVII) ; v. B 117. Tous ces cas se rapportent à la langue écrite, ou à la langue parlée de teinte écrite. Pour la langue parlée courante, 77c’est une raison de plus en faveur du remplacement définitif des formes simples du passé par des formations composées.
Une équivoque particulière à la langue parlée a été signalée dès l’Introduction : c’est lui quila fait venir (qu’il a ? qui la ? qui l’a ?). L’accord du participe intervient ici d’une façon heureuse pour distinguer le passé du présent : C’est lui qui l’a faite venir, Il l’a faite manger, La joie l’a faite changer de couleur.
L’évolution phonétique a amené la confusion de certaines formes de l’indicatif passé et de l’imparfait du subjonctif (qu’il aimast → qu’il aimât > < qu’il aima ; qu’il reçust → qu’il reçût > < qu’il reçut ; qu’il fist → qu’il fît > < qu’il fit, etc.). Cette confusion entraîne, dans la langue écrite de nos jours, la création de certaines fautes destinées à différencier ces deux catégories grammaticales : Il n’y avait pas un homme de la caserne qui ne riât aux larmes (Curnonsky et Bienstock, Musée des Erreurs, 17).
La confusion entre le passé simple et l’imparfait du subjonctif est parallèle à celle entre le passé antérieur et le plus-que-parfait du subjonctif : Il eut aimé > < Il eût aimé (cf. surtout les fautes du type : Dès qu’il eût…, Dès qu’il fût…, Après qu’il fût…). On sait que le remplacement du passé antérieur composé par le surcomposé est une simple unification analogique (il eut > il a eu = il eut mangé > il a eu mangé) ; mais l’état de confusion entre le passé antérieur et le subjonctif passé motive d’autant plus ce remplacement.
On sait que dans le français avancé le verbe disparaître ne prend pas l’auxiliaire avoir, ce qui explique l’équivoque de il est disparu « état consécutif à un procès > < procès logé dans le passé ». Il va sans dire que dans ces emplois le passé antérieur, au lieu de fonctionner comme un temps relatif (« passé dans le passé »), sert de temps absolu.
Mais nous ne sommes pas encore au cœur du problème. M. Meillet a montré dans son étude sur la disparition des formes simples du prétérit (Linguistique Historique et Lingu. générale, 149 sv) comment le français parlé a remplacé le passé simple par le composé. Cependant, « il est fâcheux que le français moderne ait réduit à un seul les deux temps passés dont il disposait, le passé défini et le passé indéfini : la différence qui les séparait était réelle, et l’on pouvait en les employant rendre de fines nuances, qui aujourd’hui disparaissent faute d’expression. » (Vendryes, Langage, 411). Quelle était cette nuance ? Les grammairiens s’accordent en général à reconnaître que le passé simple marquait « un fait entièrement achevé à une époque antérieure, plus ou moins déterminée, sans aucune considération des conséquences qu’il peut avoir dans le présent : à telle époque il aima, il reçut, il écrivit. C’est le temps naturel du récit historique ou de la narration ». (Martinon II 347). Le passé composé marquait « un fait achevé à une époque indéterminée, généralement récente, et dont on considère les conséquences dans le présent : j’ai terminé mon travail ; je suis arrivé à mon but ». (ib.). De ces définitions, qui sont complexes, nous ne retiendrons que ce qui nous paraît l’essentiel : le Passé défini marquait le « passé déterminé », le Passé indéfini le « passé indéterminé ». (v. D’Harvé PB p. 262 n).
M. Foulet, à qui nous empruntons la plupart de ces exemples (Romania, 51, 203 sv) a signalé les notions de recul dans le passé et d’indétermination quant à la date que cette forme surcomposée est chargée de rendre. Mais il importe de bien distinguer l’emploi de ce passé comme temps absolu (« passé indéterminé ») ou relatif (Passé antérieur = « passé dans le passé »).
Le français traditionnel distingue le participe présent marquant un procès, du participe pris au figuré comme qualificatif, en accordant ce dernier avec son substantif : Une femme causant (« procès ») / Une femme causante (« qualité »). Mais pour le participe passé, le français traditionnel n’a pas de procédé signalant formellement la différence ; seuls, la situation et le contexte permettent d’établir si un participe passé est pris au sens propre (« état consécutif à un procès ») ou s’il est transféré en un qualificatif.
Les mêmes réactions différenciatrices se constatent dans le domaine des adjectifs de procès, sans cesse guettés par la transformation en qualificatifs : un élément décisif / décisoire, des mesures conservatives / conservatoires, une théorie réfléchie / réfiexive (Lalande 693), un jugement relatif / relationnel, etc. Les adjectifs potentiels négatifs surtout, finissent fatalement par verser dans la qualification (incommensurable, intolérable, intangible, etc. sont employés comme de simples évaluateurs), ce qui oblige le langage à les recréer sans cesse soit dans le parler (pas comparable, pas mesurable ; pas à comparer, pas à mesurer) soit dans l’écrit (non-comparable, non-mesurable…).
Différenciation explicite. — Les langues qui ne peuvent se servir de la séquence distinguent par la forme : Eine neue Methode / eine neuartige M., eine einzige Sammlung / eine einzigartige S., eigene Beobachtungen (des observations personnelles) / eigenartige B. (des o. originales).
2) Différenciation sémantique (bifurcation des synonymes)
En disant que l’équivoque est le principal déficit qui déclenche les procédés de différenciation, nous n’avons tenu compte que d’un côté du phénomène.
Un déficit qui forme la contre-partie de l’équivoque, 83la synonymie, est l’objet de vues contradictoires. On affirme ou nie tour à tour l’existence de synonymes dans le langage. La linguistique fonctionnelle pose la question autrement. Il y a des synonymes, mais cette synonymie étant conçue comme un déficit, le langage cherche à s’en débarrasser. Deux solutions sont alors possibles : ou bien la langue ne conserve que l’un des deux concurrents et abandonne l’autre, ou bien — et c’est ce qui nous intéresse ici — elle conserve les deux en revotant chacun d’une signification distincte (ex. âpreté / aspérité, avoué / avocat, chaire / chaise, col / cou, etc.).
Bibliographie. — Bréal, Sémantique, 26 n. (loi de répartition) ; Erdmann, Bedeutung des Wortes, 28 sv. (Bedeutungsdifferenzierung des Gleichwertigen, Gabelung des Plurals) ; Gabelentz, Sprachwissenschaft, 238, 254 (Entähnlichung der Bedeutungen bei Doubletten).
Quand on n’étudie des signes que leur histoire, il est difficile d’établir dans chaque cas s’il y a eu différenciation formelle ou sémantique (voir les exemples donnés plus haut). Il est donc nécessaire d’observer le phénomène sur le vif, dans les fluctuations de l’usage présent.
Au sens étroit, la bifurcation porte sur les doublets, c.à.d. les formes distinctes d’un signe conçu comme identique. C’est ainsi que recouvrer et récupérer, qui coexistent dès le XVIe siècle, admettent aujourd’hui des emplois distincts : on recouvre une somme due, une taxe, un impôt, mais on récupère ce qu’on a perdu (v. Gilliéron, Abeille, 267). Un acquéreur est celui qui achète pour son propre compte, tandis que l’acquisiteur le fait pour le compte d’une maison (Godet VI, VII).
La bifurcation est un procédé courant de la langue savante. La majeure partie de l’effort terminologique des savants et des philosophes, si l’on fait abstraction des néologismes formels, repose sur la différenciation des synonymes. Pour ne citer qu’un exemple, l’opposition des préfixes négatifs latin in- et grec a-, est souvent utilisée pour distinguer les contraires et les contradictoires : Le génie est a-moral et non immoral, le langage est a-logique et non illogique, etc.
La langue administrative se sert également de la bifurcation. Ainsi la poste suisse ne distingue pas entre une lettre chargée ou recommandée ; en France, l’administration a différencié les deux mots : lettre recommandée (all. eingeschrieben) / chargée « valeur déclarée ».
La bifurcation peut aussi s’exercer sur l’import du signe, dans ce sens que de deux synonymes l’un sera pris en bonne l’autre en mauvaise part, ou que l’un appartiendra à un langage plus poli l’autre moins, etc. Ainsi les couples traditionnels voici-voilà, ici-là, çui-ci – çui-là, ne correspondent plus à la différence entre « proche » et « éloigné », mais à celle entre « relevé » et « populaire ». De même, la formule des magasins est Et avec ceci ?, tandis que sur le marché en plein air on entendra Et avec ça ? ; la numération en centimes (cinquante centimes) est plus relevée que celle en sous (dix sous) ; de suite est plus poli que tout de suite, etc. Cf. mou / mol (sens péjoratif et archaïsant : l’humanitarisme mol) ; fou / fol (un fol adorateur du peuple), etc.
Casuistique. — La manie des puristes et des grammairiens de chercher dans certaines fluctuations de l’usagé des nuances sémantiques subtiles, relève du même besoin que là bifurcation 86des synonymes et n’en est que l’exagération. C’est ainsi qu’ils veulent voir une différence entre je suis allé (« aller simple ») et j’at été (« aller-retour »), entre désirer de (« désir dont l’accomplissement est incertain ») et désirer tout court (« désir dont l’accomplissement est certain »), entre avant que et avant que ne (« sens légèrement dubitatif »), entre après-dîner et après-dînée, etc. etc. Personne au monde n a jamais su où ils prenaient tout cela.
C) Différenciation discursive
1) Différenciation syntagmatique
Bien téméraire celui qui dénierait à la syntaxe moderne des états pathologiques et des états restaurés. Je dirai même : à quand la syntaxe réparatrice ? (Gilliéron, Pathol. et Thérap., III, 55).
La différenciation syntagmatique embrasse tous les problèmes qui se rattachent au degré de cohésion et à la portée respective des signes enchaînés sur la ligne du discours.
Au point de vue du degré de cohésion des signes agencés, il faut distinguer le lexique (signes simples) et la syntagmatique (signes agencés) ; la syntagmatique se divise à son tour en syntagmatique plus ou moins étroite (morphologie) et syntagmatique plus ou moins lâche (syntaxe). Il est important pour la clarté de la chaîne parlée que ces divers éléments soient bien distingués les uns des autres, qu’un syntagme par exemple ne puisse être interprété comme un signe lexical (ex. nous apprenons d’ailleurs / par ailleurs que…), ni un groupe syntaxique comme un composé, etc.
Un des problèmes les plus importants, dans le domaine de la différenciation syntagmatique, est celui du de dit explétif, par lequel le français distingue le prédicatif du simple déterminant : une chambre libre / une chambre de libre. Ce de, qui est à peu près admis aujourd’hui dans certains cas, constitue dans d’autres une incorrection plus ou moins forte.
Les exemples les plus fréquents jusqu’à présent semblent se rattacher à la formule substantif actualisé + de + participe passé (ex. C’est un grand pas de fait). Pourquoi dit-on dans certains cas : un franc perdu, trois livres reliés, et dans d’autres : un franc de perdu, trois livres de reliés ? On a l’impression nette que un franc perdu et un franc de perdu, trois livres reliés et trois livres de reliés, etc., répondent à des valeurs syntagmatiques distinctes. Perdu, reliés sont de purs déterminants, qui s’appliquent à des signes virtuels (franc, livres), tandis que de perdu, de reliés sont des prédicatifs, portant sur des termes actualisés (un franc, trois livres).88
La différence entre prédicatif et déterminant s’accompagne d’une différence dans la délimitation des éléments. Les combinaisons virtuel + déterminant ont une cohésion assez forte : un | franc perdu, trois | livres reliés ; les combinaisons actuel + prédicatif, au contraire, présentent à peu près deux termes : un franc | de perdu, trois livres | de reliés. Les premières se rapprochent, à des degrés infiniment divers, de la composition, tandis que les secondes sont du côté de la syntaxe.
Dans ces trois langues, la place de l’adjectif déterminant est assez rigoureusement fixe. Il sera reparlé de la fin toute différente à laquelle sert la place mobile de l’adjectif français.
Après les nominaux tels que rien, personne, quoi, quelque chose, etc., le de est devenu à peu près obligatoire (quelques-uns condamnent encore personne de et rien de) ; cet emploi ressort de la nature même de ces signes, qui sont des actualisés par définition (rien « pas une chose », aucun « pas un homme », quelque chose « une chose donnée », etc.).
Autres langues. — Ici encore, il ne s’agit pas de subtilités particulières au français, mais d’une différence fondamentale (déterminatif + signe virtuel / nominalisé + actualisé), faite peu ou prou par la plupart des langues.
L’allemand distingue en combinant l’accord et le non-accord : Ich habe eine reife (< eine reife Traube, j’ai une mûre) /… eine reif (< eine Traube reif, j’ai une de mûre).90
L’anglais distingue en préposant ou postposant le représentant one : I have a ripe one (< a ripe grape) / I have one ripe (< a grape ripe).
Mais si en français l’article indéfini est interchangeable avec son nominal, il n’en est pas de même pour l’article défini ; on ne saurait dire *la de libre. La langue parlée a recours, dans ce cas, au démonstratif celui : Je vais vous donner celle de libre « la chambre qui est libre », On mettra de côté celles de véreuses « les pommes qui sont véreuses », etc. La formule est donc : une libre / une de libre = la libre / celle de libre.
Dans beaucoup de cas, le français correct ne peut se débarrasser de l’équivoque. Ainsi, un Monument aux morts pour la patrie, est-ce un monument aux morts dédié à la patrie, ou un monument érigé en l’honneur de ceux qui sont morts pour la patrie ? Le français est ici vraiment à un point tournant, si l’on considère les nombreux cas de syntagmatique équivoque appartenant à ce type ; le sujet vaudrait une étude détaillée, et les observateurs du langage spontané devraient guetter tous les procédés mis en œuvre par le langage avancé pour tourner la difficulté.
Il arrive que la liaison serve correctement à différencier 91les deux formules : Un marchand de drap(s) anglais / un marchand de draps-z-anglais (Martinon I 377), une fabrique d’arme(s) anglaise / une fabrique d’armes-z-anglaises (id. 380). Mais il faut bien avouer que ce procédé est actuellement plus que fragile.
Pour bien saisir la valeur de ce procédé, il ne faut consulter naturellement que l’oreille et faire abstraction de l’écriture. Bref, la recherche des moyens par lesquels le langage essaye de différencier la portée respective des signes agencés dans le discours, devrait être poursuivie dans tout le domaine de la grammaire syntagmatique. Cf. 26 dossiers de 2000 numéros (total) / 26 dossiers à 2000 numéros (chacun) ; elles sont toutes différentes (all. alle) / elles sont tout différentes (all. ganz), etc.
Une autre face du problème est ce qu’on peut appeler la différenciation séquentielle. Si le langage ne se servait de procédés spéciaux pour signaler l’inversion — notamment l’accent et l’usage de séparatifs — il serait difficile souvent de savoir si tel syntagme représente la séquence normale ou constitue une inversion. Dans les deux types : C’est un bijou que cet enfant ! (inversion expressive de : Cet enfant est un bijou !) et : un bijou d’enfant ! (inversion expressive de : un enfant bijou !), l’inversion est signalée par l’accent, qui 92porte sur le prédicat, respectivement sur le déterminant originels (bijou), et par les séparatifs de et que.
Un type d’équivoques fréquent porte sur la difficulté de déterminer le sujet d’un infinitif-régime. En principe, la règle héréditaire exige que le sujet de l’infinitif placé après un verbe soit le même que celui du verbe qui régit cet infinitif : J’espère venir demain = J’espère que je viendrai demain.
Mais la langue actuelle marque une telle préférence pour l’infinitif (en général aux dépens du subjonctif) qu’elle l’emploie même lorsque le sujet du verbe subordonnant et le sujet de l’infinitif subordonné sont différents. « L’emploi de l’infinitif est tellement commode, il allège tellement les phrases où il se trouve, qu’on en use volontiers même pour renvoyer à un complément, pourvu qu’il n’y ait aucune équivoque possible : le roi l’a choisi pour commander ; les électeurs l’ont nommé pour faire leurs commissions. On peut même dire, en renvoyant à un sujet indéterminé : pour faire sa fortune, le théâtre vaut mieux que le roman ; la marche est excellente pour s’entretenir en bonne santé ; ceci est excellent pour manger ou pour boire. Mais on voit sans peine le danger de cette syntaxe, et on sait que le français évite volontiers l’équivoque. » (Martinon II 447).
Le français avancé évite toute confusion dans ce domaine par l’insertion du pronom personnel entre la préposition pour et son régime l’infinitif : Va chercher le journal pour moi lire. Au premier abord, cette construction semble du petit-nègre ; mais elle est si bien attestée que son existence est hors de doute.
Bibliographie. — B 124. — Thérive FLM 47. — Marouzeau, Linguistique, 74. — D’Harvé PB, suppl. belge, § 171. — Prein, 15-6. — Van der Molen, 107-9, plus qqes ex. dans les lettres de mineur de l’Appendice.
Le participe présent entraîne les mêmes équivoques que l’infinitif et, parallèlement à lui, des procédés différenciateurs analogues : Mes parents vous ayant écrit, mais moi n’étant pas très bien avec, je ne sais ce que mon frère devient (APG).
Ce type, caractéristique de la langue cursive, est un latinisme déjà ancien, qui semble aujourd’hui admis.
Tous ces procédés, plus ou moins parallèles — pour moi écrire, moi voulant écrire, la lettre par moi reçue — ont leur origine dans la langue du droit et de l’administration : …Et lour donna rentes pour elles vivre (Joinville : Van Der Molen 108) ; Item, le 4e de feuvrier, vint Gargantuas loger en la sala et pour deux jours, tant de son cheval que dépance par lui faite, V sols (Registre des comptes, XVe siècle : D’Harvé PB § 359). De fait, la langue juridico-administrative est caractérisée par la place prépondérante accordée au besoin 95de clarté et aux procédés de différenciation qu’il déclenche ; ce qui achève de démontrer le parallélisme de ces diverses constructions.
2) Différenciation phonique
La phonologie mémorielle et la phonologie discursive sont soumises l’une et l’autre au besoin de clarté.
D’une part, dans les rapports de mémoire, les phonèmes doivent être suffisamment distincts pour qu’on ne les confonde pas entre eux. D’autre part, les éléments phoniques enchaînés sur la ligne du discours doivent être eux aussi nettement différenciés les uns des autres.
Nous laisserons de côté la différenciation mémorielle, question délicate qu’il faut réserver à des études spéciales, — pour ne considérer que l’aspect discursif du problème, sur lequel le français avancé fournit des renseignements plus abondants.
a) Délimitation.
Il est arrivé que des linguistes, tirant argument de ce fait, ont voulu nier « l’unité psychologique du mot ». Mais à défaut d’une correspondance exacte entre la séparation des syllabes et la délimitation grammaticale, telle qu’elle se rencontre dans les langues monosyllabiques, les procédés variés par lesquels les divers idiomes cherchent à séparer la finale du mot de l’initiale du suivant, et l’initiale du mot de la finale du précédent, semblent indiquer que la « conscience du mot » est bien une réalité linguistique.96
Tout problème de délimitation (discours) est d’ailleurs lié à un problème d’identification (mémoire). Ainsi le fait qu’en français la séparation syllabique et la délimitation grammaticale ne correspondent pas, amène une multitude d’inconvénients ; le calembour n’est pas un des moindres : Il est trop osé (> < trop posé), Il a une tentation (> < une tante à Sion), Ah non (> < ânon), etc.
Quels sont les procédés employés par le français pour faire coïncider la coupe de syllabe avec la limite de mot ?
Un procédé courant, et d’ailleurs à peine perceptible, est la non-liaison. Un syntagme comme avoir honte, par exemple, pourra se prononcer « syllabiquement » (a-vwa-rõt), ou au contraire « grammaticalement » (a-vwar-õt). Telle est la vraie raison d’être de l’h dit aspiré, qui est en réalité un séparatif destiné à faire correspondre la coupe de syllabe avec la limite de mot ; le langage populaire tend à l’étendre : un | huissier (B 44).
Dans quelques cas, le français avancé va encore plus loin et favorise la coupe des mots par l’insertion de consonnes 97séparatives : un vhuissier, de la vouate, une choupette (houpette à poudre, B).
De même, -tier a supplanté -ier (lait-ier → lai-tier), -ter a remplacé -er (abri-er → abri-ter), et ainsi de suite. Pareillement, « pour la conscience linguistique actuelle, le signe du futur est -rai et non plus -ai » (Bally LV 74) : J’aimer-ai → j’aime-rai.
Les changements de délimitation amenés par la tendance à l’initiale consonantique sont particulièrement visibles dans les groupes article + substantif. Deux cas sont possibles.
(Tous ces faits sont des accidents. Mais la sélection linguistique conserve de tels accidents, lorsqu’ils répondent à la tendance du français vers l’initiale consonantique. C’est à cette conservation par sélection que nous devons des mots comme lendemain, lierre, lingot, loriot, luette et tante).99
b) Dissimilation.
Tout au plus peut-on noter certaines préférences. Le français évite autant que possible la rencontre des k, en contact ou à distance. C’est à cette réluctance que nous devons la perte de formations telles que dans le cas que et au cas que ; dans le cas où et au cas où sont, au fond, des dissimilations.
Dans la langue de nos jours, on a recours aux procédés les plus divers pour éviter les rencontres de k. Ainsi, comme on ne saurait dire : *J’aime mieux qu’il s’en aille que qu’il reste, on a la tournure : J’aime mieux qu’il s’en aille que s’il reste. (D’autre part, on dit assez correctement, pour éviter la répétition de deux si : Si vous travaillez et que quelqu’un vient vous déranger…).
La dissimilation, sous ses diverses formes, porte naturellement aussi sur les répétitions de voyelles. Une des phobies du français, par exemple, c’est la répétition de plusieurs e muets : *Jə nə mə lə suis pas rappelé ; d’où la thérapeutique : Je (ne) m’en suis pas rappelé, appuyée sur l’analogie de je m’en souviens.
c) Netteté de syllabation.
« La tendance à alléger autant que possible la syllabe en supprimant les éléments qui entravent le mécanisme normal des explosions et des implosions successives, n’est pas illusoire. Sans aller aussi loin que l’arabe qui n’admet pas le contact de deux consonnes à l’intérieur de la même syllabe, les idiomes romans tendent plus ou moins nettement à réaliser un type de syllabe satisfaisant à la fois le sens articulatoire et le sens acoustique par une gradation aussi nette que possible des apertures. » (Millardet, 317).
Cette tendance différenciatrice qui cherche à rendre la syllabation aussi nette que possible, se manifeste sous deux formes principales, le besoin d’éviter les blocs de consonnes et celui d’éviter les rencontres de voyelles (hiatus).101
La prosthèse est particulière aux groupes ouvrants s + occlusive + phonème d’aperture plus élevée (ex. sta-, spé-, etc.). Ces groupes, par la succession d’apertures qu’ils présentent (1+o + phonème d’aperture plus élevée), sont en effet contraires à une bonne syllabation (principe des apertures régulièrement croissantes dans les groupes ouvrants, régulièrement décroissantes dans les groupes fermants : Saussure CLG 88 sv). La prosthèse a pour but de transformer l’s en une fermante suivie d’une limite de syllabe : scu-tum → is-cutum (→ escu → écu) ; spi-ritum → is-piritum (→ esprit). Exemples actuels : u-nəs-tatue, u-nəs-tation, etc. Cette prononciation est taxée de méridionale.
Il faut bien avouer d’ailleurs que le traitement des blocs de consonnes par l’insertion d’un e dit muet est entravé de plus en plus dans la langue de nos jours par la chute générale et progressive de cet ə même dans les cas où la netteté de syllabation exigerait son maintien. « Il nous paraît que les Français sont en train d’acquérir peu à peu une plus grande aptitude à prononcer des groupes de consonnes qui étaient autrefois réservés aux gosiers germaniques. Les gens qui, à l’heure actuelle, prononcent tout naïvement une estatue, une estation, excitent la risée des Français qui ont passé par l’école… Mais les modernes peuvent dire sans broncher, non seulement : un’ statue, mais : un’ grand’ statue, tourn’-toi, rest’-là, un’ solid’ structure, etc. » (Nyrop, Manuel phonét., § 92).102
En dernier ressort, quand aucun des moyens indiqués n’est applicable, c’est le besoin de brièveté, toujours à l’affût, qui intervient pour supprimer la difficulté phonique, en faisant tomber l’une ou plusieurs des consonnes en présence (amuissement).
Les blocs de consonnes ont leur contre-partie dans les rencontres de voyelles ou hiatus.
Le cuir, ou insertion d’un t, est beaucoup moins fréquent que le velours : Il va-t-et vient, Il faudra-t-aller (B 57), I va-t-en ville.
On sait que la langue de la poésie garde l’ancienne prononciation vocalique : ambiti-on, délici-eux, di-amant, passi-on, etc. Lorsque la seconde voyelle est moins ouverte que la 104première, la consonification atteint la seconde : abbaye > abèy (B 54).
Souvent d’ailleurs, il y a plutôt diminution d’aperture que consonification véritable : Agr(i)able, p(u)ète, c(u)incidence, (u)asis.
Citons pour terminer, le cas où l’hiatus est éliminé à la faveur de synonymies grammaticales : fainéant > feignant ; au hasard de la fourchette > à l’hasard de la fourchette (Martinon I 249) ; il n’a été fait d’exception pour personne (Joran n° 84).
Et là encore, comme pour les blocs de consonnes, c’est l’amuissement (dont il sera reparlé) qui a le dernier mot quand aucun autre procédé ne réussit.105
Économie : brièveté et invariabilité
Le besoin d’économie, bien qu’il puisse être tenu en échec par des influences opposées, est un facteur indéniable dans la vie du langage.
Pour le parleur et l’entendeur pressés, le jeu de la parole et de l’interprétation doit se dérouler aussi rapidement que possible. Le parleur abrège ou supprime plus ou moins inconsciemment tout ce qui dans une situation donnée va de soi, c.à.d. tout ce qui, étant connu de l’interlocuteur, forme le fond commun de leur conversation. L’entendeur, de son côté, au lieu de soumettre la parole de son interlocuteur à une analyse serrée, cherche à comprendre avec le minimum d’effort et de temps.
L’économie linguistique se manifeste sous deux aspects opposés, selon qu’on la considère dans l’axe du discours ou dans celui de la mémoire. Le besoin de brièveté (chap. III), ou économie discursive, cherche à abréger autant que possible la longueur et le nombre des éléments dont l’agencement forme la chaîne parlée. Le besoin d’invariabilité (chap. IV), ou économie mémorielle, cherche à alléger autant que possible l’effort de mémoire à fournir, en conservant toujours la même forme à un élément linguistique donné, malgré la variété des combinaisons dont il est amené à faire partie.107
Chapitre III Le besoin de brièveté
Bally, Copule zéro et faits connexes (Bull. Soc. Lingu. 23, 1 sv).
Brunot PL 63 sv (nominaux), 171 sv (représentants).
Nyrop IV § 77-97 ; V § 10-28.
Saussure CLG 248 sv (agglutination).
A) Figement (brachysémie)
Le mécanisme de la brachysémie ou brièveté sémantique, qui est le figement d’un syntagme, c.à.d. d’un agencement de deux ou plusieurs signes, en un signe simple, a été décrit par F. de Saussure sous le terme d’agglutination ; celle-ci « consiste en ce que deux ou plusieurs termes originairement distincts, mais qui se rencontraient fréquemment en syntagme au sein de la phrase, se soudent en une unité absolue ou difficilement analysable ». (CLG 249). Exemples : ce ci → ceci ; tous jours → toujours ; dès jà → déjà, etc. « Cette synthèse se fait d’elle-même, en vertu d’une tendance mécanique : quand un concept composé est exprimé par une suite d’unités significatives très usuelle, l’esprit, prenant pour ainsi dire le chemin de traverse, renonce à l’analyse et applique le concept en bloc sur le groupe de signes qui devient alors une unité simple. » (250).
Le phénomène présente deux faces successives, une face sémantique et une formelle, qu’il importe de bien distinguer. Au point de vue sémantique, la brachysémie est le remplacement d’une suite de deux ou plusieurs significations 109par une signification unique ; au point de vue formel, l’ancien syntagme, considéré désormais comme trop long en tant que signe simple, est soumis après coup aux effets de l’agglutination matérielle (abréviations, mutilations, etc.). Ainsi bonhomme, avec son pluriel correct bonshommes, est figé dès longtemps, tandis que l’agglutination matérielle qui consacre ce processus n’est qu’une innovation récente (des bonhommes). Il va sans dire que si la science se donne la liberté de dissocier les phénomènes, comme nous le ferons ici, pour les étudier séparément, dans la réalité concrète les deux aspects — brachysémie et brachylogie — sont trop solidaires pour se concevoir séparément.
Les principaux indices de la brachysémie sont la difficulté des substitutions partielles et, corrélativement, la facilité des substitutions totales. Ainsi bon marché est partiellement figé, car d’une part il est difficile de substituer mauvais marché, etc., et d’autre part il devient d’autant plus facile de substituer des synonymes (économique, etc.) ou des contraires (cher, etc.).
De même, la facilité de déterminer globalement et la difficulté de déterminer partiellement, sont aussi des indices corrélatifs. Dans des exemples populaires tels que : c’est plus bon marché, une marchandise plus bon marché qu’une autre, trop de bonne heure (Joran n° 289), le qualificatif s’applique à l’ensemble du bloc (au lieu de meilleur marché, de trop bonne heure).
Dans tous ces exemples, l’incohérence et le pléonasme sous roche ne percent qu’à l’analyse, et c’est précisément l’oubli du sens des éléments constitutifs du syntagme qui rend ces fautes concevables.
L’accord fautif peut être également un indice de brachysémie. Dans une phrase comme : elle a l’air méchante, l’accord, aujourd’hui toléré, signale le figement de avoir l’air en un verbe transitif d’inhérence : « elle paraît méchante ». Cf. Ces deux choses n’ont rien de comparables (n’avoir rien de > « n’être nullement »). Inversement, le non-accord des éléments bloqués sert à son tour d’indice : Elle s’est fait fort de réussir.
Bien que le figement ne soit pas directement un procédé, mais un processus, la finalité y a son mot à dire, car ce processus dans l’ensemble ne s’attaque pas à n’importe quels syntagmes, mais de préférence à ceux qui pour une raison 111ou pour une autre sont difficilement analysables, donc déficitaires.
La condition essentielle qui domine toute brachysémie est en effet, nous le savons déjà, l’incompréhension plus ou moins forte des éléments. Cette incompréhension se produit notamment lorsque l’invariabilité est en défaut, c.à.d. lorsque la mémoire ne parvient pas à rattacher les éléments du syntagme au reste du système, puisque l’entendeur tend toujours à interpréter les syntagmes en les ramenant à l’usage le plus communément reçu.
Le figement, considéré de ce point de vue, constitue donc un cas limite de la finalité (sélection par élimination des inaptes). Il s’attaque de préférence aux formes fossiles, qui, ne se laissant pas rattacher au reste du système, sont difficilement analysables. Exemple : Cette information s’est avérée inexacte (l’alternance vrai/ver- est un défi à la mémoire).
Le figement bloque naturellement de même manière les syntagmes qui résistent à l’analyse par le fait qu’ils sont empruntés à une langue étrangère : bifteck de veau (← beef-steak « grillade de bœuf ») ; five o’clock à toute heure, etc.
Après ce regard jeté sur la Brachysémie, ou brièveté sémantique, nous allons considérer la Brachylogie proprement dite, ou brièveté formelle, qui peut être obtenue à l’aide de deux procédés principaux : la représentation et l’ellipse.
B) Représentation
Au lieu d’énoncer les mots et les syntagmes tout au long de la chaîne parlée, l’esprit cherche sans cesse à les représenter à l’aide de signes plus brefs et plus maniables.
Le cas classique de la représentation est fourni par les pronoms. La grammaire traditionnelle désigne sous ce terme « un mot qui tient la place du nom » : Pierre est parti, mais il reviendra. M. Brunot a élargi d’une manière heureuse cette conception étymologique du pro-nom. « Le mot pronom, comme il a été employé, donne des idées fausses. On l’a appliqué à des mots qui remplacent tout autre chose que des noms. Ils représentent des adjectifs : belle, elle l’est ; le savant que vous êtes ; des verbes : allez-y, il le faut ; des idées entières : elle défit sa chevelure, et cela avec la simplicité d’une enfant ; je bois de l’eau, ce qui me réussit très bien. Il faudrait donc distinguer des pronoms, des proadjectifs, des proverbes, des prophrases. Pour éviter ces mots équivoques ou barbares, nous dirons représentants… » (PL 173).
Il convient d’ajouter que ces divisions établies d’après la catégorie du signe représenté — représentation du nom, de l’adjectif, du verbe, de la phrase, etc. — sont surtout formelles. Si au contraire on se place au point de vue du fonctionnement, la première constatation montre que la représentation peut mettre en jeu deux sortes de rapports fort différents quoique parallèles ; selon que le signe représenté 113se trouve logé dans la mémoire ou dans la chaîne parlée même, nous parlerons de représentation mémorielle ou de représentation discursive.
Or la représentation telle qu’elle est définie et exemplifiée par M. Brunot ne s’applique qu’aux rapports discursifs ; les représentants qu’il étudie sont des anaphoriques (annonces et reprises) : Pierre est arrivé, je l’ai vu ; Elle l’a manqué, son train.
Mais il est intéressant de constater d’autre part que les nominaux de M. Brunot ne sont pas autre chose qu’un cas de représentation mémorielle. « A côté des noms véritables, il y a des noms ou des expressions qui ont été généralement classées soit parmi les noms, soit parmi les pronoms, parce qu’on répugnait à changer le nombre des « parties du discours ». De toutes provenances, ces mots ne sont pas arrivés à avoir tous les mêmes caractères ; il est cependant nécessaire de les réunir, et il m’a paru que le nom d’expressions nominales ou de nominaux leur convenait assez bien, car, on le verra par la suite, ils se rapprochent des noms sans se confondre avec eux… » (PL 63). Exemples : moi, nous, lui ; quelqu’un, quelque chose, rien, tout, cela ; etc. etc.
M. Brunot a d’ailleurs signalé les fréquents échanges qui se produisent entre représentants et nominaux : « … La plupart des représentants peuvent devenir des nominaux. Une femme fait des reproches à son mari : Tu ne travailles pas, tu es toujours à causer avec celui-ci, avec celui-là, avec l’un, avec l’autre. » (PL 63-4). Cela revient à dire qu’un signe qui représente normalement un autre signe agencé dans la chaîne parlée, peut occasionnellement servir à représenter un signe logé dans la mémoire.
1) Représentation mémorielle
Il va sans dire que ce terme de nominal — parallèlement au pronom, qui ne représente pas exclusivement un nom mais peut remplacer tour à tour un adjectif, un verbe, une phrase, etc. — devra lui aussi être élargi.
Ainsi l’infinitif n’est pas autre chose que le représentant 114d’un verbe conjugué et par conséquent d’une proposition : Il est temps de partir (Z Il est temps que nous partions), Je veux mourir (Z *Je veux que je meure), v. De Boer, Revue de Lingu. romane, 3, 307.
Nous indiquons ci-dessous quelques types qui intéressent particulièrement le français avancé.
Les mêmes procédés de représentation s’appliquent aux temps. Bien que le passé simple ait disparu à peu près complètement de la langue parlée, les agences de presse et les journaux le conservent soigneusement, pour faire l’économie de la forme composée : Il débarqua (Z il a débarqué).
La langue moderne aime à abréger les relatives (Legrand, Stylistique française, 113-40, indique les procédés corrects qui permettent de se passer du relatif). « En vertu du moindre effort à faire, on abrège des locutions : une pièce mouvementée, pour : une pièce qui a du mouvement ; un style imagé, pour : un style qui a des images ; un événement sensationnel, pour : qui fait sensation. » (Vincent XXIV). Le sens actuel de conséquent (« important », ex. une ville conséquente, une affaire conséquente) s’explique par le fait que cet adjectif représente Une expression plus longue : de conséquence.116
Le participe présent de relation a pour fonction de représenter les relatives qui ont un autre sujet que l’antécédent : un café chantant (Z où l’on chante), un thé dansant (Z où l’on danse). Cf. un quartier commerçant, une rue passante, un parquet glissant, un sol roulant, W. C. payants, etc.
De telles phrases, est-il besoin de le dire, ne sont équivoques qu’à la réflexion ; leur rôle est de représenter des circonstancielles qu’il serait trop long d’énoncer explicitement. D’ailleurs, cette syntaxe rejoint celle en usage autrefois, telle qu’elle s’est conservée dans quelques proverbes : L’appétit vient en mangeant, La fortune vient en dormant.
Nous avons vu ailleurs comment le français avancé se débarrasse, s’il y a lieu, de certaines de ces équivoques (type : Passe le journal pour moi lire).
Mots par initiales. — L’usage d’abréger les syntagmes en les représentant par les initiales des mots qui les composent, est aujourd’hui très étendu, mais ces créations n’ont le plus souvent qu’un caractère local et éphémère : erpéiste (partisan de la Représentation Proportionnelle) ; le Bite (Bureau International du Travail), etc.
2) Représentation discursive
Par la représentation discursive, un signe plus court ou plus maniable reprend ou anticipe un autre signe qui figure dans la chaîne du discours : Pierre est parti, mais il reviendra, La maison de Jean est plus petite que celle de Pierre.
Au lieu de donner une étude complète de ces anaphoriques — il, elle, ça, le ou pop. y, dont, en, où, etc. — on se contentera de citer deux ou trois faits qui intéressent le français avancé.
Que sert correctement à reprendre certaines conjonctions 119dont la répétition ferait longueur : Si vous travaillez et que quelqu’un vient vous déranger ; Quand on travaille et que quelqu’un vient vous déranger ; Quand je me repose ou que je dors. Cet emploi si commode est étendu à d’autres conjonctions, où il passe pour incorrect : C’est pourquoi…, et que… (Martinon II 402 n).
La langue familière emploie si pour reprendre est-ce que : Est-ce que tu restes ou si tu pars ?
L’emploi de faire comme anaphorique du verbe est classique, mais on ne le tolère pas toujours. « Un des pires abus du verbe faire consiste à l’employer à la place d’un autre verbe » (Albalat, Comment il ne faut pas écrire, 49) : Je le reconnus mieux que je n’avais fait sa femme (A. Hermant). Dans la langue parlée d’aujourd’hui, cet usage se limite à l’emploi de faire avec le. Tandis que la langue écrite tolère un exemple du type : Le pire est que nous ne pouvons soupçonner Joubert d’aucune ironie, comme nous faisons notre bon maître Anatole France (A. Hermant : D’Harvé PM § 795 A), la langue parlée aurait comme nous le faisons de…
Cas limites. — Entre représentations mémorielle et discursive, il n’y a pas toujours de limite nette. Ainsi les prophrases qui servent de réponses (Oui, Non, Volontiers, etc.) supposent la combinaison d’un élément donné dans la question avec un autre élément logé dans la mémoire (affirmation, négation, acquiescement, etc.) : Est-ce que Pierre est rentré ? Oui (Z P. est rentré) ; Non (Z P. n’est pas rentré) ; Voulez-vous du thé ? Volontiers (Z J’en veux bien).
C) Ellipse
Au lieu de représenter l’élément dont on veut faire l’économie, on peut aussi le passer sous silence. C’est ce qu’on appelle communément l’ellipse.
Comme nous l’avons fait pour la représentation, nous distinguerons du point de vue du fonctionnement deux sortes d’ellipses : l’ellipse mémorielle et l’ellipse discursive.
L’ellipse mémorielle consiste à sous-entendre un élément qui doit être suppléé par la mémoire : un documentaire 120(Z un film documentaire), tandis que l’ellipse discursive est l’anticipation ou la reprise d’un élément donné dans le discours : illustrations dans et hors texte (Z dans texte) ; les pommes cueillies et les tombées (Z et les pommes tombées).
Terminologie. — La terminologie grammaticale n’est pas fixée. Tandis que M. Nyrop (V § 14 sv) appelle l’ellipse mémorielle ellipse proprement dite, M. Bally (Copule zéro) voudrait réserver le terme d’ellipse à la seule ellipse du discours. — Nous nous conformerons à l’usage le plus communément reçu en gardant le mot d’ellipse comme terme générique, pour désigner le phénomène dans son ensemble. On peut réserver le terme de sous-entente à l’ellipse mémorielle et celui d’haplologie (non répétition) à l’ellipse discursive.
1) Ellipse mémorielle
Selon que l’élément ellipse est grammatical ou seulement phonique, c.à.d. selon qu’il est porteur ou non d’une signification immédiate, nous parlerons de sous-entente ou d’amuissement. En principe, il n’y a pas de fossé entre ces deux procédés, qui se laissent rattacher au même besoin.
a) Sous-entente.
On distingue généralement la sous-entente du déterminé, celle du déterminant et celle du signe de rapport chargé de relier le déterminé et le déterminant. Il est difficile de dire dans chaque cas pourquoi c’est l’une ou l’autre de ces trois possibilités qui l’emporte ; tout au plus peut-on supposer à première vue que la sous-entente du déterminé (sujet, etc.) et celle du signe de rapport (verbe transitif, copule, préposition, conjonction) sont plus fréquentes que celle du déterminant. « Le langage est presque toujours très elliptique : ce qui est sous-entendu, ce n’est pas l’accessoire et l’accidentel [prédicat, déterminant], qui ne se laisseraient pas deviner ; mais ce qui est si essentiel qu’on ne manquera pas de le suppléer [sujet, déterminé, signe de rapport] ». (Goblot § 96).
La liste ci-après énumère les principaux cas de sous-entente que présente le français avancé.121
Sujet :
Regrette, n’ai plus. — Bien fâché, n’y pouvons rien. — Monsieur X ? Connais pas.
Les lettres populaires : Les jours sont durs et voudrais bien que…
Voudrais bien de tes nouvelles, suis toujours ici, te prie… Hier sommes allés… Aujourd’hui avons reçu… (= Prein).
Journaux intimes : Aujourd’hui dîné chez X… Rentré tard… etc.
Sujet impersonnel. : Là-bas faut que vous alliez. — Ya un bureau de poste à côté.
Substantif déterminé :
On vous le fournira fin (du mois) courant.
L’épreuve du kilomètre (avec départ) lancé.
Vente pour cas (de force) majeur(e), Départ pour cause d’occupation (par force) majeure (Vittoz 92).
Transit par (chemin de) fer entre la Suisse et les ports français.
Faubourg (Saint)-Antoine (B).
Chaussures extra en (cuir) double veau.
Subordonnante (sujet + signe de rapport) :
Vous avez volé ça : : J’ai volé ça ? (Vous prétendez que, Vous dites que…).
Où veux-tu aller ? : : Où je veux aller ? (Tu demandes où…).
Il est déjà venu ? : : S’il est déjà venu ? (Vous demandes si…).
Que si, Que oui, Que non (Je vous dis que…).
Dans leur maison, pas un seul tapis.
Quand il y a divergence, permis à chacun de faire à sa guise.
Tu iras à tel et tel endroit : : Entendu.
J’essayerai de le faire : : Trop tard maintenant.
Qui, quand, comment, où (c’est) ça ?
Subordonnante dans une circonstancielle :
Donc c’est entendu : si beau je viens, si pluie je reste.
Le cortège aura lieu pluie ou pas pluie.
Besoin ou pas besoin, je te défends de l’acheter.
Son œuvre, commencée alors que jeune étudiant.
Aussitôt que lavé et nourri à l’hôtel, il alla… (Nyrop V § 17).
Bien que déprimées, elles sourirent jusqu’à la fin (ib.).
J’ai acheté ce cheval, quoique un peu cher (ib.).
Celui qui aime les primitifs parce que primitifs (ib.).
Le commandant E., bon catholique, puisque zouave du pape, mais déplorable Français (ib.).
Nous espérons que ces indications vous faciliteront pour faire les recherches, c’est pourquoi aussitôt reçu nous nous empressons de vous les communiquer (APG).
Nous croyons, ainsi que ses camarades le disent, que malgré blessé, il aura pu être fait prisonnier (id.).
La neige fait son apparition sur les montagnes avoisinantes, et dès une couche suffisante, nous pourrons bientôt voir les nombreux fervents des « planches » s’adonner à leur sport favori (Godet c).122
Qui est, etc. :
Par divers renseignements recueillis, j’apprends que tous ceux morts sur le champ de bataille ont pu être enterrés (APG).
Cette revue dépassera en gaîté celle montée à pareille époque l’année dernière ; Ceux donnés par la nature (Joran n° 54).
Paul, (qui est de) retour de Pans, m’a annonce cette nouvelle (Vincent 152-3).
Que (+ régime) :
Tu veux je vienne ? Faut je m’en alle ? Il a dit i viendrait (viendra, veut venir). Je veux pas tous ces types i soyent toujours à me courir (B 142).
Il nous a dit comme blessure il avait reçu une balle dans le dos, traversé sa cartouchière et sorti par devant (APG).
Tu hécrira si tu veux au dépôt pour il manvoi un paquet de fait [= d’effets] de soldat (Prein 76).
Cf. Je languis (d’être) à l’année prochaine (Plud’hun 71).
Préposition d’inhérence (+ prédicatif) :
Une dissolution du Reichstag est considérée impossible par tous les milieux politiques ; M. C. considérerait excessive la réduction projetée du programme naval ; On le considère très habile (Martinon II 497).
Nos prix déjà connus excessivement bas ne seront rien à côté de… (réclame).
L’écueil à éviter, c’est que les personnages inventés par l’auteur n’apparaissent plutôt des représentations d’idées abstraites que des êtres bien vivants.
Préposition :
Le fils Dupont, la fille Durand (Joran n° 134).
Voyez caisse ! Voyez terrasse ! Voyez guichet 5 !
Mallette placage, doublure fantaisie, coloris mode, modèle luxe, cousu main, etc.
Œuf coque, œuf plat, fine Maison (B 167).
La partie texte, fer, maçonnerie, etc.
Le facteur temps, argent, etc.
La question approvisionnement, ravitaillement, etc.
Le trafic marchandises, le mouvement marchandises du PLM, les chiffres de la circulation voyageurs, etc.
Préposition composée > simple :
C’est en face la Sorbonne ; Continental Hôtel, face les Bains.
Le pavillon est placé hors la vue des promeneurs.
Au point de vue enseignement ; Placez-vous au point de vue relief ; Au point de vue formation de l’infanterie (Thérive NL 10. 4. 26).
Rapport à ces nuages-là, il va pleuvoir.
Jusque deux heures, Jusque maintenant, Jusque la Madeleine.
Crainte de vous nuire, qu’on ne vous nuise (Vincent 47-8).
Je vous l’apporte d’ici la semaine prochaine.
Cause départ ; Cause santé (annonces).
On vous le fournira courant avril.
C’est vis-à-vis l’église ; Vis-à-vis la porte de gauche.
Près le pont ; Près la porte Maillot.123
Déterminant :
Rompez ! (les rangs).
Allons, ouvre ! (la porte).
Aujourd’hui, tout le monde veut avoir sa voiture (automobile).
Le garçon n’annonce pas : un café, deux cafés, mais : Versez pour un, pour deux, etc. (B 167). — Versez, au premier !
La copie (ci-)incluse (Martinon II 477 n).
Un essuie(-mains) (B).
Avoir le dernier (mot).
A la première belle (occasion).
b) Amuissement.
Il n’y a pas de fossé véritable entre l’ellipse proprement grammaticale ou sous-entente, dans laquelle le signe passé sous silence est toujours accompagné d’une signification distincte, et l’ellipse phonique ou amuissement. Par ce dernier terme, nous désignons tous les cas d’ellipse mémorielle qui intéressent le signe — phonèmes, syllabes, groupes de syllabes — à l’exclusion de la signification.
2) Ellipse discursive (haplologie)
Pris dans un sens plus large, le terme d’haplologie peut aisément servir à désigner l’ellipse discursive en général, c.à.d. toute non-répétition (h. progressive) ou non-anticipation (h. régressive), en contact ou à distance, sous une forme identique ou approchante, d’un simple phonème, d’une syllabe ou d’un mot.
Cette extension du terme d’haplologie est conforme aux faits. Livrées à elles-mêmes, les langues manifestent une répulsion plus ou moins vive pour la répétition fortuite des phonèmes, des syllabes et des mots ; et cette répulsion est un des cas où l’instinct collectif semble d’accord avec la grammaire impérative : tous les écoliers de France et de Navarre connaissent la règle qui interdit les répétitions de mots. 128Seulement, la tendance spontanée porte sur les phonèmes isolés et les syllabes autant que sur les mots entiers, et en contact comme à distance.
Après avoir énuméré quelques variétés d’haplologie verbale et d’haplologie syllabique, il nous reste à examiner l’haplologie phonique. Entre cette dernière et les autres, il n’y a qu’une question de degré : Qu’est-ce que c’est que ça ? > kèksèksa. > kèsèsa ; Qu’est-ce que ça fait ? > kèksafè > kèsafè.
La même réluctance pour la répétition fortuite explique la suppression d’un grand nombre de liaisons : Un attenta(t) affreux, po(t) à tabac, to(t) ou tard, aussitô(t) après, bientô(t) après, est-ce que vous ire(z) aux eaux, etc. etc. On voit donc que l’haplologie va jusqu’à l’emporter sur la tendance, si forte par ailleurs, à réduire l’hiatus.
La question de l’e muet intervient également ici. On sait le sort que réserve à cet ə le français avancé ; la langue correcte même n’admet pas sa répétition dans une suite de deux ou plusieurs syllabes, et la « loi des trois consonnes » pourrait s’appeler tout aussi bien la « loi des deux voyelles ». 129Exemples : *ça nə mə fait rien, *veux-tu tə ləver, *on sə dəmande, *il restə dəbout, *tu mə rəssembles, *vous rədəvənez jeune, *on mə lə donne, *si jə lə savais. — A plus forte raison, la répétition multipliée de la même voyelle entraîne une bouillie imprononçable : *jə nə mə lə rappelle pas (d’où : je ne m’en rappelle pas), *jə nə tə lə rəfuse pas (d’où pop. je t’y refuse pas), *jə nə tə lə rədəmanderai pas, etc.
Cette tendance brachylogique est si forte qu’elle s’étend même aux cas où il n’y a pas répétition d’un e muet : atlier, dmain, rnoncer (Plud’hun 16), amner, enlver ; lmarchand n’avait pas ça ; du 60 à l’heure qu’i f’saient !
Ce point de phonologie est très important ; le parler populaire amène ainsi le français à connaître des consonnes à fonction vocalique (r l m n voyelles) telles qu’en possède l’allemand et telles qu’elles existaient probablement en indoeuropéen. Le français y avait répugné jusqu’à présent.
Les abréviations sémantiques et formelles étudiées dans ce chapitre montrent que si le français était, sur ce point, livré à lui-même, il ne tarderait pas à devenir une langue monosyllabisante ou monosyllabique du type de l’anglais ou du chinois, avec tous les avantages et inconvénients qui s’y rattachent. Nous avons signalé les multiples dangers d’homophonie qui résultent de la marche vers le monosyllabisme, et nous renvoyons à la loi que nous avions formulée : la différenciation est fonction de la brièveté.130
Chapitre IV Le besoin d’invariabilité
Bally LV 205 sv ; Bull. Soc. Lingu., 23, 119 n.
Bergson, Evolution créatrice, 171 sv.
Nyrop III § 638 sv. (Dérivation impropre).
Sechehaye, Structure logique de la phrase, 102 sv.
Langues où l’invariabilité du signe est particulièrement avancée : l’anglais, et surtout le chinois.
C’est un philosophe, M. Bergson, qui a le mieux aperçu le principe qui constitue le trait essentiel du langage humain, la mobilité du signe :
« Les sociétés d’insectes ont sans doute un langage, et ce langage doit être adapté, comme celui de l’homme, aux nécessités de la vie en commun. Il fait qu’une action commune devient possible. Mais ces nécessités de l’action commune ne sont pas du tout les mêmes pour une fourmilière et pour une société humaine. Dans les sociétés d’insectes, il y a généralement polymorphisme, la division du travail est naturelle, et chaque individu est rivé par sa structure à la fonction qu’il accomplit. En tout cas, ces sociétés reposent sur l’instinct, et par conséquent sur certaines actions ou fabrications qui sont plus ou moins liées à la forme des organes. Si donc les fourmis, par exemple, ont un langage, les signes qui composent ce langage doivent être en nombre bien déterminé, et chacun d’eux rester invariablement attaché, une fois l’espèce constituée, à un certain objet ou à une certaine opération. Le signe est adhérent à la chose signifiée. Au contraire, dans une société humaine, la fabrication et l’action sont de forme variable, et, de plus, chaque individu doit apprendre son rôle, 131n’y étant pas prédestiné par sa structure. Il faut donc un langage qui permette, à tout instant, de passer de ce qu’on sait à ce qu’on ignore. Il faut un langage dont les signes — qui ne peuvent pas être en nombre infini — soient extensibles à une infinité de choses. Cette tendance du signe à se transporter d’un objet à un autre est caractéristique du langage humain. On l’observe chez le petit [172] enfant, du jour où il commence à parler. Tout de suite, et naturellement, il étend le sens des mots qu’il apprend, profitant du rapprochement le plus accidentel ou de la plus lointaine analogie pour détacher et transporter ailleurs le signe qu’on avait attaché devant lui à un objet […]. Ce qui caractérise les signes du langage humain, ce n’est pas tant leur généralité que leur mobilité. Le signe instinctif est un signe adhérent, le signe intelligent est un signe mobile. » (Evolution créatrice, 171-2).
Le même problème peut être posé en d’autres termes. L’opposition bergsonienne du signe adhérent et du signe mobile correspond à l’opposition faite par F. de Saussure entre le symbole et le signe arbitraire (CLG 103) : Le symbole a pour caractère de n’être jamais tout à fait arbitraire ; il y a un rudiment de lien naturel entre le signe et la signification. Autrement dit, le signe adhère à la signification. Le symbole de la justice, la balance, ne pourrait pas être remplacé par n’importe quoi, un char par exemple. — Le signe arbitraire, au contraire, est immotivé, c.à.d. que rien ne le rattache naturellement à la signification (= signe mobile).
Il est aisé de voir pourquoi le signe linguistique est mobile. Logiquement, il faudrait qu’à chaque signe corresponde 1 signification. C’est là le point de vue du signe adhérent ou du symbole, et c’est bien à peu près ce que l’on constate dans les langues dites primitives, qui consacrent un signe spécial à chaque signification particulière mais n’ont pas de termes pour rendre les idées abstraites. Il en résulte une multiplication des signes à l’infini, et un effort de mémoire inouï. Le besoin d’économie pousse le langage à remplacer la multiplicité des signes particuliers par des signes mobiles pouvant traduire tour à tour un grand nombre de significations distinctes. Cette généralisation ne s’arrête pas au signe générique (ex. arbre, maison, véhicule, colis, etc.) ; elle va jusqu’au signe catégoriel (signes désignant le concept de chose, d’être, de qualité, d’action, etc.).132
Dans le camp des logiciens et des psychologues aussi bien que dans celui des linguistes, on a abandonné de plus en plus la croyance au parallélisme psycho-linguistique, pour reconnaître l’alogisme des catégories grammaticales. Les « parties du discours » sont loin d’être un simple décalque des catégories de la pensée ; les correspondances établies entre le Substantif et la « substance », l’Adjectif et la « qualité », l’Adverbe et la « manière », le Verbe et le « procès », la Préposition et la « relation », etc., ne conviennent que trop souvent aux manuels de grammaire et de logique à l’ancienne mode. Un substantif, par exemple, n’est pas rivé à la notion de « substance », il peut supporter une idée de « qualité » (ex. la beauté) ou de procès (la venue) ; un adjectif peut contenir une idée de « substance » (la production livresque de l’Allemagne), un verbe une idée de « qualité » (rougir), etc.
Dès qu’on pénètre dans la réalité du langage vivant pour observer sur le vif le déroulement des phrases dans la parole, on voit bien vite combien est risquée la tentative d’établir un parallélisme rigide entre les cadres de la pensée et les moules de la grammaire. Le besoin de disposer de signes mobiles et maniables tend au contraire à permettre qu’une seule et même catégorie grammaticale supporte tour à tour des valeurs et catégories de pensée différentes.
Le problème de la traduction, dont la théorie pourrait tenir en quelques lignes, montre très bien la différence entre les deux ordres de faits. La traduction « littérale » .consiste à traduire à l’aide des mêmes catégories grammaticales, mais aux dépens de l’identité sémantique ; exemple : zuletzt ging sie nach Hause zurück > finalement elle retourna chez elle. La traduction « libre » cherche à obtenir l’identité sémantique aux dépens de l’identité des catégories grammaticales : elle finit par retourner chez elle.
La croyance au parallélisme psycho-linguistique donne lieu à des erreurs fréquentes ; parce que des signes sont identiques de forme, on croit qu’ils appartiennent nécessairement à la même catégorie. Le mélange du substantif et de l’adjectif en une catégorie unique est un exemple de cette erreur : « Substantifs et adjectifs échangent leurs rôles dans toutes 133les langues ; grammaticalement il n’y a pas entre eux de limite tranchée. On peut les réunir tous deux dans une catégorie unique : celle du nom. » (Vendryes, Langage, 138). Ou bien, parce que dans une langue le pronom possessif est interchangeable avec le pronom personnel (ex. ma venue = je viens), on appellera cette langue une langue à « conjugaison possessive » ; parce que dans une langue le nom est interchangeable avec le verbe (jap. la neige tombe = la chute de la neigé), on appellera cette langue une langue à « conjugaison nominale », etc. etc. Autrement dit, on déduit faussement de l’identité des signes celle des significations, sans se douter que le besoin d’économie n’efface les différences formelles superflues qu’en gardant strictement la différence des fonctions.
Historique. — Le parallélisme psycho-linguistique est soutenu par le logicien Keynes et par l’école de linguistes qui va de Humboldt et Steinthal jusqu’à Wundt et Cassirer. Ont réagi : chez les logiciens, Goblot (§ 96 et passim) ; chez les linguistes : H. Paul, Marty, Jespersen, et l’école de Saussure. Cf. 0. Funke, Studien zur Geschichte der Sprachphilosopie, Bern 1928.
Cette mobilité du signe dépend non seulement de l’arbitraire du signe par rapport à la signification, mais bien plus encore de celui de la signification, c.à.d. de la pensée, par rapport à la réalité pensée. De même que le langage n’est pas un simple décalque de la pensée, notre pensée, elle non plus, n’est pas un simple décalque du donné, c.à.d. des perceptions qui nous viennent du monde extérieur et de nos sensations du monde subjectif (v. Bally LV 148-9 ; Contrainte sociale : Revue Intern. de Soc, 35, 218 sv).
Il est aisé aussi de voir pourquoi la pensée est mobile par rapport à la réalité pensée. Les faits que nous percevons et sentons ne sont toujours que singuliers, individuels, détaillés. Pour les « penser », le besoin d’économie nous pousse à simplifier la multiplicité du perçu, à la classer en un certain nombre de groupes et de sous-groupes. La pensée élabore la variété formidable du donné en y substituant des représentations 134génériques : le concept est une signification générique, c.à.d. une signification interchangeable d’une signification particulière à une autre (le concept « maison », par exemple, peut se substituer à tour de rôle à un nombre énorme de perceptions de maisons singulières, aucune n’étant identique à l’autre ; v. Sapir, Language, II-2).
Le passage de la réalité au langage suppose donc un double décalage, entre la réalité et la pensée d’abord, ensuite entre la pensée et le langage. De ces deux arbitraires, seul le second intéresse directement la linguistique, le premier ressortit à la psychologie.
Nous insistons sur ce dernier point, parce qu’on a cherché à transporter dans le domaine du langage des distinctions qui n’appartiennent ni à la langue ni à la pensée. Ainsi celle proposée par Brentano et Marty entre les prédicats (et les déterminants) qui enrichissent leur sujet (leur déterminé) et ceux qui le modifient (v. Brentano, Psychologie, II 62 n) ; ex. Pierre est savant (enrichissement du sujet) / Pierre est mort (modification du sujet). La pensée et le langage sont indifférents à cette distinction, qui n’appartient qu’à la réalité. « Quand nous disons l’enfant devient homme, gardons-nous de trop approfondir le sens littéral de l’expression. Nous trouverions que, lorsque nous posons le sujet enfant, l’attribut homme ne lui convient pas encore, et que, lorsque nous énonçons l’attribut homme, il ne s’applique déjà plus au sujet enfant. La réalité, qui est la « transition » de l’enfance à l’âge mûr, nous a glissé entre les doigts […] La vérité est que, si le langage [et la pensée] se moulait ici sur le réel, nous ne dirions pas l’enfant devient homme, mais il y a devenir de l’enfant à l’homme. Dans la première proposition, devient est un verbe à sens indéterminé, destiné à masquer l’absurdité où l’on tombe en attribuant l’état homme au sujet enfant. » (Bergson, Evolution créatrice, 338).
Comme nous l’avons indiqué plus haut, le besoin d’économie pousse le langage et la pensée à escamoter tout détaillage superflu, toute distinction qui n’est pas nécessaire à la compréhension. Même pour le professeur qui enseigne dans ses livres et de sa chaire que la terre tourne autour du soleil, 135il est plus commode dans la vie quotidienne de dire et de penser « le soleil se lève, le soleil se couche », etc.
Le défaut de correspondance, dû à la mobilité du signe, entre catégories grammaticales et catégories de pensée a conduit quelques savants à une conclusion que l’on pourrait appeler défaitiste. Puisque les catégories grammaticales ont un caractère aussi nettement trompeur, à quoi bon les étudier et pourquoi ne pas les laisser en dehors même de la recherche scientifique ? « Après épreuve, après des années passées à chercher la solution du problème, j’ai été amené à penser qu’aucune retouche à l’ancien plan ne pouvait suffire, qu’aucun reclassement des phénomènes grammaticaux ne saurait échapper aux défauts inhérents à la classification d’Aristote. Les parties du discours ont fait leur temps. C’est une scolastique qui doit à son tour disparaître. » (Brunot, Revue universitaire, 29, 166 ; v. dans le même sens, Sapir, Language, 125).
Il n’en est pas moins vrai que les catégories grammaticales, loin d’être une invention d’Aristote, sont réellement conçues comme telles par les sujets parlants, en vertu des rapports de forme et de fonction qui servent à classer les signes entre eux dans la mémoire et dans le discours.
La sociologie livre ici un parallèle frappant. Le cas du linguiste qui voudrait étudier le langage sans tenir compte des institutions grammaticales ressemble à celui du sociologue qui ferait fi des institutions de la société — Etat, Administration, Parlement, Partis, Armée, Droit, Mariage, Eglise, etc. etc. — sous prétexte que ce sont là des cadres imparfaits et trompeurs (ce qu’ils sont en effet).
Or cette mobilité du signe, cette faculté de pouvoir être transposé d’une valeur sémantique ou d’une catégorie grammaticale à l’autre, au lieu de faire le désespoir du linguiste, sont précisément ce qui devrait l’intéresser le plus. « Si la langue fait passer si aisément les signes d’une catégorie dans une autre, c’est par un ensemble de procédés transpositifs qu’elle met au service de la parole, et qui prouvent par contrecoup la réalité des catégories entre lesquelles se fait le passage. 136Mais la transposition n’a jamais été l’objet d’une étude méthodique [v. aujourd’hui Sechehaye, Structure logique de la phrase, 102 sv] ; elle plonge pourtant très avant dans le mécanisme de la langue, et souvent la manière dont un idiome opère ces échanges fonctionnels suffit à le caractériser. » (Bally, Bull. Soc. Lingu., 23, 119 n).
L’arbitraire du signe, et la mobilité qu’il permet, étant admis en principe, il faut bien reconnaître qu’en pratique cette mobilité est chose toute relative. La faculté de transposer un signe d’une valeur sémantique ou d’une catégorie grammaticale à l’autre peut être plus ou moins aisée ou difficile selon le degré d’invariabilité du signe
La variabilité du signe apparaît sous des formes très diverses. La variation peut être régulière ; ainsi le radical des verbes de la 2e conjugaison est variable, mais il se modifie en vertu d’une alternance régulière qui vaut pour l’ensemble des verbes de cette conjugaison (je fini-s / nous finiss-ons, etc.). La variation peut être partiellement ou totalement irrégulière ; dans ce dernier cas, on parlera de supplétion (ex. je vais, tu vas, nous all-ons, j’i-rai). La séquence peut être également variable ou invariable ; le dérivé compte-rendu jure avec le verbe composé dont il est tiré (rendre compte).
Le même problème peut se poser sur le plan du discours. Les diverses significations n’ont pas toujours une expression distincte, mais peuvent être exprimées cumulativement, pléonastiquement ou discontinûment. Leur, du, au, dont, etc., sont des signes mixtes cumulant deux ou plusieurs fonctions (leur « à eux », du « de le », au « à le », dont « que de lui », etc.), l’accord oblige au contraire à exprimer plusieurs fois ce qui n’est pensé qu’une fois (belle petite chatte blanche), et la discontinuité détruit la succession logique des éléments : les langues slaves de civilisation.
Le fait que le signe est obligé, en vertu des rapports qui le lient à d’autres signes logés dans la mémoire ou dans le discours, de changer constamment de forme, nécessite de la part des sujets parlants et entendants un effort supplémentaire 137de mémoire et d’attention. Le besoin d’invariabilité, un des plus impérieux du langage, tend à toujours conserver à un signe, en dépit des rapports mémoriels et discursifs qu’il soutient avec le reste du système, la même forme afin d’alléger autant que possible l’effort de mémoire et d’attention à fournir. Le moindre effort de mémoire est la raison d’être du signe mobile et invariable.
La marche des langues de grande communication vers l’invariabilité de plus en plus forte des pièces du système a été soulignée par divers auteurs. M. Bally a signalé et esquissé le problème en se plaçant au point de vue de la transposition, et a consacré quelques pages à montrer « l’interchangeabilité toujours plus aisée des fonctions avec un minimum de changement des signes ; les mots, parties de mots, membres de phrases et phrases entières qui sont appelés à d’autres fonctions que celle qui leur est habituelle, assument leur nouveau rôle sans modifier leur forme, ou en la modifiant très peu. Le phénomène se vérifie, par exemple, lorsqu’un verbe peut être indifféremment transitif ou intransitif (cf. anglais he stops a watch et the watch stops), quand un verbe devient, dans les mêmes conditions, un substantif (to stop, a stop) ou un élément de composé (a stop watch). Il suffit de comparer des passages semblables en grec et en latin pour voir que dans ces langues la transposition est fortement caractérisée, et par conséquent plus difficile (grec γαμέο « épouser » et γαμίζω « faire épouser », ἵππος, τρέφω et ἱπποτρόφος « qui nourrit des chevaux », etc.). Même constatation dans le régime de la phrase : c’est par des modifications toujours plus légères qu’une proposition indépendante peut devenir terme d’une phrase, ou phrase subordonnée (cf. d’une part latin erras et puto te errare, d’autre part anglais You are wrong et I think you are wrong). » (Bally LV 205-6).
Nous étudierons dans ce chapitre comment le besoin d’invariabilité, en réduisant les modifications formelles à un minimum, cherche à rendre la transposition linguistique 138aussi aisée que possible. Nous distinguerons trois types de transposition : la transposition sémantique, la transposition syntagmatique et la transposition phonique.
La transposition sémantique est le passage d’une valeur sémantique à l’autre. Par exemple, le passage d’une personne à l’autre (je/tu/il ; moi/toi/lui) est une transposition sémantique ; de même, le passage d’un nombre à l’autre (je/nous ; tu/vous ; il/ils).
La transposition syntagmatique est le passage d’une catégorie syntagmatique à l’autre. Par exemple, le passage du sujet à l’objet (je/me ; tu/le ; il/le ; ils/les) est une transposition syntagmatique ; de même, le passage de la syntagmatique libre (syntaxe) à la syntagmatique plus ou moins condensée (morphologie), par exemple la transformation d’un prédicat en un déterminant (la maison est à moi > ma maison) ou celle d’une phrase en un substantif abstrait (la rosé est belle > la beauté de la rosé), et ainsi de suite.
La transposition phonique est le passage d’une sous-unité à une unité, et inversement. Ainsi je et moi, tu et toi, il et lui, ils et eux, ne sont pas interchangeables ; nous, vous, elle, au contraire sont invariables à ce point de vue : ils peuvent fonctionner tantôt comme sous-unités (nous-allons, vous-allez, elles-vont) tantôt comme unités (nous, nous-allons ; vous, vous-allez ; elles, elles-vont).
Nous étudierons donc successivement : les transpositions sémantiques, abstraction faite de toute transposition syntagmatique ou phonique ; les transpositions syntagmatiques, abstraction faite de toute transposition sémantique ou phonique ; les transpositions phoniques, abstraction faite de toute transposition sémantique ou syntagmatique — en examinant chaque fois comment le besoin d’invariabilité cherche à rendre le passage aussi aisé que possible.
A) Transposition sémantique
La langue familière et la langue populaire aiment à se servir d’expressions vagues, dès que la compréhension n’exige pas de termes plus précis ; elles se dispensent de marquer par des termes spéciaux toutes les différences de signification. Il 139suffit, pour se rendre compte de ce fait, de comparer le vocabulaire journalier avec la terminologie technique et scientifique. Les langues spéciales tendent à restreindre l’extension sémantique des signes qu’elles emploient, les langues de grande communication tendent à la généraliser. Cette généralisation du signe comporte diverses variétés, telles que le signe générique, le signe indifférent, la figure effacée, la fausse figure.
Le signe générique — appelé aussi signe passe-partout ou signe à tout faire, par exemple homme, chose, faire, etc. — est un signe interchangeable d’une signification particulière à l’autre à l’intérieur d’une catégorie grammaticale donnée. Un mot comme véhicule peut fonctionner tour à tour à la place de char, voiture, camion, roulotte, auto, wagon, etc. ; le colis désignera selon l’occurence un paquet, une caisse, un panier, une valise, un ballot, et ainsi de suite. Parallèlement, dans le domaine du verbe la copule (par exemple être, avoir, devenir, faire) n’est pas autre chose qu’un verbe transitif générique.
Les grammairiens qui opèrent avec des jugements de valeur appellent le signe générique un terme « vague » et parlent de « confusions », d’« ignorance », etc. Comme nous l’avons signalé dans l’Introduction déjà pour la notion de l’oubli, le vague, la confusion et l’ignorance peuvent avoir leur raison d’être ; elles servent inconsciemment le besoin d’invariabilité. La fonction économique du signe générique est évidente : il dispense la mémoire de retenir une foule de signes particuliers dont l’emploi serait superflu, et forme ainsi la contre-partie, dans le domaine des associations de mémoire, de ce que nous avons appelé la brièveté sémantique.
Les signes indifférents (dans le jargon : voces mediæ) réalisent l’interchangeabilité des contraires, en permettant de faire l’économie des antonymes. Ainsi sentir est un verbe indifférent, parce qu’il permet de marquer aussi bien un procès qui part du sujet qu’un procès qui va vers lui : Tu sens comme ça sent ? Beaucoup de mots peuvent être pris indifféremment en bonne ou en mauvaise part (fr. av. grâce à cet échec, commettre un acte héroïque, jouir d’une mauvaise réputation, risquer de réussir, etc.) ; v. Nyrop, IV § 199 sv.140
La transposition sémantique ne doit pas être confondue avec la figure. Cette dernière, dont il sera reparlé, est un procédé expressif obtenu par l’association voulue de deux valeurs, la valeur première (ou sens propre) et la dérivée (ou sens figuré) ; la transposition sémantique pure postule au contraire l’oubli ou le refoulement du sens premier. Commettre des vers est une figure plaisante, dont l’expressivité repose sur le rappel de la valeur proprement péjorative du verbe commettre (commettre un crime, un pécher) ; commettre un acte héroïque est une simple transposition, rendue possible par l’oubli du sens premier.
On voit bien par là comment le point de vue descriptif (statique ou historique) et le point de vue fonctionnel diffèrent. Le premier se contente de signaler des « extensions de sens » et les conditions où elles se produisent. Le second va plus loin ; il considère ces extensions sémantiques comme des procédés dont il s’agit de rechercher la ou les fonctions. La transposition sémantique a pour fonction de faciliter l’effort de mémoire à fournir ; la figure, de satisfaire le besoin d’expressivité.
Cette distinction établie, il faut avouer qu’en pratique il peut être difficile de savoir si l’on se trouve en présence d’une transposition pure ou d’une figure. Il importe cependant de bien les délimiter, au moins en théorie.
Et d’abord, au point de vue évolutif, il y a souvent passage de l’une à l’autre, dans ce sens qu’une figure qui a commencé par répondre au besoin d’expressivité peut s’effacer, changer de fonction et verser finalement dans le domaine de la simple transposition. Le cas est banal ; il n’est plus question de métaphore, quand on parle du pied d’une table, ou d’une feuille de papier.
Les valeurs sémantiques que le langage est appelé à exprimer se classent en un certain nombre de catégories fondamentales dont la liste est difficile à dresser. Le lecteur ne trouvera pas, dans les rubriques rangées ci-après, une Table des Valeurs complète et détaillée. On se contentera de quelques points de vue, d’après les matériaux qu’offre le français avancé.
1) La substance et ses déterminations
Un substantif peut accroître ainsi le nombre de ses emplois jusqu’à devenir un signe générique. « J’écoute parfois une jeune personne qui gagne sa vie en cousant. Tout en cousant, elle parle, mais elle n’invente pas de mots ; au contraire, elle les supprime presque tous. Un seul vocable lui suffit à désigner cent objets. Elle dit : chose, machin, truc, et 142ces mots représentent presque toute la nature, telle du moins qu’elle l’aperçoit de ses yeux… Un jour, quelqu’un lui riposta : Mais quelle chose, quel machin, quel truc ? — Eh bien quoi ! dit la midinette agacée, vous ne comprenez donc pas le français ? Et cette jeune fille prenait sincèrement en pitié l’interlocuteur qui avait besoin d’un mot pour désigner chaque chose et chaque machin. » (J. Lefranc, Tribune de Genève, 28. 9. 26). D’autres mots, comme fourbi, bricole, etc., remplissent la même fonction.
On remarquera que les pronoms sont tous des signes génériques ; leur fonction est non seulement de remplacer un signe long par un signe plus court (économie discursive), mais encore de pouvoir se substituer à n’importe quel signe à l’intérieur d’une catégorie donnée (économie mémorielle). Dans bien des cas d’ailleurs, le signe générique fonctionne comme pronom ; ainsi ce qui est remplacé par chose qui : II n’a pas réussi, chose qui m’étonne beaucoup.
Il est intéressant d’examiner comment le français avancé cherche à supprimer les barrières formelles qui séparent les déterminations inhérentes à la substance.
La différenciation des êtres animés et des choses inanimées, qui a joué un grand rôle dans le passé des langues indoeuropéennes, semble perdre de son importance peu à peu. Le neutre, signe de l’inanimé (opposé à l’animé : masculin ou féminin), a disparu des langues les plus évoluées ; le français ne le conserve guère qu’à l’état de survivance (cf. pis, opposé à pire ; ceci et cela, opposés à celui-ci/celui-là et celle-ci/celle-là ; quoi, opposé à qui ; quelque chose opposé à quelqu’un, etc.).
Dans la langue familière, le générique chose est employé comme nominal pour désigner une personne déterminée, et s’oppose donc à quelqu’un : C’est Chose qui a sonné.
Le genre masculin ou féminin, en tant que répondant à une différence de sexe, est trop important pour être escamoté. Même les langues qui n’ont ni masculin ni féminin, comme le chinois et le japonais, et celles qui ont perdu le genre, comme l’anglais, disposent de procédés spéciaux pour marquer la différence. Le français actuel, il est vrai, présente des cas où la différence de genre est supprimée par nécessité — un professeur, un écrivain, un maître de conférences, un docteur, un auteur, etc. en parlant de femmes — mais ces exemples constituent plutôt une gêne.
La différence entre les trois personnes (je, tu, lui) n’est pas marquée formellement par toutes les langues ; le chinois et le japonais notamment, sauf en cas d’emphase, laissent toujours à la situation ou au contexte le soin de déterminer la personne. Les langues indo-européennes n’en sont pas encore là ; on y remarque toutefois la tendance à se passer de l’expression précise de la personne lorsqu’elle est superflue.
En français, on « remplace très fréquemment tous les autres pronoms, même dans la langue parlée. C’est ainsi qu’on dit volontiers on pensera à vous pour je penserai à vous, qu’on s’en aille pour va-t-en ou allez-vous-en, on m’a vu pour il ou elle m’a vu ou ils ou elles m’ont vu, où va-t-on pour allons-nous, etc. » (Martinon II 258). Le grammairien hollandais 146Robert (104-15) a réuni une riche collection d’exemples de cette tendance de on à servir de pronom personnel mobile.
Le grand avantage de ce on mobile est de réaliser, outre l’interchangeabilité des personnes, celle des genres et des nombres. Il remplit d’autres fonctions encore ; il évite par exemple la répétition fortuite des mêmes syllabes : nous, nous nous amusons > nous on s’amuse. Et surtout, il permet de faire l’économie de la terminaison verbale : nous nous amusons > on s’amuse.
Les formes du singulier sont plus rares, mais elles existent : Je s‘arrête, je s‘en fous, tu se feras bousiller (B III-2), Je s‘ai trompé, tu s‘en vas, je se fous de tout ça (B 133).
On peut ramener au même besoin la tendance à invariabiliser le pronom possessif (il leur est défendu de donner de ses nouvelles : APG), ainsi que le possessif nominalisé (c’est une bien grande peine pour nous d’être sans nouvelles des siens : id.).
2) Espace et temps
Il arrive souvent qu’un même signe puisse s’appliquer tour à tour à une notion d’espace ou de temps.
Une préposition spatiale, par exemple, est étendue au temps : aux environs de Pâques, de 8 heures ; d’ici là « jusqu’alors » ; je vois ça d’ici « d’avance », etc.
Ce classement est général et abstrait ; nous n’indiquons ci-dessous que quelques-uns des faits qui s’y rapportent.
Le français est très pauvre en matière de démonstratifs, et les traducteurs sont obligés de rendre indirectement des nuances comme hic, iste, ille, is. Il ne connaît plus que deux séries, la série en -i (ici, voici, ceci, celui-ci, cette maison-ci) et celle en -à (là, voilà, cela, celui-là, cette maison-là). Le français avancé semble devoir éliminer peu à peu la série 148en -i, mais sans pour cela abandonner la différence, qui est exprimée dès lors par la situation (gestes, etc.) ou le contexte : Laquelle vous voulez ? celle-là ou celle-là ? Cf. Voilà ce que j’avais à vous dire, Voilà ce que j’ai à vous dire. Ici tend à se faire remplacer par là, et là (sens premier) par là-bas (ici/là > là/là-bas).
Dans l’histoire des langues, les signes qui marquent le lieu (verbes locatifs, prépositions locatives) et ceux qui marquent le mouvement (verbes directifs, prépositions directives) s’échangent fréquemment. En général, c’est le sens locatif qui est étendu au directif.
3) Quantité et qualité
La distinction formelle du singulier et du pluriel n’appartient pas à toutes les langues ; beaucoup — par exemple le chinois et le japonais — s’en passent aisément, laissant à la situation ou au contexte le soin de déterminer la différence.150
La différence traditionnelle que fait la langue entre objets « comptables » (ex. 30 personnes) ou non (ex. un certain nombre de gens) se trouve quelquefois effacée formellement : Il faut avoir pitié des personnes, Il ne faut pas médire des personnes (Martinon II 20).
De même, la différence entre le singulier et le collectif n’est pas toujours rendue formellement : Manger un raisin (« une grappe ») ; Quand la feuille vient, quand vous voyez la feuille (« le feuillage, la verdure »).
Même échange entre la manière, ou qualité d’un procès, et le temps : Les tombes trop vite creusées de nos soldats (Godet XIII), Je suis venu trop vite (id. XIV), Elle s’est mariée trop vite (ib.).151
Enfin, les diverses catégories de la qualité sont échangeables, dans ce sens qu’un signe qui s’applique à tel ou tel aspect de la qualité est étendu à d’autres cas : Un enfant plus vieux qu’un autre (Martinon II 585) ; Elle est petite « mince » (B) ; et ainsi de suite.
4) Transitivité : inhérence et relation
L’inhérence est un rapport de transitivité intrinsèque, par exemple entre une substance et sa qualité (une rosé jolie), un procès et sa manière (il chante joliment), une substance et une substance dans l’état (Pierre est avocat) ou dans le temps (l’enfant devient homme). La relation est un rapport de transitivité extrinsèque entre deux substances, qui sont conçues par conséquent comme extérieures l’une à l’autre : Pierre frappe Paul, la maison du jardinier, etc. Cf. Sechehaye, Structure logique de la phrase, 54 sv, 66 sv.
L’inhérence et la relation, qui sont des catégories sémantiques, ne doivent pas être confondues avec les procédés grammaticaux de l’accord et de la rection, bien que dans un très grand nombre de cas ces deux couples soient synonymes. Dans le tour une boucherie chevaline, l’adjectif est accordé (procédé grammatical), mais le rapport sémantique est un rapport de relation (boucherie où l’on vend du cheval).
Il va sans dire que, comme la transposition peut se déployer dans plusieurs directions, ce qui est invariabilité dans un sens peut être variabilité dans l’autre. Ainsi la transposition sémantique d’un adjectif d’inhérence en un adjectif de relation peut être un déficit pour la transposition syntagmatique : il devient d’autant plus difficile de passer de la syntagmatique libre (syntaxe) à la syntagmatique condensée (il est prisonnier en Allemagne / prisonnier allemand).
Un autre cas d’interchangeabilité entre inhérence et relation est constitué par le passage de la préposition d’inhérence comme dans le domaine de la relation : Cet article est mauvais comme style ; Je vais bien comme santé et comme position (Martinon II 497 n).
5) Corrélation
La relation, qui est le rapport entre deux substances conçues comme extérieures l’une à l’autre, ne doit pas être confondue avec la corrélation. Cette dernière se développe 153toujours, directement ou indirectement, entre deux jugements.
Les rapports entre jugements peuvent être très variés. Des idées comme parce que, puisque, pour que, au point que, etc., trouvent leur expression dans la plupart des langues, et là encore le besoin d’invariabilité cherchera à rendre ces rapports à l’aide de procédés aussi simples que possible. Un même terme, par exemple, servira à l’expression de la causalité et de la finalité (J’espère que vos recherches ont eu un but « un résultat » : APG), et ainsi de suite.
Plus généralement la langue parlée, dans tous les idiomes, tend à exprimer la corrélation par la juxtaposition pure et simple des phrases, laissant au contexte et à la situation 154(gestes, mimique) le soin de faire les distinctions utiles : Il est venu (,) j’étais malade ; Je parlais (,) il n’avait pas fini ; Dépêche-toi (,) ça presse ; Elle est vilaine (,) ça fait honte. Ce procédé atteint son plus haut degré dans une langue comme le chinois parlé, où une suite de quelques mots, par exemple tʿā laî wò kʿiü (lui venir moi partir), peut traduire les corrélations les plus diverses : S’il vient, je pars ; Je partirai quand il viendra ; Il vient ou je pars ; Il vient et je pars, etc.
Parmi les divers cas de corrélation, le rapport de comparaison mérite d’être examiné à part. La comparaison n’est pas une simple relation entre substances ; on peut comparer des qualités (Elle est plus grande que lui) et des manières (Elle joue mieux que lui). En réalité ce rapport, malgré la forme plus ou moins condensée que le langage en donne, est toujours contracté entre des jugements.
La comparaison peut aussi porter sur les jugements de nombre (ordinalité) et de temps (temps relatifs).
L’ordinalité n’est autre chose que la numération comparée. Tandis que un homme, deux hommes, trois hommes, etc., répondent à de simples jugements de nombre, le premier, le deuxième, le troisième, etc., supposent la comparaison de tels jugements.
En face de la série compacte des ordinaux en -ième, premier et second sont irréguliers : un/premier, deux/second. Le français avancé abandonne second au profit de deuxième ; dans la mesure où second continue à exister, l’ancienne différence second « de deux seulement » / deuxième « de plusieurs » disparaît et fait place à une nouvelle : second « import relevé »/ deuxième « import commun ». Premier est remplacé par unième (le unième, la unième : B).
En outre, le substantif numéro peut fonctionner comme signe de l’ordinalité : le numéro un « le premier », la ligne numéro cinq « la cinquième ligne », et réalise ainsi avantageusement l’interchangeabilité entre le signe notionnel (substantif numéro) et le signe catégoriel (préformante numéro).
Enfin, l’ellipse permet d’atteindre l’interchangeabilité complète entre cardinal et ordinal : le un « le premier », le deux « le deuxième », le trois, etc.
On peut distinguer les mêmes trois traitements quand il s’agit de transformer l’interrogatif combien en un ordinal : 1. ça fait la combientième tourte qui vient nous barber ? (B 98) ; 2. le numéro combien ? ; 3. on est le combien aujourd’hui ? le combien es-tu ? la combien es-tu ? (Martinon II 503).
La comparaison des temps peut se marquer soit par des adverbes (avant / en même temps / après) ou des conjonctions (avant que, etc.), soit par des temps relatifs, marquant l’antériorité, la simultanéité ou la postériorité.
6) Modalité
La modalité est l’attitude adoptée par le sujet à l’égard de l’énoncé. On peut distinguer une modalité plus ou moins intellectuelle, par exemple l’affirmation et la négation, ou la détermination et l’indétermination, et une modalité plus ou moins affective : l’interrogation, l’ordre (impératif, vocatif), l’évaluation (péjoratif / laudatif), etc.
Comme pour la comparaison, le français présente des cas de supplétion entre affirmation et négation : bon/mauvais, joli/vilain, une fois/jamais, quelqu’un/personne, cher/bon marché, pareil/différent, etc. Le français avancé transforme ces couples en oppositions régulières : mauvais > pas bon, vilain > pas joli, jamais > pas une fois, personne > pas un, différent > pas pareil, etc. Le même passage se remarque pour les verbes : savoir / ignorer > ne pas savoir.
Dans la langue parlée, la phrase interrogative semble aujourd’hui, de par le pullulement des formes concurrentes, extraordinairement compliquée : Qui est-ce qui est venu ? Qui c’est qui est venu ? Qui c’est-i qui est venu ? Qui que c’est qui est venu ? etc. Si la phrase interrogative traverse une crise, tout ce désarroi s’explique cependant par les essais multiples que tente le langage avancé pour supprimer l’inversion, c.à.d. pour obtenir la même séquence que dans la phrase affirmative (affirmative = interrogative).
Ce type d’interrogation est le plus avancé de tous, mais en général il frappe peu, et de fait grammairiens et linguistes n’en parlent guère (v. M. Boulenger, Figaro, 7. 7. 28). Les évolutions les plus profondes se consomment parfois sans révolution apparente.
Si l’on fait abstraction de l’élément non-articulatoire, il suffit d’ailleurs de l’intonation pour obtenir l’interchangeabilité 159complète entre affirmation et négation : Elle vient = Elle vient ? La langue parlée possède aujourd’hui des signes qui peuvent être, selon l’intonation, affirmatifs ou interrogatifs (Parce que = Parce que ? ; A cause de = A cause ? ; Comme ça — Comme ça ? ; Ainsi = Ainsi ?), et qui remplacent heureusement l’ancien type supplétif : Parce que / Pourquoi ? ; A cause de / Pourquoi ?
On peut appliquer aux sujets qui parlent et écrivent le français avancé — en somme à chacun de nous lorsqu’il ne se surveille pas — ce passage d’un grammairien concernant le langage écolier : « Ecoutez-le parler et dressez l’inventaire de tous les mots qu’il emploie. A peine atteindrez-vous à un total de deux cents. Ce lexique rudimentaire lui suffit à la rigueur pour se faire comprendre, pour exprimer en gros toutes ses idées. A chaque moment reviennent sur ses lèvres ou même sous sa plume les termes les plus incolores et les 160plus vagues, être, avoir, faire, dire, mettre, pouvoir, vouloir, chose, homme, gens, ceci, cela, qui, que, quand, beaucoup, très, fort, toujours, souvent, tout à fait, etc. » (Legrand, Stylistique Française, V).
En résumé, le besoin d’invariabilité, en cherchant à faciliter la transposition des signes d’une valeur sémantique à l’autre, diminue le nombre des signes existants et travaille donc pour la « pauvreté du vocabulaire ». L’idéal de l’économie linguistique est en effet de restreindre le nombre des formes et en même temps d’accroître leur sphère d’emploi. Inversement, le besoin de différenciation cherche sans cesse à augmenter le nombre des formes existantes et à spécialiser leur usage. Ainsi, la pauvreté ou la richesse du vocabulaire ne font que refléter l’antinomie de deux besoins fondamentaux : le besoin de différenciation et le besoin d’invariabilité (économie mémorielle). Selon la langue considérée, selon le compartiment de la grammaire qui est envisagé, selon l’étage social, c’est l’un ou l’autre de ces deux besoins qui l’emportera.
B) Transposition syntagmatique
Tout syntagme suppose un rapport de transitivité, c.à.d. un terme déterminé et un terme déterminant reliés par un signe de rapport (explicite ou non). Qu’il s’agisse de linguistique statique ou de linguistique évolutive, la base de toute syntagmatique est la phrase, c.à.d. le rapport sujet (déterminé) + verbe (signe de rapport) + prédicat (déterminant). Les autres syntagmes dérivent, statiquement aussi bien qu’historiquement, de ce rapport primaire, par tout un jeu de transpositions que nous allons étudier.
1) Prédication (la phrase indépendante)
La fonction primaire du verbe est de servir de signe de rapport entre le sujet et le prédicat. Mais en dehors de ce rôle transitif, le verbe peut assumer d’autres fonctions encore : celle de prédicat, exprimée par le radical (ex. domus 161uac-at « la maison est vide ») ; celle de sujet, exprimée dans la terminaison (ex. uaca-t « elle est vide »).
Le besoin d’invariabilité exige : 1. que ces divers éléments soient exprimés distinctement et non en cumul ; 2. qu’ils soient invariables les uns à l’égard des autres ; 3. qu’ils se suivent dans un ordre constant et qui réponde à celui des significations.
a) Le sujet.
L’évolution des langues indo-européennes de l’antiquité à nos jours, est marquée par le passage graduel de la séquence régressive (prédicat + verbe + sujet) à la séquence progressive (sujet + verbe + prédicat). Le verbe latin, par exemple, où la personne, c.à.d. le sujet, est représentée par la terminaison, appartient au type régressif : canta-t « chante-il », qui répond à son tour à la phrase régressive : Canta(t) Petrus.
Le passage à la séquence progressive dans le régime de la phrase (Cantat Petrus → Pierre chante), a entraîné le même renversement dans l’ordre des éléments de la molécule : cant-o → je-chante, canta-t → il-chante, etc. Et la précession du sujet dans la molécule verbale (je-chante, tu-chantes, il-chante, etc.) provoque par ricochet l’élimination des terminaisons personnelles du verbe ; ces terminaisons, là où elles existent encore, sont en effet contraires à l’ordre progressif des éléments de la phrase : le besoin d’invariabilité exige que la séquence reste la même dans la phrase (Pierre chante) et dans la molécule (il-chante).
Cette élimination des anciennes terminaisons personnelles du verbe, désormais inutiles et irrégulières, s’opère par amuïssement (ex. nous, nous chantons > nous, on chante) ou par figement. Les deux phénomènes sont plus ou moins solidaires ; les terminaisons verbales se conservent à la faveur de la tradition, c.à.d. de la force d’inertie du matériel linguistique existant, mais le fait qu’elles ne sont plus « pensées » les transforme en poids mort et favorise souvent leur chute.
b) Le prédicat.
Accord et invariabilité répondent à des principes contraires ; le besoin d’invariabilité exige que le prédicat reste invariable par rapport au sujet.
Dans la phrase, le français ne fait pas de différence formelle entre le sujet et l’objet (prédicat de relation) : Pierre me voit = Je vois Pierre ; la langue moderne ne connaît donc plus de cas-sujet et de cas-régime morphologiques. Mais il n’en est pas de même pour la molécule : Il me voit / je le vois ; je le vois / il me voit. A l’exception de nous et de vous, qui peuvent servir indifféremment comme sujets ou objets, les pronoms personnels sont rigoureusement distingués par la forme : je/me, tu/le, il/le, ils/les. Dans ce domaine l’évolution est particulièrement lente, et l’exemple suivant n’est peut-être que dialectal : Vous mavé parlé de Pheulipp mais je vous dit ci vous chicanne de tros vous navé que lui envoyé promené (Bret. : Prein 69).
On trouve aussi : Il lui zy donne, Il leur zy donne, Faites-moi zy savoir, etc. Mais la solution radicale est : Il lui donne ça, Il leur donne ça, Faites-moi savoir ça, Lui dites pas ça !, etc.
c) Tendance au verbe à radical invariable.
Dans tous les verbes français irréguliers et dans tous les verbes autres que ceux de la première conjugaison, le radical est obligé de varier en fonction des déterminations de personne, de nombre, de temps et de mode qui l’accompagnent : nous faisons / vous faites ; il vient / ils viennent ; elle coud / elle cousait / elle coudra ; il peut / qu’il puisse. Aussi a-t-on proposé de distinguer entre la conjugaison vivante, formée par les verbes de la première conjugaison, et la conjugaison morte, comprenant tous les autres ; mais il ne faut pas être trop absolu, car seuls les syntagmes que la conscience linguistique ne reconnaît plus ou ne sait plus analyser peuvent être dits morts : souloir, tistre, issir sont des verbes morts.
La variabilité du radical comporte des degrés. Dans les verbes de la 2e, de la 3e et de la 4e conjugaison, les formes du radical sont variables, mais prévisibles ; ainsi nous finissons entraîne tu finis, que vous finissiez, etc., autrement dit les correspondances traditionnelles et conventionnelles permettent de dérouler sûrement toute la conjugaison, même si tel verbe en -ir n’a jamais été appris par un sujet parlant. La régularité des formules favorise donc l’effort de mémoire à fournir pour retrouver les diverses formes. C’est ce qui fait que ces verbes, malgré leur productivité réduite, résistent mieux que les irréguliers à l’action du besoin d’invariabilité.
Il n’est pas exagéré de prétendre que la grande majorité des fautes de conjugaison est dictée par le besoin d’unifier le radical du verbe ; il faut que ce dernier reste inchangé en dépit de toutes les déterminations de personne, de nombre, de temps et de mode qui l’atteignent. Cela revient à dire que le français tend à ramener tous ses verbes à la première conjugaison.167
Une étude complète des unifications analogiques à l’aide desquelles le français avancé cherche à réaliser l’invariabilité du radical — effort qui se poursuit depuis des siècles — dépasserait les dimensions d’un simple paragraphe. Mais le lecteur saura ajouter de son gré à nos cadres une multitude d’exemples.
La grammaire traditionnelle distingue un certain nombre de « temps primitifs » à partir desquels les formes de la conjugaison se groupent en séries de formes prévisibles. Ainsi l’Indicatif présent servirait de point de départ à l’imparfait, au subjonctif présent, à l’impératif, et au participe présent (j’aime : j’aim-ais, que j’aime, aime !, aim-ant) ; l’Infinitif commanderait le futur et le conditionnel (aimer : j’aimer-ai, j’aimer-ais) ; le Passé simple formerait le subjonctif imparfait (j’aimai : que j’aima-sse) et le Participe passé les temps composés.
Or, toutes les fautes de conjugaison semblent se laisser ramener à ceci : le français moderne tend à ne plus reconnaître qu’un seul radical invariable comme base sur laquelle viennent se greffer directement tous les temps. Quelle est cette base ? Là où le verbe appartient à la première conjugaison, le radical ressort de la simple comparaison des formes, de sorte qu’il n’est dès lors plus possible de parler d’un thème donné, par exemple l’indicatif présent, ou le participe présent, ou l’infinitif, dont seraient tirées les autres formes.
Mais il n’en va pas de même lorsque le verbe appartient à une conjugaison autre que la première ou lorsqu’il est 168irrégulier, c.à.d. là où le radical est obligé de varier d’un temps ou d’un groupe de temps à l’autre. En cas d’unification, on tend alors à partir du radical tel qu’il se présente dans une forme de conjugaison donnée, pour l’étendre analogiquement aux autres formes. Et ce radical-étalon n’est pas emprunté au petit bonheur à n’importe quelle forme : on peut poser comme principe d’explication que dans le 99% des cas d’unification c’est le radical du pluriel de l’indicatif présent — donc en général (mais pas toujours) le radical élargi — qui est transporté analogiquement au reste de la conjugaison.
Quelques exemples nous éclaireront. Le présent de défaillir (je défaus !) est refait sur le pluriel : nous défaill-ons, ils défaill-ent (elle défaille entre ses bras, Joran n° 88). De même pour mouvoir (je mouve, tu mouves, etc., B 132) et boire (nous boiv-ons, vous boiv-ez, formes rares). Faisez, disez et leurs dérivés, qui sont refaits sur la première du pluriel, n’appartiennent pas seulement au langage enfantin : Ceux qui satisfaisent à ces conditions (Godet XLVI).
L’imparfait, là où il est aberrant, se remodèle sur le présent : j’acquiers, ils acquièrent > j’acquiér-ais.
Enfin, tout cela s’applique naturellement aussi au conditionnel : je voudrais que vous m’écrive-riez le plus vite possible (lettre, Van Der Molen 57).
Le participe passé, et dans la langue écrite le passé simple, tendent, là où ils étaient formés sur un thème spécial, à se greffer directement sur le radical invariable du présent pluriel : les moutons ont paiss-é (Vincent 118) ; pouvoir fait quelquefois pouv-u et mourir mour-u (B 132). On rencontre dans la langue écrite : je riai, je concluai, les fièvres s’étaient résolvées, son appréhension se dissolva, ils se dissolvèrent ; un accueil aussi chaleureux que celui que nous recevâmes (Godet CVII), etc. Il y a là une masse de fautes, plus ou moins éphémères sans doute, mais qui ne se font pas n’importe comment.
Les tentatives d’unification de la conjugaison, dont nous avons donné quelques exemples caractéristiques, signalent une tendance qui se dessine nettement : effacer tout ce qui pourrait rappeler la répartition des radicaux entré plusieurs « temps primitifs » ou « bases » ou « thèmes de flexion » — pour ne laisser subsister qu’un radical unique et invariable, accommodable à n’importe quelle détermination de personne, de nombre, de temps ou de mode.
d) Tendance au verbe à radical interchangeable.
Ces dénominatifs ont de plus l’avantage de faire système avec les adjectifs de procès, les adjectifs de relation et les adjectifs potentiels correspondants : sélectif = sélectionnel = sélectionnable, etc.173
Les verbes décompositifs sont formés à partir de substantifs composés : circonstances atténuantes > circonstancier avec atténuation « accorder les c. a. » (Thérive NL 30.7. 27) ; court-circuit > court-circuiter (Lancelot 24. 3. 28) ; gelée blanche > geler blanc (Nyrop V § 110) ; répétition générale > répéter généralement ; vice-président > vice-présider (Thérive NL 31. 10. 25).
e) Tendance au verbe analytique et progressif.
Il faut ajouter que le verbe français héréditaire ne répond plus à l’analyse actuelle des termes dans la phrase, selon l’ordre sujet + signe de rapport + prédicat, Ou bien le signe de rapport et le prédicat sont confondus en un signe indécomposable (craindre « avoir peur », recourir « avoir recours », répondre « faire réponse »), ou bien, lorsque les éléments sont reconnaissables, leur séquence est archaïque (grand-ir « devenir grand », vieil-ir « devenir vieux », etc., banal-iser « rendre banal »).
Ces exemples, peu corrects mais courants, montrent que les groupes être + substantif, avoir + substantif, faire + substantif sont conçus comme des ensembles, modifiés globalement par l’adverbe. La même remarque s’applique aux fautes de si : J’avais si faim (Z une telle faim) et de beaucoup : J’ai beaucoup faim, Cela m’a fait beaucoup plaisir (Z grand faim, grand plaisir), qui achèvent de signaler la cohésion de ces syntagmes.
C’est d’ailleurs la même tendance au verbe analytique et progressif qui commande l’emploi de la formule être + adjectif transitif, si fréquente dans le français cursif et courant : Cet homme est représentatif de son époque (Z représente), cette lettre est symbolique de son état d’esprit (Z symbolise).
2) Condensation (phrase > mot, syntaxe > morphologie)
Logiquement, c.à.d. si le langage était rivé à la pensée, toute phrase se résumerait dans un rapport unique de sujet à prédicat. En réalité, une seule et même phrase peut, à l’aide de condensations variées, porter l’expression de ce rapport au multiple. Ainsi le verbe réciproque permet de condenser au moins deux phrases : Pierre et Paul se battent = Pierre bat Paul, et Paul bat Pierre. La comparaison porte toujours sur deux jugements, mais le langage peut résumer ce rapport en une phrase unique : Pierre est plus grand que Paul = Pierre a telle grandeur, Paul a telle grandeur, le rapport de grandeur de l’un à l’autre est tel. Dans tout le domaine du langage, le besoin d’économie remplace la série monotone de phrases simples alignées bout à bout, par des ensembles complexes dans lesquels les propositions sont subordonnées les unes aux autres pour former des phrases uniques.
La condensation a pour fonction de transposer une phrase en un membre de phrase, qui peut fonctionner dès lors à son tour comme terme dans une phrase complexe. 175Exemple : la rose est rouge > la rose rouge ; la phrase ainsi transposée en membre de phrase fonctionne à son tour comme sujet dans une phrase plus complexe : la rose rouge s’est ouverte, etc.
La condensation comporte naturellement des degrés variés, que nous examinerons. Mais on peut poser dès le début un trait commun à l’ensemble de la syntagmatique : le caractère dichotomique de tout syntagme. Précisément parce que toute syntagmatique se ramène, statiquement aussi bien qu’historiquement, au rapport initial de sujet à prédicat, les syntagmes, quel que soit leur degré de condensation, s’analysent toujours de deux en deux. Il y a toujours un terme déterminé, un terme déterminant, et un signe de rapport qui les relie ; le déterminé est un sujet ou un sujet, condensé, le déterminant un prédicat ou un prédicat condensé, le signe de rapport un verbe transitif ou un verbe transitif condensé. Exemple : la femme a le panier > la femme qui a le panier > la femme avec le panier > la femme au panier. Cet exemple provisoire montre que la préposition a pour fonction de condenser un verbe transitif, et que le régime de la préposition n’est autre chose que l’objet condensé de ce verbe. Nous dirons en résumé : Rien n’est dans les syntagmes étroits qui ne soit d’abord dans la phrase, rien n’est dans la morphologie qui ne soit d’abord dans la syntaxe.
Ce passage de la phrase au mot sera considéré, dans les pages qui suivent, du point de vue statique et notamment sous l’angle du besoin d’invariabilité ; ce dernier demande que la condensation s’effectue avec le minimum de changements dans la forme et dans la séquence des éléments.
Dans la forme. — L’idéal serait que le même élément puisse fonctionner dans la syntagmatique libre et dans la syntagmatique condensée. Cf. un homme politique (un politicien), une étoffe genre bleu (bleuâtre), la partie machines (la machinerie), manière d’agir (agissement), le fait de diminuer (la diminution), etc.
Dans la séquence. — Si l’on ne considère que le français traditionnel, il y a divergence séquentielle, sur la plupart des points, entre syntagmatique libre (syntaxe) et syntagmatique 176condensée (morphologie) : Cet homme fait de la politique > un politic-ien ; cette partie comprend les machines > la partie qui comprend les machines > la machine-rie, etc. Le français avancé cherche à établir au contraire le parallélisme sujet + prédicat > sujet condensé + prédicat condensé. Cf. un homme politique, la partie machines, etc.
L’interchangeabilité séquentielle peut être obscurcie par plusieurs faits. C’est par exemple l’intervention d’un autre besoin, comme en anglais ou en chinois, où le besoin de clarté oblige à différencier par la séquence la phrase et le groupe nominal : the man is great, chin. jên tá / the great man, chin. tá jên. Mais c’est aussi le fait que les diverses parties d’un système linguistique n’évoluent pas avec la même rapidité. Quand une langue adopte un nouveau type de séquence — et l’on sait que l’évolution de l’indo-européen aux principales langues modernes est en partie dominée par le passage de la séquence régressive (prédicat + sujet) à la séquence progressive (sujet + prédicat) — elle l’introduit d’abord dans la syntagmatique libre, et c’est ensuite seulement que le besoin d’invariabilité l’étend graduellement aux éléments de phrase condensés. Il en résulte que dans une langue donnée la morphologie peut être en retard sur la syntaxe : beaucoup de syntagmes du français traditionnel reflètent un type de phrase qui devait être celui de l’indo-européen.
a) Le subordinatif.
La préposition, avons-nous dit, est un verbe transitif condensé. Quelques distinctions sont à faire.
De même que le signe de rapport reliant le sujet et le prédicat peut être plus ou moins différencié (verbe transitif) ou générique (copule), la préposition reflétera à son tour cette différence ; il y a des prépositions plus ou moins « pleines » ou « vides » (cf. possédant, pourvu de, ayant, avec, à).
En outre, le signe transitif condensé, que nous appellerons désormais d’une manière générale le subordinatif, varie selon la nature de son régime : suivi d’un substantif ou d’un adjectif, le subordinatif est une préposition (après son départ) ; 177suivi d’une proposition, il se mue en conjonction (après qu’il est parti).
Si la préposition est bien un verbe transitif condensé, le besoin d’invariabilité exigerait que le passage de l’un à l’autre puisse s’accomplir avec le minimum de changements dans la forme et dans la séquence. Mais dans nos langues indo-européennes où le verbe et la préposition sont généralement séparés par une barrière formelle rigide, cette exigence ne se réalise que fort imparfaitement. Commencerions-nous à douter de la solidité de notre hypothèse ? L’exemple du chinois parlé, qui représente à peu près l’idéal de ce qu’une langue peut atteindre dans ce domaine, est là pour nous rassurer. La grande majorité des prépositions chinoises courantes (plus d’une cinquantaine) sont interchangeables avec le verbe correspondant. Selon le rôle qui leur est assigné dans la phrase, elles fonctionnent tantôt comme des verbes transitifs tantôt comme des prépositions : yèu « avoir, avec, à » ; yóṅ « se servir de, au moyen de » ; pì « comparer, comparativement à », ; taí « remplacer, à la place de » ; wàṅ « aller, vers (ad) » ; etc..
A défaut d’une solution aussi idéale, trouverait-on en français des cas montrant au moins la tendance à garder le contact entre la préposition et le verbe ? Les procédés traditionnels sont le participe présent (votre réclamation concernant la livraison), le pronom relatif (votre réclamation qui concerne…), l’adverbe transitif (il a agi inconsciemment de son acte) ou une préposition composée. Le rôle principal de cette dernière est de garder le contact avec le signe plein : à partir de, à cause de (= ayant pour cause), etc. Et de fait le sort de la préposition composée est lié à celui du verbe ou du substantif (verbalisé) correspondant. Ainsi fin dans la langue parlée ayant cédé la place à but, le lien entre fin et à fin de s’est effacé : le passage de fin à but entraîne celui de afin de à dans le but de (qqf. à but de).
Subordinatifs d’inhérence. — Si le subordinatif condense un transitif (verbe ou copule), il doit y avoir, parallèlement à la distinction entre transitifs de relation et transitifs d’inhérence (ex. être, se trouver, sembler, paraître, devenir), des subordinatifs 178de relation et d’inhérence. On aurait tort de croire que les prépositions et les conjonctions servent exclusivement à l’expression du rapport de relation. Cf. une chambre de libre (< qui est libre) ; on l’a engagé comme contremaître ; il a fait cela comme je le voulais ; il parle en connaisseur ; le vin s’est changé en vinaigre, etc.
Prépositions et postpositions. — Le besoin d’interchangeabilité (entre le v. transitif et le subordinatif) porte non seulement sur la forme mais encore sur la séquence. Si le v. transitif d’une part, le subordinatif de l’autre, sont parallèles, il en résulte une loi importante : Dans la mesure où l’interchangeabilité séquentielle est respectée, les langues à phrase progressive (v. transitif + prédicat) sont des langues à prépositions (et à conjonctions préposées), les langues à phrase régressive (prédicat + v. transitif) des langues à postpositions (et à conjonctions postposées).
Cette loi semble se vérifier grosso modo. La plupart des langues à verbe médial (l. européennes, l. bantoues, chinois, etc.) sont des langues à prépositions. L’hindoustani, le japonais et les langues turco-mongoles au contraire, où le verbe transitif est postposé au prédicat et termine la phrase, sont des langues à postpositions.
Un autre parallélisme, qui ne se vérifie en général qu’à très longue échéance, est celui entre le verbe postposé et la flexion terminale d’une part, le verbe préposé et la flexion initiale de l’autre. En effet, de même que le verbe transitif se joint à son prédicat en un groupe plus ou moins serré (domus uac-at, la maison est-vide), le subordinatif fait corps avec son régime (groupe prépositionnel ou postpositionnel : il travaille avec-moi, me-cum laborat). De là à l’affixation (préposition > préformante ; postposition > postformante), il n y a qu’une question de plus ou de moins. Le japonais et l’hindoustani d’un côté, le français et l’anglais de l’autre, fournissent l’exemple de langues dont l’évolution est arrivée à l’étape qui précède la flexion terminale, respectivement la flexion initiale.
On sait qu’un très grand nombre de langues indo-européennes ont perdu ou sont en train de perdre la flexion terminale héritée de l’indo-européen, et qu’elles l’ont remplacée, ou sont en train de le faire, par l’usage de prépositions. Le français a perdu la flexion casuelle. Deux théories se sont heurtées et se heurtent encore pour expliquer ce changement de front.
Les uns prétendent que c’est l’usure phonique (débilité des finales) qui a provoqué, par réaction, le développement des prépositions destinées à suppléer les terminaisons déficientes. Or il est remarquable que dans les états de langue les plus anciens, où le passage du type de phrase régressif (prédicat + verbe transitif) au type progressif (verbe transitif + prédicat) ne s’était sans doute pas encore opéré, les particules ajoutées aux cas débiles ou équivoques n’ont pas été des prépositions mais des postpositions 179(ci. le -ā renforçant les locatifs sanscrits et iraniens ; le -de du directif ajouté à l’accusatif grec : πόλιν-δε « ad urbem »).
D’autres prétendent que c’est au contraire la création des prépositions et la fixation de la séquence sujet + verbe + prédicat (servant de signe) qui a fait disparaître les terminaisons casuelles désormais inutiles (Sechehaye, Programme et Méth. de la Lingu. Théorique, 175 sv ; Horn, Sprachkörper u. -funktion, 112).
Il semble que l’élimination des terminaisons casuelles et la création des prépositions soient en gros des faits concomitants entre lesquels on ne peut voir ni dans un sens ni dans l’autre un rapport historique de cause à effet, mais que l’une et l’autre se laissent ramener à un seul principe : le passage de la séquence régressive (prédicat + verbe) à la séquence progressive (verbe + prédicat). La nouvelle séquence des éléments de la phrase a rendu archaïques les subordinatifs postposés (postpositions et terminaisons) et provoqué la création de subordinatifs préposés (répondant aux verbes préposés), en même temps que les postpositions disparaissaient et que les terminaisons casuelles se dévaluaient et tombaient à leur tour.
Il faut noter à part le cas, assez rare, où la conjonction est transposée en préposition à la suite d’une ellipse (mémorielle ou discursive) : Elle a été opérée quand moi « quand j’ai été opéré » > « en même temps que moi ».
Le subordinatif devant un infinitif est une préposition : le traitement de cette dernière est varié : Tantôt elle est rapprochée de la conjonction (avant de venir × avant qu’il vienne > avant que de venir), tantôt elle est solidaire de la préposition suivie d’un substantif (à force de travail > à force de travailler), tantôt elle manque (à cause de /… ; tout au plus a-t-on avec le passé : il a été puni pour avoir désobéi).
b) Les déterminants du substantif.
Le besoin d’invariabilité demande : 1. que le prédicat ne change pas de forme en devenant déterminant (exemple négatif : cette maison est ici > cette maison-ci) ; 2. que le verbe transitif ne change pas de forme en devenant subordinatif (ex. négatif : avoir du courage> courag-eux) ; 3. que la place du subordinatif (avant ou après le déterminant) corresponde à celle du verbe transitif (avant ou après le prédicat) (ex. négatif : faire impression > impression-nant).
Une phrase indépendante peut être transposée en un déterminant à l’aide de deux procédés : la proposition participiale (type ancien) et la relative (type moderne). Exemples : Il apporte le pain > Le garçon apportant le pain est arrivé, ou : Le garçon qui apporte le pain est arrivé. On aperçoit aisément la différence de séquence entre la participiale et la relative : apportant / qui apporte ; la première répond au type régressif (déterminant + subordinatif), la seconde au type progressif fsubordinatif + déterminant). Et de fait la proposition participiale a aujourd’hui un import écrit et archaïque ; le type vraiment moderne est la relative. On remarquera que pour transposer une phrase en un déterminant de verbe, le français n’a pas encore dépassé le stade de la proposition participiale (gérondif français) : le garçon est arrivé en apportant le pain (le nouveau type serait : *le garçon est arrivé qu’il apportait le pain).
Dans les propositions relatives « réfléchies », c.à.d. dans les phrases où le substantif que la relative détermine est en même temps l’objet du verbe de la relative (ex. la lettre que j’ai écrite), les grammairiens, à la suite d’un usage ancien, ont établi la règle que le participe passé doit s’accorder avec cet objet (la lettre qu’il a écrite).
On a beaucoup ferraillé sur ce problème, qui est en somme très simple. L’accord du participe passé est au fond un procédé de conformisme grammatical, qu’on peut mettre sur le même plan que la concordance des modes (Je veux qu’il 182vienne) et la concordance des temps (Je croyais que Genève était une belle ville). Seulement, et voilà le point important, l’accord n’est nullement indispensable à l’intelligence de la phrase, et le besoin d’invariabilité, qui exige que la transposition s’effectue avec le minimum de changements formels, cherche naturellement à se défaire de ces procédés qui augmentent inutilement l’effort de mémoire à fournir : Je veux qu’il vient, Je croyais que Genève est une belle ville, La lettre qu’il a écrit.
Que la suppression de cet accord s’imposera tôt ou tard, les faits qui le montrent ne sont plus à compter. Pour ne pas dire ou écrire : la peine qu’on a pris, la boîte qu’elle a ouvert, après toutes les injures qu’on s’est dit, les conséquences qu’il a craint, la personne que j’ai plaint, la récompense qu’il a promis, etc. etc., il faut savoir aujourd’hui d’avance, et uniquement en vertu des règles enseignées à l’école et dans les livres, que de tels tours sont incorrects.
On sait d’autre part que là où l’accord n’est marqué que par une particularité phonique — la longueur de la finale (la lettre qu’il m’a adressée, la lettre que j’ai reçue) — la langue parlée, à Paris tout au moins, n’allonge plus guère cette finale : la lettre qu’il m’a adressé, la lettre que j’ai reçu.
Une autre entrave au besoin d’invariabilité est dans la séquence. La proposition relative correcte présente des cas où le verbe, contrairement au type de séquence établi dans la phrase indépendante, précède son sujet, notamment lorsque ce dernier forme un groupe assez long : les gares que traverse la ligne directe de Paris à Lyon. Le français avancé tend à écarter cette survivance ; il ne dira jamais, par exemple : les propos que tiennent tous ces gens-là, ni guère : le travail que fait votre ami.
Le traitement du pronom relatif dans le langage populaire mérite une étude spéciale. Le français traditionnel n’a pas de pronom relatif invariable, applicable indifféremment à tous les cas, mais il est obligé de se servir de signes distincts, qui varient en fonction de leur contexte : la chose dont j’ai besoin / la rue où l’accident a eu lieu / l’homme qui est venu / 183le monsieur que j’ai vu / une chose à laquelle il faut faire attention, etc. Dans chacun de ces cas, le pronom relatif est obligé de changer de forme en fonction de la phrase qu’il est chargé de transposer en déterminant.
Dans certains cas, ce que s’est installé par assimilation au que de l’objet direct, grâce au caractère locutionnel du groupe auquel il se rapporte : une chose que j’ai peur (× que je crains), une chose qu’il faut faire attention (× qu’il faut remarquer). Mais cette explication n’a qu’une valeur limitée ; la généralisation du que répond au besoin de disposer d’un instrument invariable remplaçant tous les autres relatifs.
Mais la création et l’extension de ce que invariable ne satisfait pas encore pleinement le besoin d’interchangeabilité. Les matériaux que livre sur cette question le français avancé ont une portée plus étendue ; la définition et l’existence mêmes du pronom relatif sont en jeu.
On remarquera tout d’abord ce fait significatif que le pronom relatif n’est pas un rouage indispensable au fonctionnement du langage. Sans parler des langues où le relatif peut être sous-entendu (angl. the man I saw yesterday ; there is a man wishes to speak with you), certains idiomes, tels que le chinois et le japonais, ne le connaissent même pas.
C’est que le pronom relatif, par sa constitution, est contraire au besoin d’invariabilité. D’une part, en effet, il suppose le cumul d’un subordinatif (que) avec un pronom qui représente l’antécédent à un certain cas ; exemples : l’homme dont je n’ai pas de nouvelles « que (je n’ai pas de nouvelles) de lui » ; la maison où il habite « que (il) y (habite) » ; la femme qui est venue « que-elle (est venue) ». Ainsi donc, un seul et même signe tantôt a sa forme indépendante (de lui, y, elle), tantôt est logé par cumul dans ûri autre signe (dont, où, qui). Il y a cependant des cas où le relatif est bien un syntagme : lequel, duquel, auquel, à quoi, etc. ; même alors, il est contraire au besoin d’invariabilité. Car d’autre part il entrave l’interchangeabilité séquentielle entre la phrase 186indépendante et la proposition relative : l’homme dont (duquel, de qui) je n’ai pas de nouvelles / je n’ai pas de nouvelles de lui ; la maison où (dans laquelle) il habite / il y habite.
Après avoir signalé le décumul du pronom relatif aux cas obliques, nous allons constater la même tendance dans le traitement des cas directs. On aurait tort, par exemple, de parler de pléonasmes à propos de phrases du genre : C’est des types que le malheur des autres les amuse, Ceux que ça les intéresse pas n’ont qu’à s’en aller ; Vos enfants que j’ai toujours bien hâte de les voir (Prein 29). — Que doit être interprété ici non pas comme un accusatif (lat. quos), mais comme une simple conjonction vide. Sans doute, ces exemples sont empruntés à un étage de la langue taxé de trivial ; mais qui pourrait se vanter de ne jamais commettre de ces fautes, dans le parler déboutonné de tous les jours ? Et le type répond à une tendance si profonde qu’il vient s’introduire subrepticement jusque dans la prose de quelques grands écrivains : II est certaines choses que, une fois que nous les avons sues, nous les savons toujours (Malherbe, Stapfer 59) ; Sous ce nom, difficile à porter, et qu’il fallait tant d’espoirs pour oser le prendre, il a conquis la faveur de l’univers (Valéry, disc. de réception à l’Acad.).187
On voit nettement que le décumul du relatif et le libre échange entre l’indépendante et la relative se conditionnent réciproquement.
On notera aussi l’interprétation de qui par qu’il : Le vase qu’il est sur le piano, C’est eux qu’ils sont les riches (B 103), Le voilà qu’il s’amène (Joran n° 22). Ce décumul de qui en qu’il est notamment une des causes de l’ll redoublé, si caractéristique du langage populaire : Celui qui ll’a paumé, Celui qui ll’a fait venir (B 110) ; le découpage est en réalité : Celui qu’il l’a paumé, Celui qu’il l’a fait venir.
On sait d’autre part que la langue familière et surtout la langue populaire omettent souvent l’l : i vient. Il est donc permis de supposer que la conscience linguistique, là où la langue écrite découpe : C’est lui qui vient, analyse en réalité : C’est lui qu’i vient, Je les ai entendus qu’i discutaient, Je les ai vus qu’i venaient. La fausse liaison dans : Ils sont là qui-z-attendent, peut s’expliquer par le décumul : Ils sont là qu’i(l)s attendent.
Ce décumul en qu’il impersonnel est artificiel dans la mesure même où le il impersonnel est devenu artificiel en 189face de cela (ça) : Il m’ennuie de… > Ce qu’il m’ennuie, c’est de…
Ces exemples de dont, où et qui n’ont sans doute pas grand avenir, à côté de l’extension universelle du que. Ils montrent du moins les tâtonnements qui accompagnent d’ordinaire l’installation définitive d’un nouveau type.
Si les idées émises dans ces pages sont conformes à la réalité, le cas du pronom relatif est un bel exemple de la manière dont une tendance — ici le besoin d’invariabilité — en arrive à ses fins à travers une série de petits faits particuliers, dont chacun pris isolément reste inexplicable tant que tous n’ont pas été rattachés à un principe un. La suppression du pronom relatif est un moment de l’évolution irrésistible qui entraîne le français vers le libre échange des signes et des syntagmes d’une fonction à l’autre.
L’adjectif traditionnel peut être variable en genre et en nombre (un homme veuf / une femme veuve ; un effort moral / des efforts moraux), et par la liaison (vieux mur / vieil arbre).
L’adjectif en français avancé marche par des voies diverses vers l’idéal de l’invariabilité.
Un certain nombre d’adjectifs se terminant par c ou j sont invariables, qu’ils soient prédicats ou déterminants : une femme maladif, une balle explosif, une boisson sec, une 191femme veuf (B 94). Cette tendance se manifeste aussi pour d’autres espèces (ex. une femme perdue, Martinon II 270 n), notamment pour le type en -al/aux ; le français semble se montrer de plus en plus réfractaire au pluriel en -aux : v. D’Harvé PB § 156 (de banals parfums, des experts médicals, etc.).
La tendance à la non-liaison est tout aussi accusée : un gran artiste, un vieu arbre, un gro achat, un beau édifice, un nouveau immeuble, etc. Le besoin d’invariabilité l’emporte ici sur la répulsion du français traditionnel contre l’hiatus. Ce dernier n’est d’ailleurs que théorique : « A la vérité, en français il y a toujours liaison ; seulement, dans un cas comme celui-ci, la liaison n’est plus consonantique, elle est vocalique. » (Grammont, Prononc. fr., 136). La « liaison vocalique » ou « prononciation liante » représente donc un compromis entre le besoin d’invariabilité et la tendance à éviter l’hiatus.
La tendance à l’invariabilité de l’adjectif se manifeste aussi dans la réluctance du français avancé à décomposer les finales nasales : un bon (bõn) auteur, en plein (plẽn) air, etc. (bõ = bõn, plẽ = plẽn, au lieu de bõ / bòn, plẽ / plèn).
Il ne suffit pas que l’adjectif soit invariable par rapport à son entourage dans la chaîne parlée. Si l’adjectif déterminant est bien un prédicat condensé, il faut qu’il soit interchangeable avec ce dernier, et cette interchangeabilité doit porter aussi bien sur la forme que sur la séquence.
Beaucoup de langues, en effet, différencient le prédicat (ex. la rosé est rouge) et le prédicat condensé (la rosé rouge) l’un de l’autre, soit par la forme, à l’aide de terminaisons spéciales, soit par la séquence (anglais, chinois).
La place mobile de l’adjectif français, que tout le monde a signalée et décrite, sert à des fins toutes différentes. L’adjectif normal tend à être postposé (la rosé rouge, un brouillard épais, etc.), conformément à la séquence sujet + prédicat (la rosé est rouge, le brouillard est épais). Cette tendance est très forte ; même dans des combinaisons qui paraissaient se figer, le français cherche à supprimer l’antéposition de l’adjectif : la fois prochaine, la fois dernière (× la semaine prochaine, dernière), d’un accord commun (Vittoz 87), s’arrêter à un terme moyen (ib.), etc.192
L’adjectif préposé, au contraire, quand il n’est pas un simple préfixe (tit’fille, tit’maison, etc.), est considéré comme une inversion expressive : un épais brouillard, une verte prairie, une colossale entreprise, etc.
De même que tout prédicat est lié à son sujet par un verbe transitif, tout déterminant est lié à son déterminé par un subordinatif (verbe transitif condensé), exprimé ou non. Tel est le cas pour la préposition de chargée de former le lien entre un substantif actualisé et son prédicatif : une chambre est libre > une chambre qui est libre > une chambre de libre.
Les adjectifs tirés de substantifs marquent la même tendance à préposer le subordinatif : une femme en pleurs (Z éplorée ; type intermédiaire : épleurée, faute fréquente), un arbre en fleurs (fleuri), etc.
Particulièrement intéressants sont les cas où un suffixe 193semi-concret (ex. -âtre, -oïde) fait place à une préformante tirée directement du substantif, réalisant ainsi l’interchangeabilité séquentielle et formelle : une couleur genre bleu (Z bleuâtre), une teinte genre rouge (Z rouge-âtre), une forme genre œuf (Z ov-oïde), une courbe genre ellipse (Z ellips-oïde), etc.
Les adjectifs qualificatifs, qui sont des déterminants d’inhérence, doivent être distingués des compléments de relation. Tandis que les premiers remontent à un prédicat d’inhérence (la rosé est rouge > la rosé rouge), les seconds condensent un prédicat de relation (objet) ; ex. il commande le navire > le commandant du navire.
Le complément de relation (ou génitif objectif) est donc au prédicat de relation (ou : objet direct ou indirect, accusatif ou datif) ce que le déterminant d’inhérence (adjectif qualificatif, etc.) est au prédicat d’inhérence. Dans les deux cas, le besoin d’invariabilité demande que la séquence reste la même : le brouillard est épais > le brouillard épais ; il commande le navire > le commandant du navire ; le livre est à Pierre > le livre de Pierre.
Le même rapport vaut pour les langues en général, et pour leur histoire. Dans la mesure où l’interchangeabilité séquentielle entre phrase et membre de phrase est respectée, les langues à objet postposé sont des langues à complément de relation postposé, et inversement les langues qui comme l’hindoustani, le japonais et les langues turco-mongoles, préposent l’objet au verbe transitif, préposent aussi le complément de relation au substantif déterminé (et sont par conséquent aussi des langues à postpositions). De même, si l’on se place sur le terrain historique, l’évolution du génitif préposé (en indo-européen et en latin) au génitif postposé (l. romanes) apparaît en résumé comme le retentissement, sur la syntagmatique condensée, de l’évolution de la séquence accusatif + verbe transitif (en indo-européen et en lat.) à la séquence inverse : verbe transitif + accusatif.
Contradictions. — a) Cette théorie est en contradiction avec celle du P. W. Schmidt (Sprachfamilien u. -kreise der Erde, 194491-4), qui explique le passage du génitif préposé au génitif postposé, et en même temps le passage de la flexion terminale aux prépositions, par l’intervention d’un facteur externe : le contact avec des langues non indo-européennes. — La linguistique fonctionnelle, sans rejeter en principe l’explication externe, ne la fait intervenir qu’après avoir épuisé les possibilités d’explication par le fonctionnement même du système et par les besoins qui le commandent.
b) Lorsque l’interchangeabilité séquentielle est en défaut, c’est qu’elle est contrecarrée par la tradition (« puissance du matériel linguistique existant »), ou par l’action d’autres besoins, notamment du besoin de clarté. Un facteur important, dans ce dernier cas, est la prédominance de l’emploi de subordinatifs formels (désinences, prépositions, etc.) ou de la juxtaposition pure ; cette dernière pousse l’anglais à différencier par la séquence la phrase (my father is good) et le groupe nominal (my good father), tendance qui devient règle absolue en chinois (sujet + prédicat / adjectif ou complément de relation + substantif).
Mais l’idéal linguistique serait d’obtenir non seulement l’interchangeabilité séquentielle, mais encore l’interchangeabilité formelle entre l’objet et le complément de relation. C’est ce que réalisent certaines langues, sous leur forme parlée plus ou moins populaire (latin de Plaute, bas-latin, etc.) : Quid tibi nos tactio ‘st ? Quid tibi hanc curatio ‘st rem ? Iusta orator « celui qui demande des choses justes » ; Peccatorum ueniam promittor « celui qui promet la grâce des pécheurs », etc. (v. Vendryes, Lang., 150-1). Cf. : J’ai fait des demandes aux Commandants les Dépôts et le 3e Corps, il m’a été répondu présumé en bonne santé (APG).
Quant à l’objet indirect (datif), le type le canif à Pierre (< le canif est à Pierre) est dès longtemps attesté. C’est la même tendance à unifier la rection qui crée la construction si fréquente aujourd’hui : l’élection au Conseil National (Plud’hun 64), les contrevenants au présent arrêté, un adhérent à la Société (Joran n° 3), les morts pour la patrie.
Les adjectifs de relation, qui sont une autre manière de condenser le prédicat de relation (un témoin qui l’a vu de ses yeux > un témoin oculaire ; un concours qui a lieu sur route > un concours routier), intéressent la langue cursive. 195La langue parlée ne les favorise pas, car ils contrarient le besoin d’invariabilité.
D’une part, en effet, le passage du mot « populaire » au mot « savant » que nécessite la création de l’adjectif de relation, est souvent très abrupt : œil / témoin oculaire, sucre / teneur saccharine de la betterave, coupon / impôt cédulaire, poumon / pulmonaire, etc. D’autre part, l’adjectif de relation s’écarte presque toujours de la séquence des éléments de la phrase : le concours a lieu sur une route / routier.
En outre, la langue parlée tend, ici comme pour les adjectifs d’inhérence, à remplacer les suffixes par des prépositions, afin de ne pas changer de séquence dans le passage du prédicat de relation au complément. Les exemples de cette transformation ne sont d’ailleurs guère incorrects : un concours sur route (Z routier), des soldats à casques (Z casqués), un homme à courage (Z courageux), un voyage sur mer (Z maritime), par air (Z aérien), etc. Néanmoins, l’évolution est capitale.
Le déterminatif cumule un actualisateur (article) avec un déterminant (adjectif) de manière à former un signe unique, c.à.d. un syntagme non-analysable dans sa forme. Exemples : mon chapeau « le chapeau de moi », quatre personnes « des personnes au nombre de quatre », cette maison « la maison qui est là, » etc.
c) Les déterminants du verbe.
C’est à l’aide du gérondif que le français condense une phrase en une proposition déterminant le verbe : Il courait > Il est arrivé en courant. Un autre procédé est la proposition circonstancielle, introduite par une conjonction : Il est arrivé en même temps qu’il courait, pendant qu’il courait. Le gérondif et la proposition circonstancielle, qui déterminent le verbe, sont parallèles à la proposition relative qui détermine le substantif. Comme pour cette dernière, le besoin d’interchangeabilité cherche à rendre aussi aisée que possible la transformation de la phrase en une circonstancielle, et entre ainsi en conflit avec les exigences du conformisme grammatical, qui demande au contraire que le verbe varie en fonction de la conjonction qui le régit (cf. l’imparfait après si, le subjonctif après certaines conjonctions, etc.). On ne fera ici qu’effleurer ce vaste sujet.
L’imparfait après si est un procédé de conformisme inutile à l’intelligence de la phrase, et qui entrave l’interchangeabilité entre l’indépendante et la subordonnée. En même temps, il empêche l’expression du mode quand ce dernier demande à être exprimé ; dans ce cas, le langage populaire se sert du conditionnel d’éventualité, absolument comme dans la phrase indépendante : Je pourrais peut-être le voir > Si je pourrais peut-être le voir (Z Je pourrais peut-être le voir/ Si je pouvais…).
La conjonction peut être également obligée de varier, en fonction de son entourage : Quand (kã) je suis venu / Quand (kãt) il est venu. Le français populaire, poussé également par le besoin dé conservation des monosyllabes, unifie par la forme longue dans les deux cas : Quand’ je suis venu, Quand’ nous sommes venus, Quand’ je te dis que ce n’est pas vrai !
Les adverbes relatifs (conj. + adv. cumulés) sont parallèles aux pronoms relatifs. On commence à rencontrer, dans la langue parlée, des cas de décumul qui rappellent ceux du pronom relatif : Je serai parti quand vous viendrez > 200Je serai parti que vous viendrez alors ; Juste au moment où il sortait de chez lui, la lettre est arrivée > Juste qu’il sortait de chez lui à ce moment, la lettre est arrivée ; Il est parti sans qu’on sache pourquoi > Il est parti qu’on ne sait pas pourquoi.
L’adverbe est à la proposition circonstancielle ce que l’adjectif est à la proposition relative. Par métaphore, on peut dire que la fonction de la proposition relative est de condenser une phrase indépendante en un adjectif, tandis que celle de la circonstancielle est de condenser une ndépendante en un adverbe.
Les règles de séquence sont aussi parallèles. De même que le prédicat est postposé à son sujet, la relative et la circonstancielle sont postposées à leur déterminé ; le type régressif latin et pré-latin a été abandonné (filium amans pater → le père qui aime son fils) ; la circonstancielle placée avant le verbe est aujourd’hui désuète et littéraire, sauf dans les constructions absolues : Pour vivre, il faut travailler.
La place de l’adjectif déterminant le substantif et celle de l’adverbe déterminant le verbe, sont soumises au même sort. L’adverbe français tend à être postposé : Tu es maboule un peu ! On m’a dit même qu’il avait été transporté dans une ferme (APG), Je renouvelle aujourd’hui ma demande faite le g octobre, dont nous n’avions eu pas de réponse (id.), etc.
En raison de la même tendance, le subordinatif chargé de former l’adverbe et de le relier au verbe viendra se substituer en tant que « préformante » aux suffixes traditionnels. En effet, la plupart des adverbes de manière de la grammaire courante étant au fond des adverbes d’inhérence, ayant pour base la copule être, la place du suffixe -ment jure avec celle de la copule devant son prédicat : être joli / joli-ment. De là divers types nouveaux en voie de formation eu de développement.
On a cité comme remplaçants éventuels des adverbes en -ment « des formations telles que marcher d’un pas tranquille, d’un pied rapide, parler à voix basse, crier à tue-tête, etc. » (Bally LV 75). Le renversement de la séquence est frappant : claire-ment > d’une manière claire. Le type semble avoir pour le moment un import « écrit », mais il répond à la courbe d’évolution de la langue et il suffirait qu’un ou deux exemples se généralisent pour qu’on obtienne ainsi un préfixe de manière : d’un air…, d’un ton…, d’une manière…, d’une façon…
Parmi les types moins concrets, et par conséquent plus généraux, citons la préformante en, qui fournit des adverbes à peu près corrects : en héros (héroïquement), en douce (doucement), en moins fort, en grand, en clair, etc., et par extension en tête-à-tête et en sous-main (Lancelot 21. 7. 28). La préposition pour forme également des adverbes : pour sûr (sûrement).
Les circonstanciels et adverbes de relation condensent des prédicats de relation pour en faire des déterminants de verbes. Ainsi les adverbes de lieu et de temps sont des adverbes de relation ; on peut toujours leur substituer un verbe suivi d’un prédicat de relation ou une préposition de relation suivie de son régime : ailleurs « à un autre endroit », ici « à cet endroit », toujours « à chaque instant », etc. C’est surtout la préposition à qui sert à former les adverbes de relation : Vendre en ayant des pertes > avec des pertes > avec perte > à perte ; fermer avec une clef > à clef ; à deux mains, à quatre pattes, etc. Ce type est entièrement correct.
d) Adjectif = adverbe.
e) Déterminants affixés.
A un degré de condensation ultérieur, le déterminant est affixé à son déterminé de manière à former avec lui plus ou moins un seul mot : très-grand, si-joli, in-connu, etc. Le besoin d’invariabilité demande naturellement que le passage du déterminant lâche au déterminant étroit s’effectue avec le minimum de changements dans la forme et dans la séquence des éléments.
Le français avancé présente des cas où un adverbe lâche est employé comme adverbe serré (Ici joint quelques timbres pour la réponse, Ici joint vous trouverez dix francs, APG), et inversement un adverbe serré (adverbe de déterminant) comme un adverbe lâche : On a très applaudi sa causerie. Je me suis très amusé ; Tu t’ennuies si de ne pas avoir de mes nouvelles (Prein 75).
Le traitement des préfixes négatifs doit être mentionné à part. Le préfixe traditionnel in- contrecarre de diverses manières le besoin d’invariabilité. D’abord, il est obligé de varier en fonction de l’initiale du mot : in-capable, im’-mangeable, in’-négociable, il-lassable, ir-remplaçable.
La langue populaire, où le besoin d’interchangeabilité prévaut, réagit en généralisant l’une des deux négations, ordinairement l’adverbe libre. Ce type d’unification, que n’ignorent pas les autres langues, est absolument courant dans le français familier et populaire : un homme pas content, un élève pas attentif, une fille pas adroite, etc.
Il ne faut pas oublier que ces schèmes n’ont qu’une valeur théorique, car à mesure que l’on descend dans la morphologie l’invariabilité devient de plus en plus difficile.
f) La substantivation.
Tout syntagme peut être condensé en un substantif : être blanc > la blancheur, marcher > la marche, faire de la politique > un politicien, beau > le beau, etc. Cette fonction que le substantif a de condenser les syntagmes, est essentiellement économique ; la concrétisation et l’abstraction facilitent la manipulation des signes. Mais il faut naturellement que la substantivation, pour être économique, puisse jouer avec le minimum de changements dans la forme et la séquence des éléments.
Nous examinerons successivement le substantif réel, désignant un être ou une chose, et le substantif abstrait.
Tandis que le radical du verbe, en français traditionnel, est obligé de fortement varier, le radical du substantif, plus évolué, est devenu à peu près invariable. Il résiste encore à l’invariabilité dans certains cas, notamment par le nombre et le genre, mais il s’agit là de survivances : cheval / chevaux, fou / folle, etc. Malheureusement, l’élimination de ces vestiges est extrêmement lente ; les formes divergentes se disputent pour servir de modèle à l’analogie (bals, chacals, régals, mais : bateau, chapeau, seau), et les fautes actuelles dues au besoin d’unifier le radical appartiennent à plusieurs types. Ainsi l’on trouve non seulement des amirals, des caporals, élever des bétails, et même : des journals, des œils, mais encore un bestiau, un animau, un hopitau, etc.
Le pluriel des monosyllabes est soumis à un traitement conséquent : le français avancé adopte dans tous les cas la forme à consonne finale prononcée (un œuf = des œuf’, un bœuf = des bœuf’, un os = des os’) ; le besoin d’invariabilité 207marche ici de pair avec le besoin de différencier les monosyllabes en les étoffant.
Qu’il s’agisse du nombre ou du genre, le français tend donc à abandonner les vieilles différences formelles (cheval / chevaux, fou / folle), pour marquer les idées de détermination en dehors du radical.
En français traditionnel, les pronoms également sont souvent obligés de varier en fonction de leur entourage ; tel est le cas pour le pronom ça : Regardez-ça / ce n’est pas vrai / c’est vrai. Le français avancé cherche à le maintenir invariable : On verra voir si ça est vrai, ça (B 153) ; ça n’est pas vrai ; ça n’est pas ça ; c’est pourquoi faire, ça qu’il a derrière ?
Les substantifs composés et dérivés ont pour fonction de condenser une phrase en un substantif : il fait de la politique > un politicien, il cultive la terre > un cultivateur, le pot est pour le lait > le pot à lait, ce timbre sert de réclame > un timbre-réclame, etc. Pour rendre aussi aisé que possible le passage de la phrase au composé ou au dérivé, il est clair que le besoin d’invariabilité cherchera à réaliser, d’une manière plus ou moins approchante, l’identité formelle et séquentielle de l’une à l’autre.
En outre, puisque le point de départ des composés et des dérivés est la phrase, la séquence sujet + prédicat devrait, en vertu du besoin d’invariabilité, fournir l’ordre radical + affixe (postfixe ou postverbe). Nous avons donné plus haut quelques exemples de cette tendance : progresser > marcher en avant, rétrograder > marcher en arrière, poursuivre > courir après, etc. ; roue avant, roue arrière, centre demi, etc.208
La langue cursive s’est créé un type qui permet l’interchangeabilité entre syntagmatique libre ou étroite : les produits miniers méditerranéens, la science chimique allemande, le mouvement poétique moderne, etc. (v. Thérive FLM 109 sv). Il ne s’agit pas là d’adjectifs accumulés, mais de groupes nominaux (substantif + adjectif) fonctionnant comme des composés qualifiés en bloc par un adjectif suivant, et ainsi de suite. Par exemple, un groupe comme des théories sociologiques révolutionnaires s’analyse en un composé (théories sociologiques) suivi d’un adjectif qui le qualifie globalement. De la sorte, un même syntagme peut fonctionner tantôt comme un groupe syntaxique (les langues isolantes, all. die isolierenden Sprachen) tantôt comme un composé (les langues isolantes monosyllabiques, all. die einsilbigen Isoliersprachen).
Les substantifs décompositifs sont formés à partir de substantifs composés ; ce sont des dérivés de composés : linguistique générale > linguiste général ; statistique du travail > statisticien du travail ; pomme à couteau > pommier à couteau ; accident du travail > accidenté du travail ; médaille militaire > médaillé militaire, etc. Ces formations sont caractérisées formellement par le fait que le substantivateur est infixé dans le syntagme (statisticien du travail, médaillé militaire) ; mais le langage populaire tend à supprimer les discontinuités qui se présentent dans l’agencement des signes : chemin-de-ferr-ier (Z cheminot).209
Le substantif abstrait, au lieu de désigner une chose ou un être réels, a pour fonction de condenser une phrase en une entité fictive : la mort « le fait de mourir », la beauté « le fait d’être beau », le professorat « le fait d’être professeur », etc.
Ce procédé favorise éminemment la maniabilité des pièces du système. Le fait n’est pas une chose, ni un être, mais un condensé de phrase construit par le langage ; il n’existe pas tout fait dans la nature : ce sont les sujets pensants et parlants qui le créent pour des raisons de commodité.
Mais cette économie est soumise à des limites ; en français, le substantif abstrait héréditaire pèche doublement — par la forme et par la séquence — contre le besoin d’invariabilité.
Le problème se présente sous beaucoup d’autres faces encore. Ainsi il comporte un aspect phonique : babil est prononcé babiy pour garder contact avec le verbe dont il est tiré. D’autre part, le substantif abstrait héréditaire, pour être compris, suppose souvent la connaissance d’un verbe qui n’existe pas dans la langue même : acception ← lat. accipere, médication ← lat. medicare, etc. ; le français avancé refait ces substantifs à partir de bases connues : dans l’acceptation défavorable du terme, médicamentation, etc.210
Le préfixe comme le suffixe peut être obligé de varier en fonction du radical : enflammer / inflammation, d’où : inflammation (Joran n° 165). « La plupart de nos suffixes ont peu de valeur intrinsèque ; il en est même qui sont interchangeables, sinon au regard du linguiste, du moins dans la pratique : et les étrangers ne sont pas seuls à hésiter sur tel mot qui peut se terminer en age, en erie, en ement, en ité, en ion, en ure… » (Vittoz 55). Et de fait, qui n’a entendu parler de la conformité (Z conformation) d’un objet, de la dentition (Z denture) d’une personne, etc. ?
Le substantif abstrait traditionnel, avons-nous dit, pèche contre l’interchangeabilité par la forme et par la séquence. Par la séquence : l’abstracteur — c’est ainsi qu’on peut appeler le signe chargé de condenser la phrase en un substantif abstrait — est en effet un suffixe (beau-té, professor-at, ven-ue, etc.)
Les propositions qui périphrasent le substantif abstrait sont seules conformes à la séquence actuelle des éléments de la phrase : le fait d’être beau, le fait d’être professeur, le fait d’être venu, ou : de venir, etc. L’abstracteur peut naturellement être plus ou moins générique ou spécialisé ; cf. ac-tion / agisse-ment, le fait d’agir / la manière d’agir (« le fait d’agir ainsi »).
La proposition substantive est en effet l’équivalent moderne du substantif abstrait héréditaire ; elle suppose, explicitement ou à l’état latent : 1. un abstracteur ; 2. un subordinatif (que + proposition fléchie, de + proposition infinitive) ; 3. une proposition, à verbe fléchi ou non.
La linguistique fonctionnelle semble ainsi pouvoir résoudre, par l’étude du langage spontané contemporain, un problème qui était réservé jusqu’ici à la linguistique de musée : l’antériorité historique du substantif abstrait ou de la proposition substantive. Au point de vue du chargement de séquence, le remplacement graduel des substantifs abstraits héréditaires par des propositions substantives peut d’ailleurs être mis en parallèle avec le passage de la proposition participiale traditionnelle à la relative moderne : ex. la préparation du pain > le fait de préparer le pain = le boulanger 211préparant le pain > qui prépare le pain. Il s’agit là, comme pour tant de choses dans le langage, d’une évolution longue et lente, où le remplaçant et le remplacé coexistent pendant des siècles.
La présence de l’abstracteur est d’ailleurs normale dans le domaine des conjonctions de subordination, car chacune au fond transforme son régime en un substantif abstrait : Elle est fâchée de ce qu’il est parti = du fait qu’il est parti = de son départ ; cf. à ce que = au fait que, en ce que = dans le fait que, etc.
On remarquera — nous insistons sur ce point que les manuels ignorent — le parallélisme des subordinatifs de et que, chargés de relier l’abstracteur à la proposition qu’il substantive : Je promets que je viendrai demain = je promets de venir demain (théoriquement : le fait que, le fait de). La seule différence est d’ordre normatif ; le que est obligatoire, tandis que le de n’est pas encore toléré devant tous les infinitifs.
L’infinitif précédé de de a été condamné par divers grammairiens. « Si l’infinitif-su jet est parfaitement admissible et s’il est excellent de dire : Pleurer est lâche, Faire sa soumission eût été logique, nous ne conseillerons jamais d’écrire : De pleurer est lâche, De faire sa soumission eût été logique, D’aller à pied est hygiénique » (Albalat, Comment il ne faut pas écrire, 41-2). Cette tournure rejoint pourtant l’usage classique, et répond à la tendance profonde de marquer explicitement les rapports grammaticaux.
Par ricochet, ce de s’étend aux prépositions, à commencer par pour : C’est pour de rire (Joran n° 84), et plus explicitement : Je pense toujours à vous tous pour ça de travailler les chevaux enfin faites votre mieux (Prein 68).
Note. — Le parallélisme des subordinatifs de et que est d’ordre général ; on en trouve l’équivalence dans d’autres langues : all. dass — zu ; angl. that = -ing, etc.
3) Transposition linéaire
Les types transpositifs étudiés dans les pages qui précèdent sont des procédés permettant de condenser la densité des syntagmes. La transposition linéaire consiste à modifier l’étendue ou la direction syntagmatiques des éléments agencés, leur densité et leur signification étant censées rester les mêmes.
a) Changements d’étendue : élargissement et rétrécissement.
Tout verbe intransitif, c.à.d. tout verbe fonctionnant comme prédicat, peut être élargi en admettant un prédicat à sa suite, c.à.d. en devenant à son tour un signe de-rapport ou verbe transitif ; ex. le troupeau sort > on sort le troupeau. Inversement, tout verbe transitif peut être rétréci en un verbe intransitif absolu, par l’ellipse (mémorielle ou discursive) de son prédicat ; ex. il boit du vin > il boit.
Le verbe intransitif absolu diffère du verbe intransitif neutre par le fait que ce dernier constitue toujours plus ou moins un syntagme dans lequel le rapport de copule à prédicat n’est pas analysable par la forme. Exemples : vivre « être en vie », exister « être là, être qch. », évoluer « devenir qch. », agir « faire qch. », etc. etc. Dans le domaine de la syntagmatique étroite, nous verrons que les adverbes synthétiques sont parallèles au verbe neutre (ensuite « après ça », néanmoins « malgré ça », ainsi « comme ça », etc.) et les adverbes absolus parallèles au verbe absolu (après « après ça », malgré « malgré ça », avant « avant ça », etc.).
Essence et existence. — Les discussions des scolastiques et des modernes sur la différence entre essence et existence ou entre 214être et exister (v. Lalande 217, 222, 228), ne sont qu’un problème de langage projeté dans la philosophie. Il s’agit simplement de la distinction entre le verbe transitif (Dieu est grand), le verbe intransitif absolu (Dieu est « existe » ; Je pense donc je suis « existe ») et le verbe intransitif neutre (Dieu existe). De même : devenir / évoluer « devenir qch. » ; avoir / posséder « avoir qch. » ; faire / agir « faire qch. ».
Le même mécanisme d’élargissement ou de rétrécissement peut s’observer dans le domaine de la syntagmatique condensée. De même que tout verbe intransitif peut devenir transitif par l’adjonction d’un prédicat, tout déterminant (adjectif ou adverbe) peut devenir à son tour, par addition d’un complément, un subordinatif ; inversement, tout subordinatrf peut, par ellipse (mémorielle ou discursive) de son régime, fonctionner comme un déterminant.
Le français traditionnel possède tout un stock d’adverbes et de prépositions qui diffèrent par la forme : à / y « à qch., à un endroit », après / ensuite « après cela », dans / dedans « dans cela », de / en « de qch., de qn. », sur / dessus « sur qch. », etc. etc. Dans une langue à interchangeabilité suffisamment développée, on verrait le même signe fonctionner tour à tour comme préposition ou comme adverbe (cf. certains emplois de of « de = en » et de to « à = y » en anglais).
Les grammairiens qui combattent ces adverbes font souvent intervenir l’argument du « germanisme » (Est-ce que vous venez avec ? < Kommen Sie mit ?, etc.) ; mais il s’agit bien plutôt de coïncidences, car le besoin d’unifier la préposition et l’adverbe est commun à toutes les langues.
Le passage de la conjonction à l’adverbe n’est pas aussi fréquent : Il est venu quand même (l. familière, Z tout de même, néanmoins) ; Pourquoi est-ce qu’il n’est pas venu ? Parce que.
Les cas d’élargissement ou de rétrécissement syntagmatiques étudiés jusqu’à présent portent sur l’échange entre un signe de rapport (verbe transitif, subordinatif) et un terme (prédicat, déterminant). Une étude complète du sujet devrait tenir compte d’autres cas encore ; le plus important est l’interchangeabilité entre le substantif et l’adjectif, ou d’une manière plus générale entre le déterminé et le déterminant.
Tout déterminant peut être transformé en un déterminé par l’ellipse de ce dernier, qui est pour ainsi dire absorbé par son déterminant. Exemples : un (homme) politique éminent, un (soldat) porte-drapeau, le vrai (Z ce qui est vrai), surveiller le mental d’un malade (Z l’état mental), la ligne des avants 218(Z des joueurs avants), etc. Ces quelques exemples montrent qu’en réalité ce n’est pas l’article, malgré l’opinion vulgaire, qui substantive le déterminant ; il ne le fait que par ricochet, en signalant le substantif sous roche.
Il s’agit là du type latin bien connu Post urbem conditam « après la fondation de la ville ». Cf. aussi : Ce succès fort modeste ne l’a pas empêché de continuer ; On a fêté les cinquante ans de la société X (Z le cinquantenaire), etc.
Il y a également substantivation lorsque le déterminatif chaque est suivi d’un groupe déterminant + déterminé : Chaque dix minutes « chaque intervalle de… », chaque vingt mètres « chaque espace de… », etc.
Ces nominalisés, comme les substantivés examinés plus haut, servent simultanément le besoin de brièveté et le besoin d’interchangeabilité, le même signe pouvant fonctionner soit comme un déterminant ou par ellipse comme un substantif, soit comme un déterminatif ou par ellipse comme un nominal.
On pourrait comparer les changements d’étendue étudiés dans ce paragraphe, à l’élasticité physique : un seul et même syntagme se distend et se resserre à tour de rôle ; et mieux encore à la contractilité physiologique, en vertu de laquelle la substance organisée se raccourcit dans un sens pour augmenter de dimension dans un autre et vice-versa : le syntagme qui se rétrécit formellement s’enrichit sémantiquement (par absorption de l’ellipse), et inversement le syntagme qui s’élargit formellement s’appauvrit sémantiquement.220
b) Changements de direction : Conversion.
Un autre type de transposition linéaire contribue également à accroître la maniabilité des signes. Nous désignerons sous le terme de conversion l’ensemble des transpositions qui supposent un changement de direction entre les signes agencés, notamment entre le sujet et le prédicat.
Le passif n’est pas une catégorie sémantique. C’est un simple instrument syntagmatique servant à transposer l’objet en sujet, la signification de la phrase étant censée rester la même : Pierre bat Paul Z Paul est battu par Pierre.
Ici comme ailleurs le phénomène de la supplétion induit en erreur. On prétend par exemple que le verbe avoir n’a pas de passif (Brunot PL 362) ; mais si en effet le passif formel du verbe avoir est inusité ou en tout cas artificiel (être eu par…), c’est qu’en réalité il y a supplétion. Le véritable passif du verbe avoir est, au fond, le tour être à : Pierre a le livre Z le livre est à Pierre. Il y’a cependant une nuance : avoir est généralement suivi d’un régime indéterminé (Pierre a un livre), tandis que être à demande un sujet déterminé (le livre est à Pierre). Nous retrouverons ce « décalage logique » a propos de l’impersonnel : les dieux existent Z il y a des dieux.
Le passif en se, qui constitue un gallicisme admis aujourd’hui par la plupart des grammairiens (la maison se construit, cela ne se refuse pas, etc.), n’est pas l’équivalent exact du passif traditionnel ; il sert à convertir un actif à sujet indéterminé : les maçons bâtissent la maison Z la maison est bâtie par les maçons ; mais : on bâtit la maison Z la maison se bâtit, on dit ça Z ça se dit, on le saurait Z ça se saurait, etc.
Au lieu du passif en se, il arrive que la langue moderne se serve directement de la forme active : les meilleures voitures graissent à la Kervoline, l’huile qui s’impose (Z on graisse…) ; ce corsage boutonne par derrière (Z on boutonne…). Cette tournure, qui réalise l’interchangeabilité complète, 221rejoint le type anglais : the book reads well « l’ouvrage se lit aisément », qui sert également à convertir le sujet indéfini.
La confusion formelle de l’agent et de l’objet 2 favorise évidemment l’économie, mais il ne semble pas qu’elle constitue un échange naturel pour le langage : l’agent et l’objet 2 ne sont pas des catégories grammaticales complémentaires.
Il est naturel de retrouver la distinction entre actif et passif dans le domaine de la syntagmatique condensée : une mère soignant ses enfants Z une mère soignée par ses enfants. Mais au passé la différence est surtout écrite : ayant soigné Z (ayant été) soignée par ses enfants.
Le passif à agent indéterminé peut être condensé dans un participe présent : On tache facilement cette étoffe Z Cette étoffe se tache facilement > Une étoffe tachante. Ce type est très employé (une couleur tachante, voyante, salissante, etc.) et n’entraîne guère d’équivoques.222
Le passif 2 sert à convertir l’objet 2 (datif) en un sujet. On a souvent nié l’existence d’un passif de l’objet indirect. Ici encore, c’est le défaut d’interchangeabilité qui cache la réalité du phénomène : Pierre a donné une pomme à la jeune fille Z La jeune fille a reçu (ou : a été gratinée d’) une pomme de Pierre. Dans certaines langues, le verbe actif et le passif 2 sont à peu près interchangeables ; cf. chinois maì « acheter » Z maí « vendre » et, sans différence de ton : tsié « emprunter » Z « prêter ». Cet idéal se réalise rarement dans nos langues ; cf. le propriétaire a loué l’appartement au locataire Z le locataire a loué l’appartement au propriétaire.
En anglais, la forme du passif 1 sert à exprimer également le passif 2 : The boy promised an apple to the girl Z The girl was promised an apple from the boy ; The boy showed the gentleman the way Z The gentleman was shown the way from the boy.
Ces tournures, correctes ou non, permettent au français de transposer assez facilement l’objet 2 en sujet, et doivent donc être mises à l’actif de l’interchangeabilité.
L’échange entre objet 1 (accusatif) et objet 2 (datif) est lié de près au problème du passif 2. Exemple (avec verbe non-interchangeable) : Il lui a donné une montre Z Il l’a gratifié d’une montre. Là encore, l’interchangeabilité est 223chose toute relative, selon les langues. L’allemand possède dans le préfixe be- un transpositeur assez régulier : Er hat ihm eine Uhr geschenkt Z Er hat ihn mit einer Uhr beschenkt, qui lui permet en même temps d’avoir un passif 2 : Er ist mit einer Uhr beschenkt worden.
Il est curieux de constater que la conversion de l’actif en passif ne peut se faire qu’avec les verbes de relation. Pourquoi n’y aurait-il pas aussi un passif de l’inhérence ? Or le rôle du verbe dit impersonnel est précisément de convertir un prédicat d’inhérence en un sujet : Une maison est là Z Il y a une maison, Quelqu’un est-il ici ? Z Y a-t-il quelqu’un ici ? De l’argent m’est nécessaire Z Il me faut de l’argent, Une parole imprudente vous a échappé Z Il vous a échappé une parole imprudente, Mentir est honteux Z Il est honteux de mentir, Vivre n’est plus possible Z Il n’y a plus à vivre, etc.
Selon la curieuse distribution signalée à propos de la conversion du verbe avoir (Pierre a un livre Z le livre est à Pierre), on dit : la neige tombe, mais : il tombe de la neige, Dieu existe Z il y a un Dieu, etc. Ce décalage logique ne doit pas masquer la véritable fonction de l’impersonnel, qui est d’être le passif de l’inhérence.
Nous n’avons cité dans ces pages que les principaux types de conversion. Signalons pour terminer, la conversion du complément de relation en un sujet : Ses cheveux sont 224foncés Z Il a les cheveux foncés, Ton estomac est faible Z Tu as l’estomac faible, etc.
Le type des adjectifs en de (rouge de teint, belle de taille, faible d’estomac, pauvre d’esprit, etc.), qui semble être une innovation de la fin du XIXe siècle (D’Harvé PB § 45, suppl. § 222), permet de convertir une relation possessive : Elle a le teint joli Z Elle est jolie de teint. Ce type est absolument courant et, bien que la littérature l’affectionne, n’a rien de particulièrement littéraire ; cf. Quand on est bas de vue, dit le cycliste, on porte des lunettes (Trib. de police, G.). On remarquera, si l’on tient compte de l’ensemble, qu’entre les deux termes de la transposition il n’y a pas de véritable différence sémantique (teint joli « inhérence » > joli de teint « relation ») ; elle est compensée par le passage inverse de avoir à être (« relation > « inhérence »).
Suppléments
Après avoir étudié les principaux types de transposition grammaticale, nous indiquerons ici les directions dans lesquelles le problème de la transposition peut être élargi encore.
La coordination est un rapport de sujet à prédicat entre deux phrases indépendantes ou leurs équivalents (termes coordonnés), tandis que la subordination ne forme au contraire un rapport de sujet à prédicat qu’entre les parties d’une seule 225et même phrase. Le critère de la différence entre subordination et coordination réside donc dans la portée des signes, l’élément subordonné ne portant jamais que sur une partie de la phrase, tandis que l’élément coordonné s’applique toujours à une phrase entière. Exemple : Je suis resté chez moi parce qu’il pleut (parce qu’il pleut ne porte que sur le verbe : rester parce qu’il pleut = subordination) / Je suis resté chez moi, car il pleut (car il pleut porte sur l’ensemble de la phrase précédente = coordination).
Le rapport de coordination n’est pas autre chose qu’une sorte d’élargissement de la subordination et l’on peut retrouver dans celle-ci, transportés sur une autre échelle, les principaux mécanismes transpositifs valables pour la subordination ; condensation, transitivation, etc.
La coordonnée-prédicat, ou prédicat psychologique, peut être définie comme un prédicat dont le sujet est une phrase indépendante : Il est parti, c’est malheureux. Par condensation, ce prédicat peut être logé dans un adverbe (« adverbe de phrase ») : Il est parti, malheureusement — adverbe séparé de son déterminé par une pause marquant qu’il porte sur la phrase entière.
Le coordinatif, ou conjonction de coordination, a pour fonction de relier deux coordonnées sujet et prédicat l’une de l’autre. Le coordinatif peut être latent, c.à.d. un signe zéro ou sous-entendu. Dans les coordinations du type Il est parti (,) malheureusement, c’est la pause qui remplit l’office de coordinatif. Pour expliquer la formation du coordinatif explicite et pour comprendre son rôle, il faut faire appel aux notions de condensation et de transitivation.
La formation du coordinatif par transitivation d’une prophrase constitue un cas limite : Ils sont jaloux, pire, ils s’en veulent à mort ; Il ne veut pas se repentir, bien plus, il récidive ; cf. lat. magis → mais. L’adverbe de phrase étant lui-même une prophrase, les deux cas sont au fond identiques.
Le fait que la coordonnée, en français héréditaire, doit subir une inversion, est au fond un de ces nombreux exemples de conformisme grammatical que nous avons signalés dans les parties précédentes du livre : le signe est obligé de varier en fonction du rapport grammatical qui le lie au reste de la chaîne parlée. La lutte contre l’inversion n’est ici qu’un épisode du conflit qui met aux prises le conformisme et le besoin d’invariabilité.
Les phrases coordonnées peuvent être condensées d’une manière plus ou moins étroite en termes coordonnés. Il y a par exemple des groupes coordinatifs (Pierre et Paul sont partis ; Il a examiné, fouillé et retourné tous les tiroirs), des substantifs coordinatifs (père et mère), des adjectifs coordinatifs (rouge-blanc-bleu ; franco-suisse), des ordinaux coordinatifs (le un deux et troisième jours de novembre ; c’est la cinq ou sixième fois qu’il recommence), etc.
Comme on le voit, la coordination asymétrique est fréquente dans le langage courant et cursif de nos jours ; mais il va sans dire qu’on en trouve des exemples tout au long de l’histoire du français.
Quant à l’échange entre subordination et coordination, il est relativement aisé. En principe, le français permet de transformer au moyen d’une simple pause n’importe quel adverbe de verbe en un adverbe de phrase : Il est parti rapidement (subordination) > Il est parti (,) rapidement (coordination). Parallèlement, toute conjonction de subordination peut être transposée en une conjonction de coordination au moyen d’une pause précédente : Il est parti parce que vous l’avez voulu > Il est parti (,) parce que vous l’avez voulu (on voit pourquoi car tend à disparaître de la langue parlée). Dans la langue écrite, la pause qui permet cette transposition est 229signalée soit par une virgule soit par un point (procédé de style) : Il est parti. Rapidement | Il est parti. Parce que vous l’avez voulu.
Transposition discursive. — La transposition telle que nous l’avons étudiée, et telle qu’on la rencontre ordinairement, est un procédé d’ordre mémoriel ; la catégorie de base n’est pas énoncée précédemment dans le discours, mais se trouve logée dans la mémoire. Il y a des cas cependant où le point de départ est dans la chaîne parlée même et vient à être transposé, à l’aide d’une représentation ou d’une ellipse discursives, dans une autre catégorie. Voici quelques exemples de cette curieuse alliance entre la brièveté et l’interchangeabilité.
Considérée du point de vue normatif, la transposition discursive choque en général comme une incorrection des plus grossières. Les gens bien parlants ont de la peine à admettre ce double rôle accordé simultanément à un seul et même signe. Mais du point de vue fonctionnel on aurait tort de voir un fait pathologique dans cette alliance de la brièveté et de l’invariabilité, qui constitue au contraire un des points culminants de l’économie linguistique
Transposition phonique. — Le problème de la transposition comprend tout un aspect phonique, qu’une étude plus complète que la nôtre ne devrait pas négliger. Il s’agit notamment de l’échange entre unités et sous-unités ; selon les cas, le passage de l’une de ces catégories phoniques à l’autre peut supposer un changement de forme ou non : moi / je, toi / tu, lui / il, eux / ils, soi / se, quoi / que, etc. ; mais : 231nous = nous (ex. nous, nous nous amusons), vous = vous (ex. vous, vous vous amusez). On voit que nous et vous, au rebours des autres pronoms, peuvent fonctionner correctement tantôt comme unités tantôt comme sous-unités.
Le français avancé présente des exemples montrant le besoin de supprimer la barrière formelle entre unité et sous-unité : Dépêche-te ! Le passage inverse est plus fréquent ; ainsi dans le type : Je ne sais pas quoi faire, Il ne savait pas quoi répondre, le quoi — normalement une unité — fonctionne en qualité de sous-unité (quoi = quoi, au lieu de quoi / que).
Transposition interlingue. — L’emprunt de mot, et le calque ou emprunt de syntagme, ne sont pas autre chose que des transpositions de langue à langue. D’un point de vue large, on pourrait appeler soit l’emprunt une transposition interlingue, soit la transposition (sémantique ou syntagmatique) un emprunt intralague. Car le besoin d’invariabilité tend non seulement à faciliter le passage des signes d’une catégorie à l’autre à l’intérieur d’une même langue, mais encore à permettre leur passage invariable d’une langue à l’autre : immense sujet, dont nous ne faisons qu’indiquer le principe, et la place dans l’ensemble.
Dans le domaine de la transposition intralingue, le besoin d’économie cherche à créer des signes invariables et mobiles, c.à.d. interchangeables d’une case de l’échiquier à l’autre. Dès lors que l’on considère l’ensemble des langues de grande communication comme un tout unique — et cette considération, au train dont va la civilisation moderne, semble devoir s’avérer — on peut s’attendre à une marche parallèle vers l’invariabilité d’une langue à l’autre : les emprunts et les calques, si fréquents dans les langues modernes (européennes ou non), marquent la préoccupation de créer un vocabulaire de caractère international, formé de signes internationaux.232
Chapitre V Le besoin d’expressivité
Les besoins étudiés dans les chapitres qui précèdent peuvent tous se grouper plus ou moins sous un chef unique : le besoin de communication. Les signes qui servent à la communication doivent être assimilés les uns aux autres et classés en catégories, en même temps ceux qui ne sont pas du même ordre doivent pouvoir être aisément distingués lés uns des autres ; en outre, ils doivent être économiques, c.à.d. brefs et invariables. Mais « la pensée tend vers l’expression intégrale, personnelle, affective ; la langue cherche à communiquer la pensée vite et clairement : elle ne peut donc la rendre que dans ses traits généraux en la dépersonnalisant, en l’objectivant. Plus les échanges se multiplient, plus la communication travaille à l’encontre de l’expression personnelle. » (Bally LV 148).
Examiné du point de vue de l’évolution, le langage présente un passage incessant du signe expressif au signe arbitraire. C’est ce qu’on pourrait appeler la loi de l’usure : plus le signe est employé fréquemment, plus les impressions qui se rattachent à sa forme et à sa signification s’émoussent. Du point de vue statique et fonctionnel, cette évolution est contre-balancée par un passage en sens inverse : plus le signe s’use, plus le besoin d’expressivité cherche à le renouveler, sémantiquement et formellement.233
Bally, Traité de Stylistique Française, 19213.
Bally, Mécanisme de l’expressivité linguistique (LV 139 sv).
Lorck, Die Erlebte Rede, 1921.
Ogden and Richards, The Meaning of Meaning, 19272, chap. VII : The Meaning of Beauty.
Paulhan, La double fonction du langage (Rev. Philos., 1927, 22 sv).
Terminologie. — L’antinomie entre la communication et l’expressivité est bien connue, mais la terminologie diffère d’auteur à auteur : Verstandesrede/Phantasierede (Lorck), langage-signe/ langage-suggestion (Paulhan), symbolic/evocative (Ogden and Richards), etc. — Nous opposerons le signe arbitraire et le signe expressif.
Le besoin d’expressivité n’est pas un besoin simple ; il comporte de multiples aspects. D’une manière générale, on peut distinguer le besoin d’agir sur l’interlocuteur et le besoin de le ménager, c.à.d. le langage actif et le langage passif. Le langage actif embrasse surtout les divers procédés dus à l’exagération ; le langage passif comprend les expressions qui tendent à atténuer la pensée ou le sentiment, les euphémismes, les signes de politesse, etc. Une autre opposition est celle qu’on peut faire entre l’expressivité du langage populaire et celle de la langue littéraire ; leurs procédés sont parallèles, de ce point de vue, et se laissent ramener au même besoin général. — Il va sans dire que dans ce chapitre, qui ne doit constituer qu’une première approximation, on n’insistera qu’incidemment sur ces divers aspects sous lesquels le besoin d’expressivité peut se présenter ; on s’attachera à considérer le phénomène dans sa généralité.
Quand on définit la stylistique comme l’étude du langage affectif, on entend par là d’une manière générale l’étude des sentiments, des émotions, des volontés qui se dégagent des faits de langage. Mais cette affectivité peut être de deux 235espèces. Elle est fortuite lorsqu’elle est dégagée uniquement, et à l’insu du parleur ou malgré lui, par la situation. Ainsi les faits d’évocation de milieux (tels que la prononciation d’un étranger, les termes d’argot échappés accidentellement à un homme de bonne société, la lecture d’un exploit d’huissier, etc.) rentrent souvent dans cette catégorie. L’affectivité par la situation doit être nettement séparée de l’expressivité ; cette dernière, c’est l’affectivité que le parleur cherche à transmettre à son interlocuteur d’une manière plus ou moins volontaire. Tandis que l’affectivité, fortuite, ne relève que de la causalité, l’expressivité suppose au contraire un acte de finalité, c.à.d. un rapport de moyen à fin (de procédé à besoin). La linguistique fonctionnelle ne peut naturellement s’occuper que de cette dernière, qui seule répond à la finalité du signe : le langage simplement affectif n’est pas un langage.
La même opposition peut être formulée en d’autres termes, plus généraux : tout ce qui est affectif n’est qu’un processus, tout ce qui est expressif au contraire est un procédé. La création même du langage — création qu’il ne faut pas chercher à surprendre dans la nuit lointaine des origines mais dans le fonctionnement quotidien de la langue d’aujourd’hui — n’est pas autre chose que le passage du processus au procédé. Un phénomène reste un simple processus fortuit tant qu’il n’a pas été mis, par un acte de volonté du sujet parlant, au service d’un besoin donné. C’est ce qu’a clairement vu M. Grammont à propos des combinaisons de sons expressives : « … Un moyen d’expression n’est jamais expressif qu’en puissance, et ne devient impressif que si l’idée le lui permet et le met en évidence. Sans l’idée qui le féconde et le vivifie, le moyen matériel n’est qu’une possibilité irréalisée. » (Vers fr., 31-2 ; v. Bally LV 277). Ainsi tictac et tinter sont expressifs, tactique et teinter, composés des mêmes phonèmes, ne le sont pas.
La même distinction s’applique naturellement aussi aux oppositions sémantiques. Pour qu’une opposition de ce genre soit expressive, il faut qu’elle réponde à l’intention du sujet parlant d’être expressif, sinon elle reste un pur processus (à moins de correspondre à un autre besoin). Ainsi, parmi les exemples de figures que donne la rhétorique, beaucoup 236ne sont pas des procédés expressifs ou ne le sont plus : une voile (bateau), le pied d’une table, les bras d’un fauteuil, etc.. sont aujourd’hui de simples transpositions (« fausses figures »).
Comment définir le procédé expressif ? On sait que d’après la théorie de Saussure le langage est constitué par un système d’oppositions, c.à.d. d’identités et de différences. Or le besoin d’expressivité tend constamment à remplacer les oppositions usuelles, à mesure qu’elles deviennent automatiques et arbitraires, par des oppositions neuves, chargées par leur imprévu de mettre en éveil l’attention de l’interlocuteur et de faire jaillir chez lui un minimum au moins de conscience. Ces oppositions inédites qui font l’essence du procédé expressif, peuvent atteindre aussi bien la signification que la forme des signes. En résumé, les faits qui constituent le langage expressif peuvent être considérés comme un ensemble de déformations plus ou moins fortes et plus ou moins conscientes que le parleur fait subir au système normal de la langue ; il n’y a donc pas deux grammaires, une grammaire intellectuelle et une grammaire expressive (v. Sechehaye, Structure logique de la phrase, 212).
L’essence de l’expressivité est de jouer avec la norme — sémantique ou formelle — exigée par la logique ou la grammaire normatives. Quand on dit d’un homme : c’est un chiffon, on remplace la notion de qualité demandée par la logique (« il est mou ») par celle de substance ; mais si l’on dit de lui : c’est un ramolo, au lieu de : c’est un ramolli, on ne heurte plus la norme de la signification mais celle du signe.
Les grammairiens protestent souvent contre l’« illogisme » de certaines tournures. Exemple : « Promettre, comme espérer, suppose l’avenir. On ne dira donc pas : Je vous promets qu’il s’est bien amusé ; mais, Je vous assure qu’il s’est bien amusé. Il est vrai que promettre, pour assurer, est une expression familière, citée par l’Académie et employée par de bons auteurs. Elle n’en reste pas moins illogique, promettre signifiant faire une promesse. » (Vincent 141-2). En réalité, promettre pour assurer est une figure, et rejeter une figure comme 237illogique, c’est rejeter toute figure, car toute figure est illogique par définition.
Parleur et entendeur ne sont naturellement pas dupes de ces illogismes et de ces agrammatismes : le contraste entre la signification logique, c.à.d. conforme à la norme de la logique, et la signification illogique, respectivement entre le signe grammatical, c.à.d. conforme à la norme de la grammaire, et le signe agrammatical, constitue précisément le secret de l’expressivité.
A) Expressivité sémantique (figures)
La transposition sémantique et la figure ne doivent pas être confondues ; elles diffèrent par deux caractères importants.
Dans la figure, les deux valeurs sémantiques, le sens propre et le sens figuré, sont associées l’une à l’autre, et d’une manière plus ou moins implicite. La simple transposition sémantique postule au contraire l’oubli (ou, dans le cas de la « fausse figure », le refoulement) du sens premier. Le pronom on fournit des exemples intéressants des deux emplois. Dans des tournures comme Nous on aime le vin, ou : Venez voir : : C’est bon, on y va, le pronom on est une sorte de pronom personnel interchangeable d’une personne à l’autre, et relève de la transposition plus ou moins pure. Dans d’autres emplois, les valeurs propre et dérivée sont au contraire associées l’une à l’autre et forment figure ; tel est souvent le cas lorsque on est substitué à tu ou à vous : On n’a pas été sage à l’école, on est rentrée tard, on ne fait plus ses devoirs, qu’est-ce que cela veut dire, tout ça ?
En outre, et cela ressort en partie de ce qui vient d’être dit, il faut faire intervenir le facteur téléologique, car tout dépend en effet de l’intention du parleur. Si l’on admet que toute opération linguistique est accompagnée d’un jugement de valeur — généralement inconscient — porté sur elle par le sujet parlant, on peut, de ce point de vue, définir la transposition sémantique comme le déplacement « réel » d’un signe d’une valeur à l’autre, et la figure comme l’interversion 238« irréelle » (ludique) de deux significations. Cette attitude des sujets à l’égard des opérations linguistiques qu’ils effectuent devient d’ailleurs consciente en cas d’équivoque : « Comment entendez-vous cela, au propre ou au figuré ? »
Bref, on transpose par commodité, et d’une manière aussi mécanique que possible : la transposition est un instrument au service de l’automatisme grammatical. Si l’on transfigure, c’est au contraire pour frapper l’attention de l’interlocuteur et la tenir en éveil, ce qui oblige les parleurs à des innovations incessantes et les entendeurs à un effort d’interprétation ininterrompu. Mais on aurait tort, évidemment, de croire que ces procédés sont artificiels, comme si l’étude du langage expressif tenait tout entière dans l’énumération des figures de rhétorique et des recettes de style : ces dernières ne sont que la contre-partie littéraire des figures que crée la langue parlée plus ou moins spontanée.
Selon le besoin à satisfaire, l’expression linguistique des catégories de la pensée peut donc différer du tout au tout. S’agit-il du besoin de différenciation, on exprimera autant que possible les valeurs à l’aide de signes distincts (ex. « homme / bêtes » : cheveux / poils, nez / museau, pied / patte, mourir / crever, etc.). S’agit-il du besoin d’invariabilité, on traduira les valeurs différentes par des signes identiques (ex. le nez d’un chien, le pied d’un animal, etc.). S’agit-il d’être expressif, on intervertira à dessein les valeurs (ex. Enlève tes pattes !, Quel vilain museau il a !, Ah il te caresse le poil ?, On finira par tous crever !, etc.).
Nous essayerons ici de passer en revue les principales espèces d’interversions sémantiques que l’on peut observer dans le français familier et dans le français avancé, en étudiant en même temps leur retentissement sur la grammaire. M. Bally a montré « combien ce côté de la théorie grammaticale est encore peu poussé, et quelle étude féconde s’offre à qui veut raccorder systématiquement la grammaire et la logique, plus exactement : les transpositions grammaticales et les échanges logiques. » (LV 171). Quant au classement des faits, nous garderons les rubriques adoptées pour la Transposition sémantique.239
1) La substance
Nous examinerons d’abord les échanges que le besoin d’expressivité fait subir aux divers s variétés de la substance ; ensuite, nous passerons à l’étude des interversions qui se produisent entre la substance et une autre catégorie.
On emploie aussi, dans l’usage plaisant, l’impersonnel en parlant d’une personne ; exemple : Il fait soif !, à quelqu’un qui boit.
Inversement, la langue a de tout temps, et à tous les étages du langage, personnifié les choses de la nature ; l’animation de la nature est un des procédés les plus courants du langage expressif. La poésie en fait un usage constant, mais le langage populaire ne l’ignore pas non plus (cf. un cadavre pour désigner une bouteille vide, les noms d’animaux donnés aux outils, etc.).
L’interversion des notions d’homme et d’animal alimente la plus grande partie des injures et des expressions fortes de la langue familière et populaire : cochon, vache, chameau, bécasse, corbeau (prêtre), singe (patron), etc. Le procédé s’étend naturellement aussi aux attributs de ces notions : « On entend fréquemment dire cuir ou couenne pour « peau », lard pour « graisse », vêler ou fondre pour « accoucher », etc., avec l’intention évidente de comparer l’homme à la bête. » (B 26). Cf. gueule, museau, faites, poils ; crever, etc.
Le même procédé peut d’ailleurs comporter une valeur caritative, car tout dépend de l’intention du parleur. Certains noms d’animaux semblent particulièrement portés à fournir les termes de l’amitié et de l’amour : mon chien, mon loup, mon rat, mon lapin, ma chatte, mon poulet, etc.240
L’interversion des notions d’homme et de plante fournit et des injures (Vous me prenez pour une poire ; Faire le poireau « attendre longtemps, comme un imbécile ») et des termes caritatifs (mon chou, ma vieille branche, sucer la pomme à qn., etc.).
Beaucoup de termes caritatifs reposent en outre sur l’interversion des sexes. C’est par figure, par exemple, qu’on dira à une personne du sexe féminin : mon petit, mon chéri, mon mignon, etc. Le cas inverse, qui est plus rare, frise le sarcasme Dépêche-toi, ma belle ! De même, on peut substituer un suffixe masculin à un féminin, d’où l’expressivité plus ou moins forte des noms propres féminins en -on : Madelon (Madeleine), Louison (Louise), Margot, Margoton (Marguerite), Jeannot (Jeanne), etc. La même figure joue pour les noms communs en -on, corrects pour la plupart : une bougillon, une demoisillon, une frétillon, une graillon, une grognon, une laideron, une louchon, une souillon, une tâtillon, etc. Toute l’expressivité de ces termes repose sur le chassé-croisé entre féminin et masculin, et c’est dans la mesure où celle-ci s’efface qu’ils tendent à admettre le suffixe féminin : une tatillonne, etc.
Le cas classique dans ce domaine est d’ailleurs la 3e personne de politesse : Madame veut-elle…, Monsieur désire-t-il… Cf. : J’ai déjà eu le plaisir de rencontrer ces dames ; Et ces jeunes gens, ils parlent sport, je parie !, etc.
Enfin, le langage populaire emploie bibi avec la 3e personne quand il s’agit de quelqu’un qui se désigne soi-même : Bibi aime bien le bon vin, C’est pour bibi (B).
Dans la langue écrite, l’interversion se fait entre l’auteur et ses personnages ; mais la racine du procédé — comme d’ailleurs de tout procédé littéraire — doit être cherchée dans l’idiome parlé. C’est là ce qui placera le problème dans 242sa vraie lumière (v. E. Richter, compte-rendu de l’ouvrage de Mlle Lips : Herrig’s Archiv, t. 153, 149 sv).
En français, l’article placé devant un nom propre « caractérise » la personne désignée. Cela peut se faire de différentes manières. Devant un prénom par exemple, l’article donne un ton de familiarité : la Louise, la Jeanne, la Marie, etc. Devant un nom de famille, il exprime généralement le mépris, procédé bien connu des polémistes : le Clemenceau, le Caillaux, le Poincaré, etc., … et des concierges : Voilà encore une lettre pour le Martin. La forte expressivité qui se dégage de cet emploi est due à l’interversion des notions de nom commun et de nom propre, ce dernier étant assimilé par figure à un nom commun. On sait que dans le langage populaire et rural, cet usage de l’article avec un nom propre a perdu en grande partie sa valeur expressive.
Un autre groupe de figures consiste à intervertir la substance avec la qualité, la manière, l’évaluation (mode), etc.
On remarquera que le substantif ainsi transfiguré dans le domaine de la qualité s’accompagne volontiers de l’adverbe tout, à la place de très : un style tout nature, il est tout chose, tout enthousiasme, etc.
Il peut y avoir chassé-croisé entre la transposition de l’adjectif en un substantif et la figure qui prend la substance pour la qualité : Pierre est un timide. Autrement dit, l’adjectif, en même temps qu’il est transposé en substantif, est transfiguré en sens inverse dans le domaine de la qualité. Les exemples de ce type sont multiples, et en général corrects (pendant plus ou moins « écrit » : son étude la préférée, les soldats pour qui la mort est la toujours présente, etc.).
Introduction à la linguistique fonctionnelle
O. Funke (sur Marty) : Innere Sprachform, 36 sv, 128 sv ; Satz u. Wort, 83 sv ; Studien zur Geschichte der Sprachphilosophie, 129 sv.
E. Goblot, Traité de Logique, chap. XV-XVI : « Le raisonnement téléologique ».
W. Havers, Die Unterscheidung von Bedingungen u. Triebkräften beim Studium der menschlichen Rede, Germ. Roman. Monatsschrift, 16 (1928), 13 sv.
O. Jespersen, Energetik der Sprache, Scientia 1914 ; Language, 324 sv.
A) Linguistique fonctionnelle contre grammaire normative
1) La fonction opposée à la norme
La distinction du correct et de l’incorrect est une des premières difficultés auxquelles s’achoppe le grammairien qui étudie un état de langue. Qu’appelle-t-on un fait de langage « correct » et, lorsqu’on parle d’une « faute », que veut-on dire par là ?
En somme, ces termes recouvrent des notions assez vagues. Il suffit de penser aux discussions souvent acharnées auxquelles se livrent puristes et grammairiens au sujet de la correction ou de l’incorrection de tel et tel cas litigieux.
Un grand nombre d’auteurs définissent le correct par la conformité avec la norme sociale : « On entend par langage 17correct le langage tel qu’il est exigé par la collectivité, et par fautes de langage les écarts à partir de cette norme — abstraction faite de toute valeur interne des mots ou des formes ». (Jespersen, Mankind, Nation and Individual from a linguistic point of view, 140). Cette conception du correct est la conception normative : est correct ce qui correspond à la norme établie par la collectivité ; et la grammaire qui constate et codifie les règles du commun usage, est dite grammaire normative (sans que d’ailleurs ce terme suppose qu’elle soit impérative, comme si elle cherchait nécessairement et toujours à exercer une pression en vue de leur observance).
Mais est-ce là le seul point de vue possible ? Une autre conception, que nous appellerons la conception fonctionnelle, fait dépendre la correction ou l’incorrection des faits de langage de leur degré de conformité à une fonction donnée qu’ils ont à remplir. Tandis que le point de vue normatif caractérise surtout l’école française (Durkheim) et l’école genevoise (De Saussure), le point de vue fonctionnel est mieux représenté par les Scandinaves : « le plus correct est ce qui, émis le plus aisément, est compris le plus aisément » (Tegnér : Jespersen, livre cité). M. Noreen a proposé une formule analogue : « ce qui, pouvant être compris le plus exactement et le plus rapidement par l’entendeur, peut être émis le plus aisément par le parleur » (ib.).
Il va sans dire — nous y reviendrons plus loin — que la compréhension aisée n’est qu’une des fonctions, multiples et souvent contradictoires, que le langage ait à remplir.
Selon qu’on se place au point de vue normatif ou au point de vue fonctionnel, on tablera donc aussi sur une définition différente de l’incorrect : 1. est incorrect ce qui transgresse la norme collective ; 2. est incorrect ce qui n’est pas adéquat à une fonction donnée (par exemple : clarté, économie, expressivité, etc.). Dans le premier cas, on parlera de fautes ; dans le second, de déficits.
Une des thèses de ce livre sera de montrer que dans un grand nombre de cas la faute, qui a passé jusqu’à présent pour un phénomène quasi-pathologique, sert à prévenir ou à réparer les déficits du langage correct. Partant de faits que le point de vue normatif taxe généralement de fautes, nous chercherons donc, en nous plaçant sur le terrain fonctionnel, à déterminer les fonctions que ces fautes ont à satisfaire. Au contraire, la question de savoir si, et dans quelle mesure, un fait 19donné est correct ou non, ne nous intéressera que d’une manière secondaire : les ouvrages de purisme abondent, sur ce point.
2) La finalité empirique
Les linguistes, hantés de la préoccupation de faire de leur discipline une science aussi rigoureuse que possible, ont toujours marqué une certaine réluctance à l’égard de la finalité. Ils n’osent pas l’aborder franchement ; elle leur semble insaisissable, antiscientifique et presque métaphysique.
Mais tous les savants ne sont pas également réfractaires à cette notion qui de toutes parts s’infiltre dans leur science. Le linguiste allemand Marty a beaucoup insisté sur le rôle joué par la finalité dans le langage (empirisch-teleologische Sprachbetrachtung, tastende Auslese ; v. Funke, livres et passages cités). Bien que ses vues s’appliquent à l’histoire du langage et spécialement à son origine, il ne semble pas difficile de montrer que les forces qui ont présidé à la naissance du langage se retrouvent, en vertu d’une sorte de « création continuée », et sans doute avec un dosage différent, dans le fonctionnement linguistique d’aujourd’hui.
Le dialectologue Gilliéron a orienté la linguistique vers l’étude du besoin de différenciation qui semble dominer dans les parlers populaires : « A tous les degrés, le langage est l’objet de préoccupations où se mêlent à la volonté d’être pleinement intelligible, la conscience de la diversité des parlers individuels ou locaux, le sentiment confus d’une hiérarchie des parlers et des formes, un désir obscur du mieux-dire. » (Etudes de Géographie linguistique, 73-4).
M. Millardet a admis et montré l’existence de cas « où la phonétique semble réagir elle-même, par ses propres moyens et sans sortir de son domaine, contre les dangers que les forces destructives d’assimilation font courir à la langue ». (Linguistique et Dialectologie romanes, 290). « Certaines innovations, qui ont le caractère le plus général et ne peuvent être considérées comme des applications de règles plus ou moins artificielles imposées par une élite ayant la prétention de parler correctement, dérivent, si l’on y regarde de près, d’une 20tendance collective en vertu de laquelle la langue répare instinctivement le trouble que les assimilations, les amuïssements et autres principes d’inertie ont introduit dans son système. » (ib. 300).
L’idée de finalité est donc bien « dans l’air ». Il reste à lui accorder la place exacte à laquelle elle a droit dans les théories linguistiques : Loin de s’ajouter au langage comme un facteur externe, elle en constitue le principe et la raison d’être. La définition même du langage (système de moyens d’expression « destinés à » transmettre la pensée), celle de la phrase (jugement « destiné à » être transmis à l’entendeur), celle du signe (procédé « destiné à » transmettre une signification donnée à un entendeur donné), relèvent du principe de finalité.
Une propriété d’un phénomène est dite fonction quand ce phénomène est agencé en vue de cette dernière ; inversement, un phénomène est dit procédé quand il sert de moyen destiné à satisfaire une fonction donnée. Le signe, la phrase, le langage ne sont pas des processus, engagés dans de simples rapports de cause à effet, mais des moyens, des procédés.
Examinée du point de vue des fautes et des innovations, la finalité apparaît sous deux aspects opposés, quoique solidaires :
a) La sélection.
La sélection se contente d’opérer un tri parmi les faits existants, laissant subsister ceux qui répondent à la fonction exigée, et éliminant les autres. De ce point de vue, les fautes et les innovations de la parole ne seraient que des « propositions individuelles », obéissant à des tendances individuelles, et que la sélection collective accepterait ou rejetterait après coup. Autrement dit, les fautes et les innovations ne passeraient que dans la mesure où elles se trouvent coïncider avec un besoin général, mais cette coïncidence ne serait pas voulue. C’est peut-être ainsi qu’il faut interpréter ce que F. de Saussure disait du caractère toujours fortuit d’un état de langue (CLG 125).
Les linguistes n’ont pas encore insisté suffisamment sur 21le rôle fonctionnel joué dans la vie du langage par l’oubli, qui est la face négative de la sélection. L’oubli ne frappe pas n’importe quel élément ; la mémoire laisse tomber les signes et les formules qui, pour une raison ou pour une autre, sont inaptes à une fonction donnée (élimination des monosyllabes homophones, oubli du sens correct par suite de l’absence de liens formels rattachant le signe à son ancienne famille, oubli de la forme correcte d’un signe par suite de son irrégularité, etc.).
De plus, l’élimination des inaptes peut être plus ou moins consciente et volontaire. Des faits parfaitement corrects autrefois tendent aujourd’hui, pour des raisons quelquefois précises, à être conçus comme incorrects, et sont refoulés (cf. Il a fait un voyage à la Chine ; Il est un avocat ; A cause que, en cas que, dans le cas que).
D’une manière générale, c’est l’oubli ou le refoulement qui donne le champ libre au choix et à la création des procédés destinés à mieux satisfaire une fonction. Car la sélection n’est qu’une des étapes de la finalité ; dans bien des cas, elle se contente de préparer ou d’accompagner
b) L’adaptation créatrice.
M. Goblot a montré (§§ 219, 228 sv) que la finalité comporte toujours un rapport d’au moins trois termes : un terme initial, un moyen ou une série de moyens, et une fin. Le terme, initial ou excitant, né sous l’influence des causes qui compromettent la fonction, fait apparaître le moyen destiné à satisfaire la fin : l’excitant crée la fonction, et la fonction l’organe.
Dans nombre de cas, le fonctionnement du langage relève de la même interprétation. Là aussi, le cycle fonctionnel est constitué par un excitant : les déficits ; un moyen : les procédés ; une fin : les besoins linguistiques. Et de même qu’en biologie l’excitant crée la fonction, et la fonction l’organe, en linguistique le déficit éveille le besoin (d’ailleurs toujours latent) et ce dernier déclenche le procédé qui doit le satisfaire. Nous avons cité plus haut l’équivoque de quila : c’est lui quila fait venir. Une faute assez fréquente aujourd’hui dans le langage populaire consiste à accorder l’auxiliaire faire 22lorsque l’objet est un féminin : c’est lui qui l’a faite venir. Ici, où le besoin de clarté a supprimé toute équivoque, l’incorrect peut être considéré comme un procédé servant à réparer un déficit du langage correct.
Terminologie. — Il va sans dire que de tels phénomènes s’opèrent généralement d’une façon ni consciente ni systématique. La finalité que nous postulons n’est, la plupart du temps, qu’une finalité inconsciente et empirique, agissant dans l’obscurité et comme à tâtons. Aussi le terme de besoin ne devra-t-il pas être pris trop à la lettre.
3) La loi opposée à la règle
Ces cycles fonctionnels (déficits — besoins — procédés) sont-ils impératifs et nécessaires ? Il ne s’agit sans doute que de possibilités. Mais entre ces possibilités, il est loisible d’établir des lois, énonçant que si l’une de celles-ci se produit telle autre se réalisera nécessairement aussi. La tâche de la linguistique est d’expliquer les phénomènes du langage à l’aide de lois constatant des rapports de mutuelle dépendance entre les faits.
Cette conception de la loi scientifique concorde avec les définitions qu’on en donne généralement : Une loi est une dépendance conditionnellement nécessaire entre deux termes (Naville, Classif. des sc., 22) ; Une loi naturelle ne peut être qu’un jugement hypothétique (Goblot § 218) ; Une loi n’est rien autre chose qu’une relation constante entre des faits (ib. § 182).
Formules. — La manière de formuler la loi varie : Si le fait A a le caractère M, le fait B a le caractère N ; Si A a le caractère M, il a aussi le caractère N ; Le degré de M varie avec le degré de N. On peut aussi se servir de la formule de la quatrième proportionnelle A : B = M : N.
Mais la loi ainsi conçue dans le sens constatatif où l’entendent les sciences naturelles, diffère radicalement de la règle grammaticale qui, elle, appartient à un tout autre plan (la conception saussurienne de la loi exposée dans le Cours, p. 133 sv, intéresse uniquement la règle grammaticale). 23Cette dernière est un principe impératif imposé par la contrainte de l’usage collectif et par le grammairien qui en est l’interprète. La règle grammaticale n’a rien de commun avec la loi linguistique ; la première est conventionnelle (θέσει ὄν), la seconde naturelle (φύσει ὄν).
La comparaison avec la vie sociale montre aisément la différence entre les deux ordres. La règle des grammairiens fait pendant aux lois juridico-parlementaires, aux usages et coutumes de la société ; la véritable loi linguistique, au contraire, est parallèle aux lois de la sociologie.
Tandis que le grammairien et le législateur prescrivent et codifient ce qui doit être, le linguiste et le sociologue constatent et enregistrent simplement les rapports de mutuelle dépendance reliant les faits : une Grammaire normative n’est pas un Traité de linguistique, de même que le Code civil n’est pas un Traité de sociologie ni le Code pénal un Traité de criminologie.
En outre, les règles grammaticales et les lois sociales sont limitées dans l’espace et dans le temps. Ne s’appliquant toujours qu’à une société donnée et à une époque donnée, elles changent de société à société et d’époque en époque. Les lois de la linguistique et de la sociologie, au contraire, doivent pouvoir se vérifier toujours et partout.
Enfin, les règles de la grammaire ou de la société peuvent être transgressées et comportent des sanctions plus ou moins rigoureuses et plus ou moins directes, tandis que les lois scientifiques sont intangibles. Cette dernière assertion, il est vrai, n’est exacte qu’en théorie ; mais les exceptions aux lois scientifiques proviennent en réalité de l’interférence des lois entre elles, c.à.d. de la difficulté qu’il y a de constater, à l’intérieur d’un système de valeurs, l’interdépendance de deux phénomènes abstraction faite des autres facteurs qui agissent sur eux.
Sciences normatives ou constatatives. — La dualité entre la règle (norme) et la loi (fonction) pourrait se poursuivre dans d’autres domaines. Ainsi la logique, dans sa définition ordinaire (théorie normative de l’entendement), s’oppose à la psychologie de l’entendement ; la morale s’oppose à la psychologie de réaction, 24la dogmatique à la science des religions, le canon esthétique à la science de l’art, etc.
L’opposition entre norme et fonction d’une part, règle et loi de l’autre, entraîne deux conséquences importantes pour le classement des disciplines.
D’une part, la grammaire normative est une science purement descriptive ; elle décrit les règles du système, sans les expliquer. La linguistique fonctionnelle est une science explicative ; elle prétend expliquer les phénomènes qui constituent le fonctionnement du langage, par les rapports de mutuelle dépendance qui les relient, et, du point de vue spécial qui nous occupe dans ce livre : par les rapports de mutuelle dépendance entre besoins, procédés et déficits. C’est la linguistique fonctionnelle qui devrait expliquer, en dernier ressort, l’existence, le maintien ou le remplacement des règles du système.
D’autre part, la grammaire normative est une discipline spéciale ; elle n’étudie toujours qu’une langue donnée, à une époque donnée : il n’y a pas de « grammaire générale ». La linguistique fonctionnelle, au contraire, est dans chacune de ses démarches une science générale.
B) Linguistique fonctionnelle contre linguistique historique
L’opposition entre description et explication est souvent présentée sous un autre angle particulièrement important. On prétend que l’histoire du langage est seule à constituer une véritable explication, tandis que la linguistique statique ne serait qu’une discipline descriptive.
1) L’explication fonctionnelle opposée à l’histoire
Chez les adeptes de la « méthode historique », expliquer veut dire : découvrir le fait ou la série des faits antérieurs. On « explique » le français père en disant qu’il vient du latin 25pater, on « explique » un tour comme pour l’amour de en le faisant remonter au latin per amorem ou pro amore. C’est le sempiternel raisonnement du « post hoc, ergo propter hoc ».
Grâce à cette méthode, la linguistique historique a sur la linguistique statique l’avantage de prédire à coup sûr, et d’annoncer toujours les événements après qu’ils sont arrivés ; cela fait que tout s’y sait assez bien, et ce n’est pas étonnant.
En réalité, description et statique d’une part, explication et évolution de l’autre, sont des termes qui ne se recouvrent pas. Qu’il s’agisse de phonétique, de syntagmatique ou de sémantique, une succession historique, loin de constituer une explication, est un fait qui demande lui-même à être expliqué. L’histoire n’est donc pas une méthode, mais une simple constatation ou reconstitution de faits.
Au lieu d’établir des successions historiques, la linguistique fonctionnelle, plus modeste, se place d’emblée sur le terrain statique et cherche à expliquer les faits en les ramenant aux fonctions (besoins, instincts, etc.) qu’ils sont censés satisfaire.
En principe, besoin et procédé sont asymétriques. Un procédé ne correspond pas nécessairement à un besoin donné, mais peut obéir à des tendances diverses ; inversement, un besoin peut utiliser plusieurs procédés. Il y a donc, par analogie avec ce qu’on appelle la polysémie du signe, un « polytélisme » du procédé, ce terme désignant la multiplicité des fins qu’un même moyen permet d’atteindre, et inversement (v. Lalande 1047).
Exposant les faits d’une manière déductive, nous partirons des besoins et diviserons notre étude en autant de parties que nous croyons reconnaître de besoins fondamentaux.
Cette méthode présente un double avantage. D’une part, allant du simple au composé, elle permet un exposé plus clair ; les procédés linguistiques sont en effet si variés que partir de ceux-ci pour rechercher les fonctions auxquelles ils répondent serait aboutir au chaos. D’autre part, descendant du principe à la conséquence, elle est aussi plus probante : la possibilité de reparcourir dans le même sens les phénomènes étudiés est l’indice qu’on les a compris.26
Les besoins fondamentaux qui commandent le fonctionnement du langage sont en nombre relativement restreint et varient en somme assez peu d’une langue à l’autre ou d’une époque à l’autre de la même langue. On pourrait les appeler les constantes du langage.
L’Analogie est un des premiers faits qui attirent l’attention de celui qui étudie le langage. F. de Saussure a admirablement montré comment son mécanisme se confond avec le mécanisme même de la parole. Nous verrons cependant que le procédé de l’analogie, ainsi compris, est encore plus vaste que ne le concevait le fondateur de la linguistique statique. Car, si la création analogique ou, ce qui revient au même, le jeu quotidien de la parole, « suppose un modèle et son imitation », les cas si variés qu’on appelle « étymologie populaire », « contamination », « contagion », etc., doivent également ressortir, d’une manière ou de l’autre, au principe général de l’analogie. Et même, prise au sens large, l’analogie est un fait qui dépasse la portée d’un simple procédé. Nous parlerons plutôt d’un besoin général qui tend à assimiler les uns aux autres les signes par leurs formes et par leurs significations pour les ordonner en un système — et nous dirons que ce besoin utilise des procédés variés, tels que l’analogie proprement dite, l’étymologie populaire, etc. (Chapitre I : Assimilation).
La réduction des signes en une masse homogène a sa contre-partie dans le besoin de Différenciation ou de Clarté (Chapitre II). Ce dernier nous fournira quelques-unes des meilleures illustrations de la finalité linguistique (v. l’exemple donné plus haut : c’est lui qui l’a faite venir).
Le besoin d’Economie exige que la parole soit rapide, qu’elle se déroule et soit comprise dans le minimum de temps. De là les abréviations, les raccourcis, les sous-entendus, les ellipses, etc., que la langue parlée présente en si grand nombre (Chapitre III : Brièveté). En outre, pour que les associations engagées dans le jeu de la parole puissent fonctionner avec le moindre effort de mémoire, il faut que le signe ne change 27pas ou change le moins possible de forme en passant d’une combinaison syntagmatique, respectivement d’une catégorie grammaticale à l’autre (Chapitre IV : Invariabilité). Les verbes irréguliers, par exemple, sont un défi à la mémoire (je vais, tu vas, vous all-ez, j’i-rai, que j’aille — en face de : je chante, tu chantes, vous chant-ez, je chante-rai, que je chante). Seules la haute fréquence d’emploi et la contrainte collective réussissent à maintenir de telles anomalies.
Un autre besoin, en grande partie opposé aux précédents, c’est l’Expressivité (Chapitre V). Le besoin d’agir sur l’entendeur soit pour le forcer à tenir compte de ce qu’on lui dit soit pour le ménager, domine tout l’usage de la conversation. Le déficit qui déclenche ordinairement les procédés expressifs est l’usure sémantique ou simplement l’absence de signes suffisamment frappants.
Il faut ajouter que ces besoins tantôt s’associent tantôt se heurtent les uns aux autres. L’harmonie et l’antinomie relatives entre les besoins est un fait dont on n’a pas encore tiré toutes les conséquences, mais qui constitue sans doute le facteur principal de la stabilité ou de l’instabilité des systèmes linguistiques. La stabilité d’une langue correspond à un état d’ « équilibre des besoins », dans lequel aucun de ceux-ci n’est assez fort pour modifier appréciablement le système ; tandis que la direction dans laquelle une langue évolue n’est en fin de compte que la résultante du « parallélogramme des besoins » qui agissent sur elle. S’il est permis de traduire une notion assez précise par un terme vague, cette proportion des besoins linguistiques est au fond ce qu’on appelle le « génie de la langue ».
En attendant des études plus détaillées, nous nous contenterons d’une première approximation pour considérer successivement chacun des besoins comme si son action était indépendante de celle des autres.28
2) Le changement opposé à l’évolution
On s’accorde aujourd’hui à reconnaître que c’est la linguistique du fonctionnement (« linguistique de la parole ») qui forme le pont reliant la linguistique statique ou science des états de langue, à la linguistique évolutive. Mais tandis que pour le système de la langue la distinction entre statique et évolutif tend, après les travaux de Marty en Allemagne et de Saussure à Genève, à être reconnue et admise de plus en plus universellement, son application à l’étude du fonctionnement rencontre des difficultés.
« En pratique, un état de langue n’est pas un point, mais un espace de temps plus ou moins long pendant lequel la somme des modifications survenues est minime. Cela peut être dix ans, une génération, un siècle, davantage même… Un état absolu se définit par l’absence de changements, et comme malgré tout la langue se transforme, si peu que ce soit, étudier un état de langue revient pratiquement à négliger les changements peu importants, de même que les mathématiciens négligent les quantités infinitésimales dans certaines opérations, telles que le calcul des logarithmes ». (Saussure CLG 146).
Il serait utile néanmoins pour étudier le fonctionnement du langage de disposer d’un critère précis permettant de dire dans chaque cas particulier si un rapport linguistique donné appartient au présent ou à l’histoire.
Nous appellerons changement statique, ou changement tout court, tout passage réversible, c.à.d. dont le terme initial peut être spontanément rétabli par les sujets. Dans le cas inverse, nous parlerons d’évolution.
Quelques exemples nous éclaireront. On sait que l’emploi fautif de fortuné au sens de « riche » est très courant aujourd’hui. Mais pour la majorité des sujets le passage de fortuné 1 à fortuné 2 reste réversible : « heureux » = « riche ». Pour un petit nombre d’entre eux, au contraire, le rapport de l’un à l’autre n’est plus saisi et forme par conséquent une évolution, 29c.à.d. le passage d’un fait du passé à un fait du présent : fortuné « heureux » → « riche ».
Lorsqu’une abréviation appartient au présent, le rapport entre le signe plein et le signe abrégé doit être senti spontanément. Ainsi des raccourcis comme perm’, prof’, math’, etc., relèvent de la statique, parce qu’ils se laissent immédiatement ramener aux originels correspondants : permission, professeur, mathématiques, etc. L’explication d’un mot comme dèche, par exemple (être dans la dèche « dans la misère »), appartient au contraire au passé ; les sujets ne savent plus instinctivement que dèche a été un jour l’abrégé de déchéance ou le substantif verbal de déchoir.
Il en va de même pour les figures. Toute figure conserve son caractère dans la mesure où le sens figuré est rattaché spontanément au sens propre, c.à.d. dans la mesure où elle reste statique ; dans le cas inverse, elle perd son caractère de figure pour devenir un signe plus ou moins arbitraire. Des mots comme étrange, stoïque, cynique, etc., ont été des figures : « qui a le caractère de ce qui est étranger, de celui qui appartient à l’école stoïcienne, à la secte des Cyniques » ; aujourd’hui, ces signes sont arbitraires, leur sens figuré n’étant plus compris que par les historiens de la langue.
Pour éviter tout malentendu, il convient d’ajouter que notre définition du statique et de l’évolutif dérive d’une interprétation uniquement psychique de ces faits, qu’il ne faut pas confondre avec la simultanéité et la succession proprement dites, qui sont des notions physiques. Car au point de vue physique tout fait linguistique — une phrase, un mot, un simple phonème — se déroule dans le temps : la statique linguistique n’a rien de commun avec la simultanéité physique. Dans ce sens, on pourrait donc appeler la statique un mode de l’esprit, c.à.d. une manière de concevoir les phénomènes, puisque l’esprit ne semble pouvoir saisir qu’en les immobilisant les faits qui physiquement se déroulent dans le temps.
La linguistique du fonctionnement ne peut être que statique. « La première chose qui frappe quand on étudie les faits de langue, c’est que pour le sujet parlant leur succession dans le temps est inexistante : il est devant un état. 30Aussi le linguiste qui veut comprendre cet état doit-il faire table rase de tout ce qui l’a produit et ignorer la diachronie. Il ne peut entrer dans la conscience des sujets parlants qu’en supprimant le passé. » (Saussure CLG 120). La tâche actuelle de la linguistique est de reprendre les problèmes qui ont longtemps paru comme le fief de la linguistique historique, pour les transposer sur le plan du fonctionnement statique ; car un fait d’évolution reste inexpliqué tant qu’il n’a pu être ramené à un rapport ou à une série de rapports statiques de mutuelle dépendance (= loi).
Rôle du latin. — Une objection souvent présentée par les historiens contre l’étude statique de la langue est qu’il est impossible de comprendre le français sans connaître le latin. Il s’agit naturellement des emprunts du français écrit au latin savant : « … Un Français qui ne sait pas le latin est hors d’état de comprendre les rapports que soutiennent les mots français entre eux. On peut parler, entendre, écrire le français sans savoir un mot de latin ; mais on ne peut se rendre compte des rapports des mots entre eux si l’on n est pas latiniste. » (Meillet, Les Langues dans l’Europe nouvelle, 164).
Cette constatation, d’ailleurs très juste, ne concerne qu’une variété d’un cas général : le rapport entre une langue qui reçoit et une autre qui fournit l’emprunt. Or ce rapport est loin d’être nécessairement d’ordre généalogique, comme entre le français et le latin. Il suffit de penser au grec, pourvoyeur du latin ; à l’arabe, fournisseur du persan et de l’ourdou, qui ne lui sont pas apparentés ; au chinois, réservoir lexical du japonais cultivé, etc.
Le rapport culturel (de langue classique à langue tributaire) ne doit pas être confondu avec le rapport généalogique : Une étude approfondie du français exige la connaissance du latin non pas en tant que ce dernier constitue une étape antérieure de la langue, mais simplement dans la mesure où il lui fournit ses emprunts.
C) Le choix des faits
Une conception linguistique comme celle que nous venons d’exposer oblige à tabler de préférence sur des matériaux qui n’appartiennent ni à la langue normalisée ni au passé de la langue.31
Nous avons donc procédé à une enquête sur le « français avancé », en comprenant sous ce terme tout ce qui détonne par rapport à la langue traditionnelle : fautes, innovations, langage populaire, argot, cas insolites ou litigieux, perplexités grammaticales, etc.
Si l’on admet en effet que la faute assume, dans le jeu de la parole, un rôle fonctionnel, elle aura par là même, pour le linguiste, une valeur documentaire de premier plan. Destinée à satisfaire certains besoins, elle devient par ricochet l’indice de ces besoins et comme l’écran sur lequel vient se projeter tout le film du fonctionnement linguistique.
1) Correct et incorrect
Une exagération courante consiste à croire qu’une innovation commence nécessairement par être une faute. Mais le langage avancé ne comprend pas seulement les faits dûment constatés comme incorrects.
Dans une langue de grande communication telle que le français, où la conscience linguistique est très sensible et où la contrainte collective réprime immédiatement les écarts trop hardis, les besoins se réalisent souvent d’une manière plus heureuse sous forme de procédés détournés — semi-corrects ou corrects — que sous forme de fautes brutales transgressant violemment les règles reçues. Le langage populaire manifeste par exemple une tendance très forte à unifier le radical du verbe. Mais tandis qu’il dit déjà je vas à la place de je vais (cf. je vas, tu vas, il va, on va), j’est pour je suis et j’a pour j’ai sont des formes encore très risquées. En revanche, il construit couramment : c’est moi qui est, c’est moi qui a (de même pour l’auxiliaire : c’est moi qui l’a vu), il n’y a que vous qui peut faire ça, c’est pas nous qui peut y aller, etc. On peut considérer dans ces exemples le tour c’est qui comme une ruse — façon de parler — permettant, là où la solution directe serait trop osée, l’unification du radical.
Comme, dans une langue, l’importance de ces procédés détournés semble croître en raison directe de l’impérativité de l’usage, il est nécessaire de donner à l’enquête une tournure 32aussi large que possible. Pour se faire une idée claire du langage incorrect, il faut non pas le distinguer du langage correct par des caractères arbitrairement choisis, mais l’en rapprocher au contraire, selon ce principe de Claude Bernard que le pathologique n’est que l’exagération du normal.
La sociologie connaît des distinctions analogues. Une innovation sociale ne commence pas nécessairement par une émeute ; la révolution n’est souvent qu’un feu de paille, auprès d’évolutions profondes qui passent inaperçues et dont on n’aperçoit le vrai sens que longtemps plus tard.
2) Mémoire et discours
Pour qu’un besoin linguistique soit général, il doit se manifester dans tous les compartiments du langage, à commencer par ce qu’on peut appeler les deux axes de son fonctionnement : les rapports mémoriels, contractés entre les éléments donnés dans la chaîne parlée et ceux logés dans la mémoire, et les rapports discursifs, que soutiennent les éléments enchaînés le long du discours (c’est ce que F. de Saussure a appelé, avec une terminologie moins précise, la différence entre rapports associatifs ou syntagmatiques : CLG 176 sv).
Nous verrons par exemple que la Brièveté (chap. III) et l’Invariabilité (chap. IV) ne sont pas autre chose que les deux faces du besoin d’Economie, selon qu’il se réalise dans le discours ou dans la mémoire. La même division s’impose pour l’étude d’autres besoins. Ainsi l’Instinct analogique, qui est un fait de mémoire (Assimilation mémorielle) a sa contre-partie dans la discours : l’Assimilation discursive — que nous appellerons le Conformisme — exige que les éléments qui se suivent dans la chaîne parlée s’adaptent étroitement les uns aux autres et varient par conséquent les uns en fonction des autres (et cela, nous le verrons, se manifeste aussi bien dans le Sandhi, ou conformisme phonique, que dans l’Accord entre catégories grammaticales, la Concordance des Temps, etc.).33
3) Grammaire et phonologie
Les besoins généraux qui sont à la base du fonctionnement linguistique ne se manifestent pas seulement dans la grammaire (science des rapports entre signes et significations) ; leur action se prolonge dans tout le domaine de la phonologie (science des phonèmes et de leur combinaison, abstraction faite des significations).
L’instinct analogique, par exemple, intéresse autant la phonologie que la grammaire. Le sandhi n’est que le pendant phonique de l’accord entre catégories grammaticales (accord de l’adjectif avec son substantif, du verbe avec son sujet ; concordance des temps et des modes, etc.). Les faits de différenciation grammaticale ont leur contre-partie dans les divers problèmes concernant la différenciation phonique : délimitation des unités et des sous-unités, dissimilation, netteté de syllabation, etc. La sous-entente d’éléments significatifs provoquée par le besoin de brièveté, et les mutilations de mots et amuissements de phonèmes qui caractérisent le langage populaire, ne diffèrent pas quant au principe. Le besoin d’invariabilité, qui se manifesta principalement dans le domaine des transpositions grammaticales (transpositions sémantiques et transpositions syntagmatiques), présente aussi un aspect phonique, problème délicat que nous effleurerons. De même, il y a une expressivité sémantique (= figures) et une expressivité formelle.
Phonologie et grammaire sont donc parallèles, en ce sens que les besoins qui atteignent les rapports entre signes et significations doivent également se réaliser dans les éléments matériels pris isolément. En outre, comme il est plus facile de constater l’action des besoins en grammaire qu’en phonologie, il y aura avantage à placer l’étude de cette dernière après celle des autres parties du langage. Agencée sur le modèle de la grammaire, elle n’en sera que moins rébarbative.
Bibliographie. — L’interdépendance de la grammaire et de la phonologie a été soulignée par M. Sapir (Language, 196-7). M. Sechehaye a insisté sur la nécessité de faire intervenir l’étude de la phonologie après celle de la grammaire (Programme et Méthodes de la Linguistique Théorique, 131 sv, 161 sv).34
La recherche, faite d’un point de vue fonctionnel, des coïncidences entre mémoire et discours d’une part, grammaire et phonologie de l’autre, est peut-être la meilleure méthode pour démontrer la cohésion des facteurs en apparence si divers qui composent l’unité d’une langue.
Le même problème peut être posé sous un autre angle également important.
4) Langue parlée et langue écrite
Une personne à qui nous exposions notre idée d’utiliser les fautes de français pour la linguistique, nous avait demandé : Quel français étudiez-vous : le français populaire ? le français écrit ? le français de Paris ? celui de Genève ? le français des petites villes ? etc.
Il est évident qu’une enquête portant sur le français avancé doit tenir compte de l’« état-civil » des faits de langage. L’antinomie qui se présente tout de suite est celle entre la langue écrite et la langue parlée, ou d’une manière plus frappante entre la langue littéraire et la langue populaire. Où faut-il chercher le vrai français ? :
… En somme, en fin, en fait, le français, le vrai français, agréable ou non à l’ouïe, commode ou non pour l’expression de la pensée, est par essence celui que parle le peuple. Le peuple de France a créé le français ; il l’a fait, il l’a enfanté en ce qu’il a de véritablement français ; il l’a mené jusqu’à nos jours au point où nous l’entendons aujourd’hui ; et les écrivains et les savants, malgré une très grande influence dans la fabrication des mots nouveaux, n’ont fait que marcher à sa suite. En réalité, le vrai français, c’est le français populaire. Et le français littéraire ne serait plus aujourd’hui, à ce point de vue, qu’une langue artificielle, une langue de mandarins — une sorte d’argot… (B 30-1).
Bien que le latin vulgaire, dont le français est issu, soit évidemment un exemple en faveur de cette thèse, certains sont d’un avis différent :
Le langage littéraire et l’idiome populaire d’aujourd’hui, tout pétri d’argot, sont […]à peu près impénétrables l’un à l’autre. Et s’il y a contagion, c’est du premier sur le second, non le contraire. Quoi qu’en disent certains politiques qui conçoivent encore 35le peuple comme une classe en soi, les gens du peuple sont de plus en plus imprégnés d’âme bourgeoise, et en ce qui nous intéresse, de dialecte journalistique. L’école commence cette action que le journal achève ; et surtout à Paris, la discussion sociale, qu’on peut surprendre n’importe où, en termes nobles, fût-ce le samedi, entre deux prolétaires titubants… (Thérive FLM 58).
Les grandes langues modernes de civilisation ont été façonnées par des élites intellectuelles qui les enrichissent depuis de longues générations (Meillet, Les Langues dans l’Europe nouvelle, 262).
Pour nous cependant, qui nous plaçons au point de vue fonctionnel, la langue parlée formera la base de l’étude ; car les besoins fondamentaux se manifestent le mieux dans la langue parlée, qui est plus spontanée, moins entravée par la tradition que la langue écrite. En linguistique, toute vérité entre par les oreilles, toute sottise par les yeux.
Mais il ne s’agira pas pour cela de renoncer à la langue écrite. L’essentiel est de considérer l’une comme l’autre en fonction d’un petit nombre de besoins, en somme identiques, qui s’y manifestent avec un dosage et des procédés variables.
Voici un exemple qui illustre d’une manière frappante l’identité de principe des besoins qui commandent les deux pôles du français avancé. Soit une phrase correcte : Ce qui importe dans un pays, c’est le nombre. Le français avancé parlé dira : Ce que ça importe dans un pays, c’est le nombre ; tandis que le français avancé écrit aura : Ce qu’il importe dans un pays, c’est le nombre. Or un seul et même besoin est à la base de ces deux fautes ; le besoin d’invariabilité demande que la transposition de la phrase indépendante en une proposition relative s’effectue avec le minimum possible de changements. C’est donc le type de l’indépendante qui dans chaque cas commande la forme nouvelle : Ça importe > Ce que ça importe ; Il importe > Ce qu’il importe.
Par ces sortes de coïncidences, nous tâcherons de montrer que certains faits du français avancé, malgré l’aspect chaotique qu’ils présentent au premier regard superficiel, sont réductibles à des types, dont l’importance dépasse celle des altérations particulières.
De ce point de vue, la langue parlée et la langue écrite, 36par certains de leurs aspects, diffèrent moins qu’on ne le croit ; la différence est davantage dans les procédés mis en. œuvre que dans les besoins. La langue commune, ou langue de grande communication, est définie par le besoin biologique qui en est la raison d’être : la transmission rapide et étendue de la pensée entre le plus grand nombre d’individus malgré leur hétérogénéité. Au sein de cette langue, on peut distinguer la langue courante (parlée) et la langue cursive (écrite). La seconde, qui est surtout la langue des affaires, de la publicité, de la presse, etc., ne diffère de la première que par les procédés. Ce n’est pas un paradoxe de dire que la langue courante est plus proche de la langue cursive que de l’argot, et la langue cursive plus proche de la langue courante que de la langue littéraire et poétique.
Ce sont les journaux surtout qui servent aujourd’hui de pont entre l’écrit et le parlé ; étudiés dans les limites et avec les réserves nécessaires, ils nous fourniront un très grand nombre d’exemples.
Il serait difficile aussi de ne pas tenir compte de l’opinion des puristes et des grammairiens. Notre attitude à leur égard est délicate. Placés sur le plan fonctionnel et non, comme eux, sur le plan impératif et normatif, nous éviterons par cela même toute polémique. En revanche, nous les utiliserons largement à titre documentaire. Beaucoup d’entre eux fournissent en effet de véritables répertoires de faits, qu’il est très utile de consulter (en prenant garde, toutefois, que la majorité de leurs exemples appartient à la langue écrite).
Mieux que les journaux et les puristes, c’est l’enquête parlée et les lettres populaires qui livrent les faits les plus abondants et les plus sûrs. Outre les lettres publiées par M. Van Der Molen et par M. Prein, nous avons pu consulter une partie des lettres parvenues à l’Agence des Prisonniers de Guerre (Comité International de la Croix-Rouge, Genève 1914 sv). Rédigées le plus souvent par des personnes de culture rudimentaire — généralement des femmes du peuple — expédiées de tous les coins de France, ces lettres reflètent assez fidèlement l’état de la langue courante et populaire d’aujourd’hui.37
5) Coïncidences interlingues
L’idéal de la linguistique fonctionnelle serait de poursuivre la recherche des coïncidences non seulement entre les différentes parties d’une langue donnée, mais encore d’une langue à l’autre. Voilà évidemment une tâche de l’avenir, à laquelle on ne pourra pas encore songer ici.
Mais il ne sera pas inutile de terminer cette Introduction par une perspective qui dépasse l’étude présente, en montrant comment notre manière de concevoir la comparaison des langues s’oppose — radicalement — à la grammaire comparée traditionnelle.
Tandis que cette dernière recherche des correspondances de langue à langue, qu’elle interprète en les ramenant à un type ancestral unique dont elles sont le développement, la linguistique fonctionnelle recherche des coïncidences, qu’elle explique en faisant appel à un besoin identique qui les détermine. Deux conséquences importantes résultent de cette opposition.
D’une part, la méthode de la grammaire comparée ne peut être qu’historique et ne peut porter naturellement que sur des langues de même famille, c.à.d. qu’on suppose dériver d’une origine commune. La linguistique fonctionnelle, sans exclure la comparaison entre des langues généalogiquement ou culturellement parentes, a pour exigence idéale la recherche de coïncidences entre des langues qui ne soient reliées ni par des liens généalogiques ni par des emprunts.
D’autre part, la grammaire comparée doit, pour être fructueuse, tabler sur les éléments les plus archaïques et les moins spontanés. La linguistique fonctionnelle, au contraire, ne peut s’intéresser qu’aux faits les plus avancés et les plus spontanés que puisse présenter un état de langue.
6) Coïncidences inter-sémiologiques
6) Une tâche plus vaste et plus lointaine sera la recherche de coïncidences inter-sémiologiques, c’est-à-dire entre les divers systèmes de signes (langage articulé, langage gestuel, art, cultes, rites symboliques, formes de politesse, signaux, monnaies, etc.) dont l’ensemble constitue l’objet de la Sémiologie. Cette science, définie par F. de Saussure (CLG 33), nous dira peut-être 38un jour si les besoins fondamentaux qui sont la raison d’être de tout idiome, ne forment pas aussi la base de tout système de signes.
Telle est la méthode que nous soumettrons, dans ce livre, à une première application.
Arrivé au terme de cette Introduction, le lecteur se demandera peut-être si la linguistique ainsi comprise est encore une science autonome, ou si nous ne retournons pas tout simplement à l’ancienne « psychologie du langage ». On sait que le Cours de Linguistique Générale de F. de Saussure se termine par cette phrase, qui en marque l’idée fondamentale : « la linguistique a pour unique et véritable objet la langue envisagée en elle-même et pour elle-même ».
Mais dès que l’on considère la langue comme un instrument agencé en vue de fins données, la conception saussurienne devient trop étroite. Comment une science pourrait-elle étudier un instrument envisagé en lui-même et pour lui-même ? Nous dirons pour notre part que la linguistique fonctionnelle a pour unique et véritable objet le langage, envisagé comme un système de procédés qui est organisé en vue des besoins qu’il doit satisfaire.39
Interdépendance : assimilation et différenciation
Une langue n’est pas simplement une collection de signes existant chacun pour soi, mais forme un système de valeurs en vertu duquel chacun des éléments est solidaire des autres, c.à.d. dépend de la structure de l’ensemble et ne peut être ce qu’il est que dans et par sa relation avec le reste. Dans un tel système, la création, la modification ou la perte d’une seule valeur entraîne, l’altération des autres valeurs et détermine un regroupement général.
Tout système de valeurs suppose un ensemble d’oppositions formées d’identités partielles et de différences partielles. Les deux besoins opposés, mais solidaires, qui tendent en partie à assimiler les éléments les uns aux autres (chap. I) et en partie à les différencier (chap. II), sont à la base de tout système de signes.41
Chapitre premier Le besoin d’assimilation
Tout fait de langage tend à créer et à s’associer les faits qui peuvent entrer en système avec lui. Le besoin d’assimilation est la forme linguistique de l’instinct d’imitation, facteur tout-puissant dans la vie sociale ; tel ou tel élément, qui s’impose avec plus de force que ses concurrents, fait tache d’huile. C’est dans ce sens que l’on peut parler d’une « force d’imitation inhérente au système lui-même » (Systemzwang).
Selon la séparation du fonctionnement en deux axes établie dans l’Introduction, nous distinguerons l’assimilation mémorielle et l’assimilation discursive.
La première consiste à modifier ou à créer un élément par imitation d’un modèle logé hors du discours, dans la conscience linguistique. On peut appeler cette forme d’assimilation l’Instinct analogique.
L’assimilation discursive, ou Conformisme, oblige les éléments — grammaticaux aussi bien que phoniques — qui se suivent le long de la chaîne parlée, à varier les uns en fonction des autres (Accord, Concordance des Temps, Attraction des Modes, Sandhi, etc.).
A) L’instinct analogique
L’instinct analogique ainsi défini est un principe un qui se manifeste sous des formes variées comprenant, outre l’analogie proprement dite, tous les faits si divers qu’on appelle 43étymologie populaire, contamination, attraction homonymique, etc.
On a voulu séparer l’analogie des autres variétés, en ne reconnaissant qu’à la première un rôle important dans le fonctionnement du langage. M. Millardet a cependant montré qu’il n’y a pas antinomie absolue entre analogie et étymologie populaire. Ce « sont deux phénomènes comparables en ce sens que, sur une forme A, agit une forme B, par suite d’une association d’idées plus ou moins complexe, d’où naît une forme C ». (Linguistique et Dialectologie romanes, 396 sv).
D’autre part, des termes comme étymologie « populaire », contamination, contagion, etc., font trop souvent croire qu’il s’agit de formes essentiellement pathologiques. Cela suppose un malentendu constant, car l’incorrect (point de vue normatif) est loin d’être nécessairement un déficit (point de vue fonctionnel).
Le plus simple sera de distinguer l’instinct analogique selon qu’il agit sur la signification (Analogie sémantique) ou sur le signe (Analogie formelle).
1) Analogie sémantique
2) Analogie formelle
L’action d’un signe sur un autre peut aller jusqu’à substitution complète : Valoir > Falloir (Il faut mieux que vous y alliez : Joran n° 130), Voie > Voix (Ayant appris, par la voix des journaux, que vous vous chargiez de…, APG), etc.48
L’analogie formelle n’intéresse pas seulement le vocabulaire. Beaucoup de fautes de syntaxe s’expliquent par le croisement de deux formules ; il en est ainsi pour la négation explétive et autres faits semblables, d’ailleurs bien connus : La plus formidable facilité qui n’ait jamais été offerte à la clientèle, Elle se gêne avec d’autres qu’avec moi, Racontez cela à d’autres qu’à moi, Il ne l’accepterait de personne excepté de son fils ; etc.
Outre les croisements, il faut mettre à part les cas d’analogie formelle dus au besoin instinctif de classer les signes en un certain nombre de familles plus ou moins logiques. Cet instinct classificateur, base de tout système linguistique, se manifeste sous des formes variées.
Les agences parlent de voyages par Terre, Air, Mer et Fer. Les transports se font par rail ou par route. Les statistiques de navigation opposent le moteur et la vapeur. A la houille blanche produite par les chutes d’eau, est venue s’ajouter la houille verte (rivières et neuves), la houille bleue (vagues et marées) et même la houille incolore (vent). Après l’Internationale rouge, nous avons connu une Internationale jaune, une noire (Eglise), une verte (agriculture), une blanche (réaction), etc.
Cette lutte de la sémantique contre la morphologie se manifeste mieux encore comme une révolte de la logique contre l’illogisme de la catégorie morphologique, dans le « singulier sémantique » — par exemple la revue Les Lectures pour Tous désignée dans le peuple La Lecture pour Tous (B 25 n) — et dans le « masculin sémantique » : Un ordonnance, Un clarinette (Vincent 35), Il a été le dupe dans cette affaire (id. 59), etc.
L’action féminisante de la consonne finale se vérifie aussi pour certains adjectifs. Pécuniaire, interprété comme un féminin (*pécunière), donne un nouveau masculin : L’argument 51Pécunier ne me touche pas (Joran n° 211), Le soldat N. a-t-il souffert d’embarras pécuniers ? (Godet xxv). De même, tiède entraîne un masculin tied (B 94), et inversement bleu un féminin bleuse (ib.).
On aurait tort de considérer tous ces « accidents » comme des cas pathologiques ; ils ne méritent pas tant de dédain. Considérés dans leur ensemble, ils ont leur raison d’être, en ce qu’ils répondent à une tendance organique du système : le besoin de ramener l’inconnu au connu.52
On peut même dire d’une façon générale que la prononciation « correcte » (c.à.d. à l’anglaise, à l’allemande, etc.) des mots empruntés est sentie par les Français comme pédante. 53Qui oserait prononcer knockout, etc. comme les Anglais (nokaut) ?
La francisation des noms propres, fréquente depuis la guerre, se fait soit par traduction (Hirsch > Cerf) soit par assimilation phonique et graphique (Dreyfus > Tréfousse ; Seligsohn > Zéligzon ; Ullmann > Oulman ; Frey > Fret, etc.).
L’analogie sémantique et l’analogie formelle ont pour caractère commun l’imitation d’un modèle prédominant dans la conscience linguistique. Déclenchées l’une et l’autre par la laxité des associations de mémoire qui rattachent un élément au reste du système, elles répondent au besoin de limiter cet arbitraire en motivant l’inconnu par le connu.
Mais le besoin d’assimilation, qui tend à combiner ainsi les éléments du langage en un vaste ensemble aussi homogène que possible, ne borne pas son action aux rapports mémoriels.
B) Le conformisme
Le conformisme embrasse tous les procédés par lesquels le besoin d’assimilation cherche à adapter les uns aux autres les divers éléments, grammaticaux aussi bien que phoniques, qui se suivent le long de la chaîne parlée. La linguistique fonctionnelle ne saurait trop insister sur l’identité de principe qui relie des faits aussi différents en apparence que l’Accord, la Concordance des Temps, l’Attraction des Modes, — et le Sandhi ou Conformisme phonique.
Le conformisme grammatical comprend, outre l’Accord proprement dit par lequel le genre et le nombre de l’adjectif ou du verbe varient en fonction du genre et du nombre du substantif auquel ils servent de déterminant ou de prédicat, tous les procédés à l’aide desquels les signes sont obligés de varier catégoriellement les uns en fonction des autres dans le discours.54
C’est ainsi que le verbe de la proposition subordonnée se règle temporellement et modalement sur la subordonnante (concordance des temps et des modes) : Il doute qu’il soit venu > Il doutait qu’il fût venu ; Je sais qu’il viendra > Je savais qu’il viendrait. Ces modes et ces temps de concordance n’ont pas ici de valeur temporelle ou modale par eux-mêmes ; ce sont de simples procédés d’assimilation discursive.
De même, le subordinatif doit changer de catégorie grammaticale en fonction de son régime, c.à.d. qu’il est préposition devant un substantif (après son départ) et conjonction devant une proposition (après qu’il est parti).
Le déterminant varie d’une manière analogue. Adjectif quand il accompagne un substantif (une chanson gaie), il se transforme en adverbe pour déterminer le verbe : chanter gaiment.
Le conformisme porte d’ailleurs aussi bien sur la coordination que sur la subordination. C’est lui qui exige que deux ou plusieurs termes, s’ils sont coordonnés, appartiennent à la même catégorie grammaticale : Je déteste de boire et de fumer (et non : *Je déteste la boisson et de fumer).
Il y a bien d’autres cas encore. Il faudrait mentionner particulièrement les divers phénomènes d’attraction, par exemple en grec ancien l’attraction du relatif par son antécédent : ἔσεσθε ἄνδρες ἄξιοι τῆς ἐλευθερίας (ἧς) κέκτησθε (Xénophon, Anab., I, 7, 3). Certains dialectes allemands connaissent l’attraction de la conjonction avec le verbe : obst du hergehst, dassen wir kommen, obben wir gehen, obt ihr geht (Gabelentz, Sprachwissenschaft, 214, 398). Mais l’exemple classique en cette matière est fourni par les classificateurs des langues bantoues : « Le classificateur de chaque mot a une telle importance qu’il se répète au cours de la phrase pour tous les mots qui s’y rapportent : on dirait que le mot principal impose la couleur de son uniforme à tous les mots qui dépendent de lui » (Vendryes, Langage, 113).
Le conformisme est donc un procédé général d’assimilation discursive, qui caractérise d’une manière ou de l’autre la plupart des idiomes. Nous examinerons d’après les matériaux 55du français avancé quelques-uns des problèmes qui s’y rapportent.
La question des fautes d’accord peut se poser de deux manières : I. L’accord se fait-il selon la catégorie, et dans ce cas avec le sujet ou avec l’objet ? (on a prétendu que dans le langage populaire l’accord tend à se faire spontanément avec le sujet : Brunot PL 335) ; 2. L’accord se fait-il « mécaniquement », c.à.d. selon la séquence, et dans ce cas avec l’élément qui précède ou avec celui qui suit ?
La fréquence et la similarité de ces faits prouvent qu’il ne s’agit pas de simple lapsus ou coquilles ; on voit aussi par là que l’Accord continue à répondre, même et surtout sous des formes incorrectes, à une tendance spontanée et vivante.
Grammatici certant… — L’imparfait est interprété comme temps de concordance par M. Bally (Germ. Roman. Monatsschrift, 6, 418) et M. Brunot (PL 787). Cette théorie est rejetée par M. Lorck, qui attribue à cet imparfait, conformément au psychologisme qui caractérise l’école romaniste allemande, une valeur sémantique en soi (Erlebte Rede, 45 sv ; v. Neutre Sprachen, 35, 460 sv).
Psychologisme. — On sait combien, pour ce genre de problèmes, l’explication psychologiste est chère aux romanistes allemands, de Tobler à nos jours ; v. E. Lerch, Die halbe Negation im Französischen (Die Neueten Sprachen, 29, 6 .sv). Le besoin d’expressivité a peut-être son mot à dire ici ; mais dans l’ensemble et quant au fond il s’agit surtout d’un phénomène de conformisme : la négation se répète au cours de la phrase pour tous les mots qui s’y rapportent. On peut dire d’elle ce qu’on a dit des classificateurs bantous : elle impose la couleur de son uniforme à tous les éléments de la chaîne parlée.
L’attraction du comparatif formait une tournure correcte en latin : verior quam gratior « plus vrai qu’agréable ». On la retrouve dans le français spontané : Plus il vieillit, plus il est meilleur ; La stabilisation sera faite probablement plus tôt que plus tard (R. Poincaré : Thérive NL 4. 8. 28).59
La syllepse du pluriel est la plus fréquente, mais il y a d’autres cas. Ainsi l’accord peut se faire au singulier et au féminin (Plus des trois quarts de sa population est constituée par la classe paysanne ; all. Das Weib verwandte ihre ganze Kunst darauf). Nous connaissons même un curieux exemple de syllepse d’après le temps : Cette ère de mille ans supposait un Etat puissant (historien).
Le conformisme phonique — ou sandhi (sens large) — est l’assimilation qui se produit entre les éléments phoniques dans la chaîne parlée. Le sandhi, qui comporte de multiples variétés, peut se faire notamment d’après la sonorité (azaziner, tranzvormer, etc.), le mode d’articulation (pendant > pen-n-ant) et le timbre (harmonie vocalique, ex. j’aimais = jèmè, j’ai aimé = jéémé).60
Pour l’étude détaillée du phénomène, nous renvoyons le lecteur aux traités spéciaux. Ce qui nous importe ici est de signaler le parallélisme entre le conformisme grammatical et le conformisme phonique, que le point de vue fonctionnel permet de ramener à un principe un.
L’assimilation discursive exige également que les signes qui entrent en combinaison dans la chaîne parlée, fassent partie du même stock linguistique. Ainsi, un élément appartenant au stock populaire ne peut se combiner qu’avec un élément de même couleur, un élément savant qu’avec un élément savant : règle-ment / régul-ation ; avant-coureur / pré-curseur, etc. (v. Bally LV 203-4). Le même fait s’étend au domaine de la graphie : rationnel / rational-isme, donner / don-ation, consonne / conson-ant-isme, etc.
Ce besoin, que nous appellerons faute d’un terme meilleur le conformisme lexical, est senti très vivement par la langue contemporaine. Nous verrons cependant que l’emprise croissante du besoin d’invariabilité sur les autres besoins et notamment sur le conformisme, tend à faire abandonner l’ancienne réluctance du français pour les hybrides.
L’antinomie entre l’invariabilité et le conformisme éclate d’ailleurs sur toute la ligne. La multiplicité des formes qu’engendre l’assimilation discursive augmente en effet l’effort de mémoire à fournir, et provoque par conséquent des réactions en sens contraire. Selon les idiomes, cette lutte se résout dans la victoire de l’un ou de l’autre des deux besoins. Dans le langage avancé d’aujourd’hui, c’est le besoin d’invariabilité qui semble devoir l’emporter de plus en plus.61
Chapitre II Le besoin de différenciation (clarté)
J. Gilliéron : Pathologie et Thérapeutique verbales, I-IV, 1915-21.
J. Gilliéron : Généalogie des Mots qui désignent l’Abeille, 1918.
J. Gilliéron : La Faillite de l’Etymologie phonétique, 1919.
G. Millardet : Linguistique et Dialectologie romanes, 1923.
Le besoin de clarté cherche à distinguer les éléments linguistiques les uns des autres pour éviter les confusions, latentes ou réelles, qui surgissent dans le fonctionnement de la parole. Ici comme ailleurs, le rapport de finalité est constitué par trois termes : le besoin (clarté), le déficit (confusions, équivoques) et le procédé (différenciation).
Le rôle d’initiateur dans ce domaine appartient à Jules Gilliéron, dont les études sur la Pathologie et la Thérapeutique verbales fournissent la meilleure illustration de la finalité empirique du langage telle que nous la concevons. Il faut avouer cependant que l’effort de ce dialectologue s’est concentré presque exclusivement sur les faits de lexique ; tandis que nous aurons l’occasion de constater que le besoin de clarté porte sur tous les éléments du langage : signe et signification, valeurs lexicales et catégories grammaticales, — jusques et y compris la phonologie.
A première vue, il semblerait que le problème à résoudre consiste simplement à chercher comment le langage s’y prend pour détruire les équivoques existantes ; c’est le point 63de vue de la « thérapeutique ». Une vue plus complète devra tenir compte aussi du rôle très important joué par la « prophylaxie ». Lorsqu’il s’agit d’une langue de grande communication telle que le français, parlée avec moins de liberté et plus de conscience que le patois, et subissant de plus l’influence conservatrice de la langue écrite, il est à supposer que dans bien des cas l’équivoque, dépistée dès qu’elle est sentie sous roche, ne pourra guère monter jusqu’à la surface. C’est ce genre de faits que Gilliéron appelait dans sa terminologie pittoresque les « fantômes lexicaux », les « places gardées », etc. (Abeille, 259 sv) ; nous parlerons plus simplement d’équivoques latentes et d’incompatibilités que le besoin de clarté cherche à éviter à l’aide de divers procédés préventifs.
Dans le livre qu’il a consacré à l’influence du journalisme sur le vocabulaire, M. Vittoz classe parmi « les principaux éléments de conservation de la langue… l’obligation de se faire comprendre, et de se faire comprendre exactement » (181). Et de fait la « clarté française » a toujours été un des principaux arguments des défenseurs de la langue. Mais la question serait de savoir si la langue correcte ne présente pas elle-même des équivoques intolérables et si quelques-unes des innovations que l’on reproche au français avancé ne sont pas dues précisément au besoin de prévenir ou de détruire les équivoques, latentes ou déclarées, que présente le français traditionnel. Dans ce cas le besoin de clarté, par les procédés de différenciation qu’il déclenche, constituerait au contraire un des facteurs du changement linguistique.
A) Pathologie et thérapeutique
1) L’équivoque
Le principal déficit qui amène le besoin de clarté à recourir aux procédés de différenciation, est l’équivoque. Celle-ci peut être constituée, dans le jeu de la parole, soit par la rencontre sur un signe unique de deux ou de plusieurs significations, 64entre lesquelles l’entendeur ou le lecteur devra choisir (= bisémie, polysémie), soit par la ressemblance ou l’identité phoniques de signes incompatibles quant au sens (= homophonie).
On entend soutenir quelquefois que l’équivoque n’existe jamais qu’à l’état d’abstraction, par exemple dans les colonnes des dictionnaires, mais qu’elle ne se produit guère dans l’usage hic et nunc que l’on fait de la langue.
Il suffit de prêter l’oreille au jeu quotidien de la parole — dans la rue, au magasin, au téléphone, à table — pour se convaincre du contraire : J’aimerais acheter des plumes (des porte-plume ou des becs ?) ; Passe-moi la pomme (pomme-fruit ou pomme d’arrosoir ?) ; Les indigènes se sont révoltés (les troupes de couleur ou les autochtones ?) ; On a oublié de mettre le timbre sur cette lettre (le timbre-poste ou l’oblitération ?) ; J’ai vu sé lettres (les lettres de lui ? d’elle ? ces lettres ?) ; Il a permis à séz ouvriers de partir (à ses propres ouvriers ? à ceux d’un autre ? à ces ouvriers ?) ; C’est une vue de loteldülak (une vue de l’Hôtel du Lac ? une vue de l’hôtel à partir du lac ?) ; et ainsi de suite.
Gilliéron a montré l’étroit rapport de cause à effet qui bien souvent lie le monosyllabisme à l’homophonie. En effet, plus le signe est court, et petit le nombre des différences phoniques qui le constituent, plus le danger de confondre ce signe avec d’autres signes soumis aux mêmes conditions augmente. On sait à quels procédés spéciaux les langues monosyllabiques (chinois) et les langues monosyllabisantes (anglais) sont obligées d’avoir recours pour remédier à cet inconvénient : complications phoniques (tons distincts à valeur sémantique et morphologique, aspirations, etc.), complications graphiques (orthographe anglaise, idéogrammes chinois), complications grammaticales (composés formés de synonymes juxtaposés, suffixes et déterminatifs distincts pour chaque homophone différent, etc.). On sait aussi que les signes courts ou monosyllabiques que le besoin de clarté, pour une raison ou pour une autre, n’a pas réussi à différencier, sortent de l’usage, vieillissent et finissent par disparaître.
Nous ne nous éloignerons pas trop du sujet de cet ouvrage 65en énumérant ci-après les principaux monosyllabes qui ont disparu du français ou sont en train de le faire. La linguistique fonctionnelle s’intéresse aussi bien aux moribonds qu’aux nouveau-nés : aux uns, pour découvrir les causes de leur agonie ; aux autres, pour connaître les raisons de leur naissance. « C’est surtout dans la nécropole des mots qu’il faut chercher la vérité biologique [= fonctionnelle]. — C’est par l’étude de ces mots que devrait débuter l’historien de la langue pour asseoir ses connaissances et ses principes biologiques, pour savoir les conditions de vie et de mort des mots : seuls les morts peuvent nous permettre de tracer un tableau d’une vie lexicale complète, eux seuls nous révèlent infailliblement la cause qui les a frappés à mort. » (Abeille, 283-4). Quant aux mots que nous appelons vieillis, « à l’égal des mots disparus du français, ils ont l’avantage d’étaler devant nous une vie lexicale complète, mais une vie encore à son dernier souffle, à l’agonie, et celle-ci est souvent seule à pouvoir nous révéler la cause de leur mort prochaine, et celle-ci que dans les mots disparus nous ne pouvons étudier que d’après les dires de nos aïeux, plus ou moins sujets à caution, dans les mots vieillis nous pouvons l’étudier sur nous-mêmes, sur le vif, en pleine connaissance de leur vitalité déclinante. » (Pathologie et Thérapeutique, III, II).
Cette liste montre que la chute des verbes est provoquée par deux déficits principaux : leur irrégularité, et leur homophonie avec d’autres verbes. Que l’irrégularité n’est pas le facteur principal, les défaillances et l’extinction progressive d’un certain nombre de verbes réguliers, appartenant à la première conjugaison, suffisent à le prouver (cf. celer en face de seller et sceller ; bailler « donner » et bayer « béer » en face de bâiller ; conter en face de compter, ouvrer en face de ouvrir, voyer en face de voir, etc.).
2) Les procédés différenciateurs
Outre la revivification des consonnes finales, d’autres procédés encore peuvent intervenir pour grossir le volume des monosyllabes et différencier les homophones.
C’est ainsi que du verbe haïr, quand ce dernier n’est pas tout simplement remplacé par détester, les trois formes du passé (je tu haïs, il haït) sont transportées au présent (au lieu de je tu hais, il hait).
L’adverbe hier « se distend chez les Parisiens pour paraître avoir plus de corps : le provincial — celui de l’Est du moins — est surpris de les entendre dire hi-er. » (Pathol. et Thérap., IV 11). Cette prononciation est même recommandée : « L’adverbe hi-er a deux syllabes depuis le XVIe siècle, et ne doit pas se prononcer yèr. » (Martinon I 195).71
Pour distinguer la pomme d’arrosoir de la pomme-fruit, il arrive qu’on ferme et allonge l’o : Passe voire la paume pour la mettre à l’arrosoir !
Contrairement aux efforts du français avancé pour l’unification du radical verbal, le futur populaire du verbe trouver est aberrant : je trouvérai, tu trouvéras, il trouvéra, etc. (Martinon I 165, B 119). Cette exception semble attribuable au besoin d’éviter la confusion avec le verbe trouer, par suite de l’affaiblissement graduel de la consonne v en langage populaire : je trou(v)erai > < je trouerai.
On sait depuis les études de Gilliéron (Abeille, 189 et passim) le rôle important joué par les pseudo-diminutifs — diminutifs par la forme mais synonymes — dans la différenciation des monosyllabes homophones : ovis → ovicula → ouaille, auris → auricula → oreille, acus → acucula → aiguille, etc. Dans la langue de nos jours, on dit : un grain de mil, mais : du millet.
D’une manière plus générale, les pseudo-dérivés — dérivés par la forme mais synonymes — remplissent la même fonction différenciatrice. C’est ainsi que le français populaire élargit fin en finition, plant en planton (Wissler 796), etc.
Un moyen beaucoup plus fréquent, c’est le renforcement sémantique, à l’aide de procédés syntaxiques ou morphologiques variés qui précisent le sens du terme équivoque : la Sainte-Cène, un ouvrage de vulgarisation dans le meilleur sens du terme, un ouvrage de haute vulgarisation, etc. ; sa famille à lui / à elle ; ou bien / là où, etc.
Ainsi et et est, dangereusement homophones, sont soumis à un traitement bilatéral. La conjonction et s’adjoint diverses particules qui l’étoffent : vivre et puis mourir, et alors, et ensuite, et maintenant. Plus personne, d’autre part, n’ose dire : Vivre est apprendre à mourir ; le remplacement de est par c’est (sans pause : Vivre c’est apprendre à mourir) est devenu une condition indispensable à l’intelligence de ce type de phrases.
Le dernier cas (de > depuis) est davantage une substitution qu’une explicitation. La substitution est le remède radical qui s’impose toutes les fois que les autres procédés sont inapplicables ou inexistants.
Une maison d’édition publie une Collection de Diffusion, qu’elle appelle ainsi sans doute pour éviter l’import péjoratif du mot vulgarisation.
Le traitement du comparatif plus par la finale (pluss) a été souvent signalé. Mais ce procédé, qui n’est qu’un pis-aller, est senti à la longue comme insuffisant. Le remède radical est dans la substitution du mot davantage : J’en ai davantage, Il a davantage de temps, Il en a davantage que lui, etc.
Le déterminatif quelque n’est plus employé au singulier, dans la langue parlée : quelque personne ferait équivoque avec le pluriel. Mais quelque a trouvé des remplaçants, qui permettent en outre de faire une distinction précieuse, connue du latin : une certaine personne (lat. quidam) / une personne donnée (lat. aliquis), et qui répond à l’opposition des lettres N et X dans les formules scientifiques.
Revivification des finales, renforcements divers, fausse diminutivité, explicitation, substitution, — telles sont les principales armes employées par le besoin de clarté contre l’équivoque. Mais une étude détaillée du problème devrait tenir compte de bien d’autres procédés encore. Ainsi une des fonctions actuelles du genre, catégorie en grande partie inutile au point de vue sémantique, est la différenciation 73des homophones : le père / la paire, le maire / la mère, le livre / la livre, etc. Le pluriel, quand l’idée s’y prête, réussit également : avoir des fonds, payer les frais, etc.
Le chinois parlé, langue où le monosyllabisme fait de l’équivoque une question de tous les instants, a dû se créer des procédés multiples : composés synonymiques, c.à.d. formés de monosyllabes synonymes juxtaposés, déterminatifs (particules numérales) variant pour chaque substantif homophone, tons différents pour chaque monosyllabe homophone, etc. On remarquera que l’accent français, par le fait qu’il porte toujours sur le prédicat, respectivement sur le déterminant, sert entre autres à différencier le déterminatif numéral de l’article indéfini : Donnez-moi une pomme (angl. one) / une pomme (angl. a).
Une étude plus complète aurait encore à mentionner le côté graphique du problème. Le langage, tirant parti des hasards et des artifices de l’évolution, distingue en effet les unités homophones en leur donnant à chacune un « orthogramme » différent : fond / fonds, du / dû, dessin / dessein, conter / compter, différencier (différenciation) / différentier (différentiation), etc. etc. L’analogie de ces orthogrammes avec les idéogrammes de l’écriture chinoise a été entrevue notamment par M. Paul Claudel : « … L’étude de la forme des caractères français me passionne : j’y trouve autant d’idéogrammes qu’en japonais. Le mot toit par exemple est vraiment le dessin de la chose représentée. En écrivant les mots, je pense leur forme… » (NL 4. 8. 28).
Comme l’a signalé dès longtemps M. Bally dans ses cours, c’est dans le besoin de clarté qu’il faut chercher la véritable raison d’être d’une bonne partie des chinoiseries de l’orthographe française. Celles-ci apparaissent dans la mesure où le danger d’homophonie est imminent ou, ce qui revient le plus souvent au même, dans la mesure où le volume des mots se rétrécit. Et ces procédés de visualisation des signes ne répondent pas simplement à une tendance artificielle de la langue écrite. Les auteurs qui connaissent l’écriture populaire 74remarquent « l’habitude d’ajouter des lettres qui n’existent ni en français correct écrit ni dans la prononciation populaire. Car le peuple, lorsqu’il fait des fautes d’orthographe, pèche plus par complication que par simplification ». (B 178).
Certains idiomes marquent à l’égard de ce problème une coïncidence qui n’est pas due au hasard. Les langues monosyllabiques comme le chinois et les langues monosyllabisantes telles que l’anglais et dans une moindre mesure le français, sont réputées pour la difficulté de leur phonétique et de leur orthographe. Le chinois différencie les homophones par le ton, la quantité, l’aspiration, etc. ; l’anglais par le timbre des voyelles, etc. ; le français, par exemple par la série des voyelles ouvertes ou fermées, ou par la riche gamme des voyelles nasales qui font le désespoir des étrangers.
Il s’agit donc d’un conflit entre deux besoins fondamentaux : la trop grande brièveté entraîne des équivoques, que le besoin de clarté corrige par des « chinoiseries » de prononciation et d’orthographe. En figurant la différenciation par D et la brièveté par B, on peut noter le phénomène par la formule D = f(B). Cette loi se vérifie pour le chinois, le japonais savant, l’anglais et, dans une certaine mesure, le français.
Réforme de l’orthographe. — La visualisation du signe est en désaccord avec la lutte pour la simplification de l’orthographe et montre combien cette lutte, pour certaines langues du moins, est artificielle. Aucune des tentatives entreprises tant en Chine qu’au Japon pour supprimer les caractères chinois n’a réussi ; pareillement, les tolérances orthographiques autorisées par l’Académie française depuis 1905 ont échoué, parce que contraires au génie spontané de la langue : « Concessions fort modérées, et cependant encore excessives. Latitude dont ni ceux qui l’ont accordée, ni ceux qui l’ont réclamée, ne songent à se prévaloir. Qui s’avise en effet, malgré la permission officielle, d écrire et dévoument, et confidenciel, et enmener, enmitoufler, enmailloter, et pié, et échèle, et dizième, et sizième, et pous, joujous, chous, genous, etc., etc. ? On s’était persuadé que l’insurrection contre l’orthographe traditionnelle avait tout le pays avec elle : l’événement a tout de suite démontré qu’on n’était en face que de quelques « intellectuels » en mal d’innovation ». (Joran. p. 144).75
Après avoir étudié la pathologie et la thérapeutique linguistiques en prenant comme point de départ le cycle fonctionnel, c.à.d. sous l’angle successif des équivoques et des procédés différenciateurs mis en œuvre pour y remédier, nous allons passer à l’examen d’une série de faits montrant comment le besoin de différenciation se réalise dans tous les principaux éléments du système : valeurs lexicales et catégories grammaticales, signe et signification, mémoire et discours, grammaire et phonologie.
B) Différenciation mémorielle
1) Différenciation formelle
Les cas de différenciation étudiés par Gilliéron concernaient surtout le lexique ; dans la suite, nous insisterons davantage sur la différenciation des catégories. Il arrive souvent en effet que les hasards de l’évolution phonétique et grammaticale finissent par mêler, dans une partie ou dans la totalité de leurs emplois, des catégories grammaticales distinctes. Le besoin de clarté est sans cesse à l’affût pour éviter toute équivoque dans ce domaine.
La langue moderne tend par exemple à ne plus distinguer les finales longues et les courtes, et cela entraîne des confusions entre le singulier et le pluriel (il croit > ikrwa < ils croient) ou entre l’indicatif et le subjonctif (qu’il croit > kilkrwa < qu’il croie). La tendance populaire à ajouter un yod aux formes du pluriel et du subjonctif ne doit pas être étrangère à ce fait : Ikrwa (croit) / ikrway (croient), Ivwa (voit) / ivway (voient), Il n’est pas possible qu’un homme ne krway pas ce qu’il krwa, qu’il ne vway pas ce qu’il vwa, etc.
Outre ces cas, il y en a où l’indicatif fait normalement équivoque avec le subjonctif (sans que cela soit dû à l’évolution 76phonétique moderne). Des formes comme qu’il ouvre, qu’il s’y intéresse peuvent appartenir aussi bien au subjonctif qu’à l’indicatif. Les auxiliaires qui supplantent peu à peu le subjonctif traditionnel peuvent intervenir utilement ici pour faire la différence : Et voici qu’il est question que la mariée doit ouvrir le bal (Thérive FLM 94), Il n’y a qu’un public restreint qui peut s’y intéresser (Van Der Molen 97).
De même, le présent et l’imparfait sont identiques dans certaines de leurs formes : nous croyons > nukrwayõ < nous croyions, et c’est une des raisons qui favorisent l’emploi de on : Nous on croit / nous on croyait.
Une source fréquente d’équivoques, dans tout le domaine de la langue, c’est la fermeture progressive de l’e final (è > é) : L’é fermé de mes, tes, ses, ces, les, des (qui se prononçaient autrefois avec è ouvert) appartient désormais à la « bonne prononciation » ; billet, désormais, excès, gai, geai, jamais, mai, mais, quai, je tu il sait, succès, sujet, etc., sont en train d’installer l’é fermé. Cette évolution entraîne de fâcheuses confusions entre certaines formes de la conjugaison. Le passé simple ne se distingue plus de l’imparfait (je mangeais > imàžé < je mangeai), ce qui crée un motif de plus au remplacement du temps simple par le composé (j’ai mangé). Le conditionnel ne se distingue plus du futur (je mangerai > žmãžré < je mangerais), d’où création et extension de formes de futur et de conditionnel composées : j’aimerais manger, je voudrais manger, etc., opposés à je veux manger, je vais manger, etc. Le passé composé de l’indicatif ne se distingue plus du subjonctif passé (que j’ai mangé > žé < que j’aie mangé), et cette équivoque nécessite la prononciation : que j’aye (ey, qqf. ay) mangé.
Dans la langue écrite, l’homophonie de plusieurs formes du passé et du présent motive la création de passés incorrects : Je jouissai d’avance du supplice que j’allais faire subir à ma victime et je choisissai mon moment (Curnonsky et Bienstock, Musée des Erreurs, 17), Le Conseil fédéral les exclua (Godet XXIII), Il conclua bientôt que… (id. LVII) ; v. B 117. Tous ces cas se rapportent à la langue écrite, ou à la langue parlée de teinte écrite. Pour la langue parlée courante, 77c’est une raison de plus en faveur du remplacement définitif des formes simples du passé par des formations composées.
Une équivoque particulière à la langue parlée a été signalée dès l’Introduction : c’est lui quila fait venir (qu’il a ? qui la ? qui l’a ?). L’accord du participe intervient ici d’une façon heureuse pour distinguer le passé du présent : C’est lui qui l’a faite venir, Il l’a faite manger, La joie l’a faite changer de couleur.
L’évolution phonétique a amené la confusion de certaines formes de l’indicatif passé et de l’imparfait du subjonctif (qu’il aimast → qu’il aimât > < qu’il aima ; qu’il reçust → qu’il reçût > < qu’il reçut ; qu’il fist → qu’il fît > < qu’il fit, etc.). Cette confusion entraîne, dans la langue écrite de nos jours, la création de certaines fautes destinées à différencier ces deux catégories grammaticales : Il n’y avait pas un homme de la caserne qui ne riât aux larmes (Curnonsky et Bienstock, Musée des Erreurs, 17).
La confusion entre le passé simple et l’imparfait du subjonctif est parallèle à celle entre le passé antérieur et le plus-que-parfait du subjonctif : Il eut aimé > < Il eût aimé (cf. surtout les fautes du type : Dès qu’il eût…, Dès qu’il fût…, Après qu’il fût…). On sait que le remplacement du passé antérieur composé par le surcomposé est une simple unification analogique (il eut > il a eu = il eut mangé > il a eu mangé) ; mais l’état de confusion entre le passé antérieur et le subjonctif passé motive d’autant plus ce remplacement.
On sait que dans le français avancé le verbe disparaître ne prend pas l’auxiliaire avoir, ce qui explique l’équivoque de il est disparu « état consécutif à un procès > < procès logé dans le passé ». Il va sans dire que dans ces emplois le passé antérieur, au lieu de fonctionner comme un temps relatif (« passé dans le passé »), sert de temps absolu.
Mais nous ne sommes pas encore au cœur du problème. M. Meillet a montré dans son étude sur la disparition des formes simples du prétérit (Linguistique Historique et Lingu. générale, 149 sv) comment le français parlé a remplacé le passé simple par le composé. Cependant, « il est fâcheux que le français moderne ait réduit à un seul les deux temps passés dont il disposait, le passé défini et le passé indéfini : la différence qui les séparait était réelle, et l’on pouvait en les employant rendre de fines nuances, qui aujourd’hui disparaissent faute d’expression. » (Vendryes, Langage, 411). Quelle était cette nuance ? Les grammairiens s’accordent en général à reconnaître que le passé simple marquait « un fait entièrement achevé à une époque antérieure, plus ou moins déterminée, sans aucune considération des conséquences qu’il peut avoir dans le présent : à telle époque il aima, il reçut, il écrivit. C’est le temps naturel du récit historique ou de la narration ». (Martinon II 347). Le passé composé marquait « un fait achevé à une époque indéterminée, généralement récente, et dont on considère les conséquences dans le présent : j’ai terminé mon travail ; je suis arrivé à mon but ». (ib.). De ces définitions, qui sont complexes, nous ne retiendrons que ce qui nous paraît l’essentiel : le Passé défini marquait le « passé déterminé », le Passé indéfini le « passé indéterminé ». (v. D’Harvé PB p. 262 n).
M. Foulet, à qui nous empruntons la plupart de ces exemples (Romania, 51, 203 sv) a signalé les notions de recul dans le passé et d’indétermination quant à la date que cette forme surcomposée est chargée de rendre. Mais il importe de bien distinguer l’emploi de ce passé comme temps absolu (« passé indéterminé ») ou relatif (Passé antérieur = « passé dans le passé »).
Le français traditionnel distingue le participe présent marquant un procès, du participe pris au figuré comme qualificatif, en accordant ce dernier avec son substantif : Une femme causant (« procès ») / Une femme causante (« qualité »). Mais pour le participe passé, le français traditionnel n’a pas de procédé signalant formellement la différence ; seuls, la situation et le contexte permettent d’établir si un participe passé est pris au sens propre (« état consécutif à un procès ») ou s’il est transféré en un qualificatif.
Les mêmes réactions différenciatrices se constatent dans le domaine des adjectifs de procès, sans cesse guettés par la transformation en qualificatifs : un élément décisif / décisoire, des mesures conservatives / conservatoires, une théorie réfléchie / réfiexive (Lalande 693), un jugement relatif / relationnel, etc. Les adjectifs potentiels négatifs surtout, finissent fatalement par verser dans la qualification (incommensurable, intolérable, intangible, etc. sont employés comme de simples évaluateurs), ce qui oblige le langage à les recréer sans cesse soit dans le parler (pas comparable, pas mesurable ; pas à comparer, pas à mesurer) soit dans l’écrit (non-comparable, non-mesurable…).
Différenciation explicite. — Les langues qui ne peuvent se servir de la séquence distinguent par la forme : Eine neue Methode / eine neuartige M., eine einzige Sammlung / eine einzigartige S., eigene Beobachtungen (des observations personnelles) / eigenartige B. (des o. originales).
2) Différenciation sémantique (bifurcation des synonymes)
En disant que l’équivoque est le principal déficit qui déclenche les procédés de différenciation, nous n’avons tenu compte que d’un côté du phénomène.
Un déficit qui forme la contre-partie de l’équivoque, 83la synonymie, est l’objet de vues contradictoires. On affirme ou nie tour à tour l’existence de synonymes dans le langage. La linguistique fonctionnelle pose la question autrement. Il y a des synonymes, mais cette synonymie étant conçue comme un déficit, le langage cherche à s’en débarrasser. Deux solutions sont alors possibles : ou bien la langue ne conserve que l’un des deux concurrents et abandonne l’autre, ou bien — et c’est ce qui nous intéresse ici — elle conserve les deux en revotant chacun d’une signification distincte (ex. âpreté / aspérité, avoué / avocat, chaire / chaise, col / cou, etc.).
Bibliographie. — Bréal, Sémantique, 26 n. (loi de répartition) ; Erdmann, Bedeutung des Wortes, 28 sv. (Bedeutungsdifferenzierung des Gleichwertigen, Gabelung des Plurals) ; Gabelentz, Sprachwissenschaft, 238, 254 (Entähnlichung der Bedeutungen bei Doubletten).
Quand on n’étudie des signes que leur histoire, il est difficile d’établir dans chaque cas s’il y a eu différenciation formelle ou sémantique (voir les exemples donnés plus haut). Il est donc nécessaire d’observer le phénomène sur le vif, dans les fluctuations de l’usage présent.
Au sens étroit, la bifurcation porte sur les doublets, c.à.d. les formes distinctes d’un signe conçu comme identique. C’est ainsi que recouvrer et récupérer, qui coexistent dès le XVIe siècle, admettent aujourd’hui des emplois distincts : on recouvre une somme due, une taxe, un impôt, mais on récupère ce qu’on a perdu (v. Gilliéron, Abeille, 267). Un acquéreur est celui qui achète pour son propre compte, tandis que l’acquisiteur le fait pour le compte d’une maison (Godet VI, VII).
La bifurcation est un procédé courant de la langue savante. La majeure partie de l’effort terminologique des savants et des philosophes, si l’on fait abstraction des néologismes formels, repose sur la différenciation des synonymes. Pour ne citer qu’un exemple, l’opposition des préfixes négatifs latin in- et grec a-, est souvent utilisée pour distinguer les contraires et les contradictoires : Le génie est a-moral et non immoral, le langage est a-logique et non illogique, etc.
La langue administrative se sert également de la bifurcation. Ainsi la poste suisse ne distingue pas entre une lettre chargée ou recommandée ; en France, l’administration a différencié les deux mots : lettre recommandée (all. eingeschrieben) / chargée « valeur déclarée ».
La bifurcation peut aussi s’exercer sur l’import du signe, dans ce sens que de deux synonymes l’un sera pris en bonne l’autre en mauvaise part, ou que l’un appartiendra à un langage plus poli l’autre moins, etc. Ainsi les couples traditionnels voici-voilà, ici-là, çui-ci – çui-là, ne correspondent plus à la différence entre « proche » et « éloigné », mais à celle entre « relevé » et « populaire ». De même, la formule des magasins est Et avec ceci ?, tandis que sur le marché en plein air on entendra Et avec ça ? ; la numération en centimes (cinquante centimes) est plus relevée que celle en sous (dix sous) ; de suite est plus poli que tout de suite, etc. Cf. mou / mol (sens péjoratif et archaïsant : l’humanitarisme mol) ; fou / fol (un fol adorateur du peuple), etc.
Casuistique. — La manie des puristes et des grammairiens de chercher dans certaines fluctuations de l’usagé des nuances sémantiques subtiles, relève du même besoin que là bifurcation 86des synonymes et n’en est que l’exagération. C’est ainsi qu’ils veulent voir une différence entre je suis allé (« aller simple ») et j’at été (« aller-retour »), entre désirer de (« désir dont l’accomplissement est incertain ») et désirer tout court (« désir dont l’accomplissement est certain »), entre avant que et avant que ne (« sens légèrement dubitatif »), entre après-dîner et après-dînée, etc. etc. Personne au monde n a jamais su où ils prenaient tout cela.
C) Différenciation discursive
1) Différenciation syntagmatique
Bien téméraire celui qui dénierait à la syntaxe moderne des états pathologiques et des états restaurés. Je dirai même : à quand la syntaxe réparatrice ? (Gilliéron, Pathol. et Thérap., III, 55).
La différenciation syntagmatique embrasse tous les problèmes qui se rattachent au degré de cohésion et à la portée respective des signes enchaînés sur la ligne du discours.
Au point de vue du degré de cohésion des signes agencés, il faut distinguer le lexique (signes simples) et la syntagmatique (signes agencés) ; la syntagmatique se divise à son tour en syntagmatique plus ou moins étroite (morphologie) et syntagmatique plus ou moins lâche (syntaxe). Il est important pour la clarté de la chaîne parlée que ces divers éléments soient bien distingués les uns des autres, qu’un syntagme par exemple ne puisse être interprété comme un signe lexical (ex. nous apprenons d’ailleurs / par ailleurs que…), ni un groupe syntaxique comme un composé, etc.
Un des problèmes les plus importants, dans le domaine de la différenciation syntagmatique, est celui du de dit explétif, par lequel le français distingue le prédicatif du simple déterminant : une chambre libre / une chambre de libre. Ce de, qui est à peu près admis aujourd’hui dans certains cas, constitue dans d’autres une incorrection plus ou moins forte.
Les exemples les plus fréquents jusqu’à présent semblent se rattacher à la formule substantif actualisé + de + participe passé (ex. C’est un grand pas de fait). Pourquoi dit-on dans certains cas : un franc perdu, trois livres reliés, et dans d’autres : un franc de perdu, trois livres de reliés ? On a l’impression nette que un franc perdu et un franc de perdu, trois livres reliés et trois livres de reliés, etc., répondent à des valeurs syntagmatiques distinctes. Perdu, reliés sont de purs déterminants, qui s’appliquent à des signes virtuels (franc, livres), tandis que de perdu, de reliés sont des prédicatifs, portant sur des termes actualisés (un franc, trois livres).88
La différence entre prédicatif et déterminant s’accompagne d’une différence dans la délimitation des éléments. Les combinaisons virtuel + déterminant ont une cohésion assez forte : un | franc perdu, trois | livres reliés ; les combinaisons actuel + prédicatif, au contraire, présentent à peu près deux termes : un franc | de perdu, trois livres | de reliés. Les premières se rapprochent, à des degrés infiniment divers, de la composition, tandis que les secondes sont du côté de la syntaxe.
Dans ces trois langues, la place de l’adjectif déterminant est assez rigoureusement fixe. Il sera reparlé de la fin toute différente à laquelle sert la place mobile de l’adjectif français.
Après les nominaux tels que rien, personne, quoi, quelque chose, etc., le de est devenu à peu près obligatoire (quelques-uns condamnent encore personne de et rien de) ; cet emploi ressort de la nature même de ces signes, qui sont des actualisés par définition (rien « pas une chose », aucun « pas un homme », quelque chose « une chose donnée », etc.).
Autres langues. — Ici encore, il ne s’agit pas de subtilités particulières au français, mais d’une différence fondamentale (déterminatif + signe virtuel / nominalisé + actualisé), faite peu ou prou par la plupart des langues.
L’allemand distingue en combinant l’accord et le non-accord : Ich habe eine reife (< eine reife Traube, j’ai une mûre) /… eine reif (< eine Traube reif, j’ai une de mûre).90
L’anglais distingue en préposant ou postposant le représentant one : I have a ripe one (< a ripe grape) / I have one ripe (< a grape ripe).
Mais si en français l’article indéfini est interchangeable avec son nominal, il n’en est pas de même pour l’article défini ; on ne saurait dire *la de libre. La langue parlée a recours, dans ce cas, au démonstratif celui : Je vais vous donner celle de libre « la chambre qui est libre », On mettra de côté celles de véreuses « les pommes qui sont véreuses », etc. La formule est donc : une libre / une de libre = la libre / celle de libre.
Dans beaucoup de cas, le français correct ne peut se débarrasser de l’équivoque. Ainsi, un Monument aux morts pour la patrie, est-ce un monument aux morts dédié à la patrie, ou un monument érigé en l’honneur de ceux qui sont morts pour la patrie ? Le français est ici vraiment à un point tournant, si l’on considère les nombreux cas de syntagmatique équivoque appartenant à ce type ; le sujet vaudrait une étude détaillée, et les observateurs du langage spontané devraient guetter tous les procédés mis en œuvre par le langage avancé pour tourner la difficulté.
Il arrive que la liaison serve correctement à différencier 91les deux formules : Un marchand de drap(s) anglais / un marchand de draps-z-anglais (Martinon I 377), une fabrique d’arme(s) anglaise / une fabrique d’armes-z-anglaises (id. 380). Mais il faut bien avouer que ce procédé est actuellement plus que fragile.
Pour bien saisir la valeur de ce procédé, il ne faut consulter naturellement que l’oreille et faire abstraction de l’écriture. Bref, la recherche des moyens par lesquels le langage essaye de différencier la portée respective des signes agencés dans le discours, devrait être poursuivie dans tout le domaine de la grammaire syntagmatique. Cf. 26 dossiers de 2000 numéros (total) / 26 dossiers à 2000 numéros (chacun) ; elles sont toutes différentes (all. alle) / elles sont tout différentes (all. ganz), etc.
Une autre face du problème est ce qu’on peut appeler la différenciation séquentielle. Si le langage ne se servait de procédés spéciaux pour signaler l’inversion — notamment l’accent et l’usage de séparatifs — il serait difficile souvent de savoir si tel syntagme représente la séquence normale ou constitue une inversion. Dans les deux types : C’est un bijou que cet enfant ! (inversion expressive de : Cet enfant est un bijou !) et : un bijou d’enfant ! (inversion expressive de : un enfant bijou !), l’inversion est signalée par l’accent, qui 92porte sur le prédicat, respectivement sur le déterminant originels (bijou), et par les séparatifs de et que.
Un type d’équivoques fréquent porte sur la difficulté de déterminer le sujet d’un infinitif-régime. En principe, la règle héréditaire exige que le sujet de l’infinitif placé après un verbe soit le même que celui du verbe qui régit cet infinitif : J’espère venir demain = J’espère que je viendrai demain.
Mais la langue actuelle marque une telle préférence pour l’infinitif (en général aux dépens du subjonctif) qu’elle l’emploie même lorsque le sujet du verbe subordonnant et le sujet de l’infinitif subordonné sont différents. « L’emploi de l’infinitif est tellement commode, il allège tellement les phrases où il se trouve, qu’on en use volontiers même pour renvoyer à un complément, pourvu qu’il n’y ait aucune équivoque possible : le roi l’a choisi pour commander ; les électeurs l’ont nommé pour faire leurs commissions. On peut même dire, en renvoyant à un sujet indéterminé : pour faire sa fortune, le théâtre vaut mieux que le roman ; la marche est excellente pour s’entretenir en bonne santé ; ceci est excellent pour manger ou pour boire. Mais on voit sans peine le danger de cette syntaxe, et on sait que le français évite volontiers l’équivoque. » (Martinon II 447).
Le français avancé évite toute confusion dans ce domaine par l’insertion du pronom personnel entre la préposition pour et son régime l’infinitif : Va chercher le journal pour moi lire. Au premier abord, cette construction semble du petit-nègre ; mais elle est si bien attestée que son existence est hors de doute.
Bibliographie. — B 124. — Thérive FLM 47. — Marouzeau, Linguistique, 74. — D’Harvé PB, suppl. belge, § 171. — Prein, 15-6. — Van der Molen, 107-9, plus qqes ex. dans les lettres de mineur de l’Appendice.
Le participe présent entraîne les mêmes équivoques que l’infinitif et, parallèlement à lui, des procédés différenciateurs analogues : Mes parents vous ayant écrit, mais moi n’étant pas très bien avec, je ne sais ce que mon frère devient (APG).
Ce type, caractéristique de la langue cursive, est un latinisme déjà ancien, qui semble aujourd’hui admis.
Tous ces procédés, plus ou moins parallèles — pour moi écrire, moi voulant écrire, la lettre par moi reçue — ont leur origine dans la langue du droit et de l’administration : …Et lour donna rentes pour elles vivre (Joinville : Van Der Molen 108) ; Item, le 4e de feuvrier, vint Gargantuas loger en la sala et pour deux jours, tant de son cheval que dépance par lui faite, V sols (Registre des comptes, XVe siècle : D’Harvé PB § 359). De fait, la langue juridico-administrative est caractérisée par la place prépondérante accordée au besoin 95de clarté et aux procédés de différenciation qu’il déclenche ; ce qui achève de démontrer le parallélisme de ces diverses constructions.
2) Différenciation phonique
La phonologie mémorielle et la phonologie discursive sont soumises l’une et l’autre au besoin de clarté.
D’une part, dans les rapports de mémoire, les phonèmes doivent être suffisamment distincts pour qu’on ne les confonde pas entre eux. D’autre part, les éléments phoniques enchaînés sur la ligne du discours doivent être eux aussi nettement différenciés les uns des autres.
Nous laisserons de côté la différenciation mémorielle, question délicate qu’il faut réserver à des études spéciales, — pour ne considérer que l’aspect discursif du problème, sur lequel le français avancé fournit des renseignements plus abondants.
a) Délimitation.
Il est arrivé que des linguistes, tirant argument de ce fait, ont voulu nier « l’unité psychologique du mot ». Mais à défaut d’une correspondance exacte entre la séparation des syllabes et la délimitation grammaticale, telle qu’elle se rencontre dans les langues monosyllabiques, les procédés variés par lesquels les divers idiomes cherchent à séparer la finale du mot de l’initiale du suivant, et l’initiale du mot de la finale du précédent, semblent indiquer que la « conscience du mot » est bien une réalité linguistique.96
Tout problème de délimitation (discours) est d’ailleurs lié à un problème d’identification (mémoire). Ainsi le fait qu’en français la séparation syllabique et la délimitation grammaticale ne correspondent pas, amène une multitude d’inconvénients ; le calembour n’est pas un des moindres : Il est trop osé (> < trop posé), Il a une tentation (> < une tante à Sion), Ah non (> < ânon), etc.
Quels sont les procédés employés par le français pour faire coïncider la coupe de syllabe avec la limite de mot ?
Un procédé courant, et d’ailleurs à peine perceptible, est la non-liaison. Un syntagme comme avoir honte, par exemple, pourra se prononcer « syllabiquement » (a-vwa-rõt), ou au contraire « grammaticalement » (a-vwar-õt). Telle est la vraie raison d’être de l’h dit aspiré, qui est en réalité un séparatif destiné à faire correspondre la coupe de syllabe avec la limite de mot ; le langage populaire tend à l’étendre : un | huissier (B 44).
Dans quelques cas, le français avancé va encore plus loin et favorise la coupe des mots par l’insertion de consonnes 97séparatives : un vhuissier, de la vouate, une choupette (houpette à poudre, B).
De même, -tier a supplanté -ier (lait-ier → lai-tier), -ter a remplacé -er (abri-er → abri-ter), et ainsi de suite. Pareillement, « pour la conscience linguistique actuelle, le signe du futur est -rai et non plus -ai » (Bally LV 74) : J’aimer-ai → j’aime-rai.
Les changements de délimitation amenés par la tendance à l’initiale consonantique sont particulièrement visibles dans les groupes article + substantif. Deux cas sont possibles.
(Tous ces faits sont des accidents. Mais la sélection linguistique conserve de tels accidents, lorsqu’ils répondent à la tendance du français vers l’initiale consonantique. C’est à cette conservation par sélection que nous devons des mots comme lendemain, lierre, lingot, loriot, luette et tante).99
b) Dissimilation.
Tout au plus peut-on noter certaines préférences. Le français évite autant que possible la rencontre des k, en contact ou à distance. C’est à cette réluctance que nous devons la perte de formations telles que dans le cas que et au cas que ; dans le cas où et au cas où sont, au fond, des dissimilations.
Dans la langue de nos jours, on a recours aux procédés les plus divers pour éviter les rencontres de k. Ainsi, comme on ne saurait dire : *J’aime mieux qu’il s’en aille que qu’il reste, on a la tournure : J’aime mieux qu’il s’en aille que s’il reste. (D’autre part, on dit assez correctement, pour éviter la répétition de deux si : Si vous travaillez et que quelqu’un vient vous déranger…).
La dissimilation, sous ses diverses formes, porte naturellement aussi sur les répétitions de voyelles. Une des phobies du français, par exemple, c’est la répétition de plusieurs e muets : *Jə nə mə lə suis pas rappelé ; d’où la thérapeutique : Je (ne) m’en suis pas rappelé, appuyée sur l’analogie de je m’en souviens.
c) Netteté de syllabation.
« La tendance à alléger autant que possible la syllabe en supprimant les éléments qui entravent le mécanisme normal des explosions et des implosions successives, n’est pas illusoire. Sans aller aussi loin que l’arabe qui n’admet pas le contact de deux consonnes à l’intérieur de la même syllabe, les idiomes romans tendent plus ou moins nettement à réaliser un type de syllabe satisfaisant à la fois le sens articulatoire et le sens acoustique par une gradation aussi nette que possible des apertures. » (Millardet, 317).
Cette tendance différenciatrice qui cherche à rendre la syllabation aussi nette que possible, se manifeste sous deux formes principales, le besoin d’éviter les blocs de consonnes et celui d’éviter les rencontres de voyelles (hiatus).101
La prosthèse est particulière aux groupes ouvrants s + occlusive + phonème d’aperture plus élevée (ex. sta-, spé-, etc.). Ces groupes, par la succession d’apertures qu’ils présentent (1+o + phonème d’aperture plus élevée), sont en effet contraires à une bonne syllabation (principe des apertures régulièrement croissantes dans les groupes ouvrants, régulièrement décroissantes dans les groupes fermants : Saussure CLG 88 sv). La prosthèse a pour but de transformer l’s en une fermante suivie d’une limite de syllabe : scu-tum → is-cutum (→ escu → écu) ; spi-ritum → is-piritum (→ esprit). Exemples actuels : u-nəs-tatue, u-nəs-tation, etc. Cette prononciation est taxée de méridionale.
Il faut bien avouer d’ailleurs que le traitement des blocs de consonnes par l’insertion d’un e dit muet est entravé de plus en plus dans la langue de nos jours par la chute générale et progressive de cet ə même dans les cas où la netteté de syllabation exigerait son maintien. « Il nous paraît que les Français sont en train d’acquérir peu à peu une plus grande aptitude à prononcer des groupes de consonnes qui étaient autrefois réservés aux gosiers germaniques. Les gens qui, à l’heure actuelle, prononcent tout naïvement une estatue, une estation, excitent la risée des Français qui ont passé par l’école… Mais les modernes peuvent dire sans broncher, non seulement : un’ statue, mais : un’ grand’ statue, tourn’-toi, rest’-là, un’ solid’ structure, etc. » (Nyrop, Manuel phonét., § 92).102
En dernier ressort, quand aucun des moyens indiqués n’est applicable, c’est le besoin de brièveté, toujours à l’affût, qui intervient pour supprimer la difficulté phonique, en faisant tomber l’une ou plusieurs des consonnes en présence (amuissement).
Les blocs de consonnes ont leur contre-partie dans les rencontres de voyelles ou hiatus.
Le cuir, ou insertion d’un t, est beaucoup moins fréquent que le velours : Il va-t-et vient, Il faudra-t-aller (B 57), I va-t-en ville.
On sait que la langue de la poésie garde l’ancienne prononciation vocalique : ambiti-on, délici-eux, di-amant, passi-on, etc. Lorsque la seconde voyelle est moins ouverte que la 104première, la consonification atteint la seconde : abbaye > abèy (B 54).
Souvent d’ailleurs, il y a plutôt diminution d’aperture que consonification véritable : Agr(i)able, p(u)ète, c(u)incidence, (u)asis.
Citons pour terminer, le cas où l’hiatus est éliminé à la faveur de synonymies grammaticales : fainéant > feignant ; au hasard de la fourchette > à l’hasard de la fourchette (Martinon I 249) ; il n’a été fait d’exception pour personne (Joran n° 84).
Et là encore, comme pour les blocs de consonnes, c’est l’amuissement (dont il sera reparlé) qui a le dernier mot quand aucun autre procédé ne réussit.105
Économie : brièveté et invariabilité
Le besoin d’économie, bien qu’il puisse être tenu en échec par des influences opposées, est un facteur indéniable dans la vie du langage.
Pour le parleur et l’entendeur pressés, le jeu de la parole et de l’interprétation doit se dérouler aussi rapidement que possible. Le parleur abrège ou supprime plus ou moins inconsciemment tout ce qui dans une situation donnée va de soi, c.à.d. tout ce qui, étant connu de l’interlocuteur, forme le fond commun de leur conversation. L’entendeur, de son côté, au lieu de soumettre la parole de son interlocuteur à une analyse serrée, cherche à comprendre avec le minimum d’effort et de temps.
L’économie linguistique se manifeste sous deux aspects opposés, selon qu’on la considère dans l’axe du discours ou dans celui de la mémoire. Le besoin de brièveté (chap. III), ou économie discursive, cherche à abréger autant que possible la longueur et le nombre des éléments dont l’agencement forme la chaîne parlée. Le besoin d’invariabilité (chap. IV), ou économie mémorielle, cherche à alléger autant que possible l’effort de mémoire à fournir, en conservant toujours la même forme à un élément linguistique donné, malgré la variété des combinaisons dont il est amené à faire partie.107
Chapitre III Le besoin de brièveté
Bally, Copule zéro et faits connexes (Bull. Soc. Lingu. 23, 1 sv).
Brunot PL 63 sv (nominaux), 171 sv (représentants).
Nyrop IV § 77-97 ; V § 10-28.
Saussure CLG 248 sv (agglutination).
A) Figement (brachysémie)
Le mécanisme de la brachysémie ou brièveté sémantique, qui est le figement d’un syntagme, c.à.d. d’un agencement de deux ou plusieurs signes, en un signe simple, a été décrit par F. de Saussure sous le terme d’agglutination ; celle-ci « consiste en ce que deux ou plusieurs termes originairement distincts, mais qui se rencontraient fréquemment en syntagme au sein de la phrase, se soudent en une unité absolue ou difficilement analysable ». (CLG 249). Exemples : ce ci → ceci ; tous jours → toujours ; dès jà → déjà, etc. « Cette synthèse se fait d’elle-même, en vertu d’une tendance mécanique : quand un concept composé est exprimé par une suite d’unités significatives très usuelle, l’esprit, prenant pour ainsi dire le chemin de traverse, renonce à l’analyse et applique le concept en bloc sur le groupe de signes qui devient alors une unité simple. » (250).
Le phénomène présente deux faces successives, une face sémantique et une formelle, qu’il importe de bien distinguer. Au point de vue sémantique, la brachysémie est le remplacement d’une suite de deux ou plusieurs significations 109par une signification unique ; au point de vue formel, l’ancien syntagme, considéré désormais comme trop long en tant que signe simple, est soumis après coup aux effets de l’agglutination matérielle (abréviations, mutilations, etc.). Ainsi bonhomme, avec son pluriel correct bonshommes, est figé dès longtemps, tandis que l’agglutination matérielle qui consacre ce processus n’est qu’une innovation récente (des bonhommes). Il va sans dire que si la science se donne la liberté de dissocier les phénomènes, comme nous le ferons ici, pour les étudier séparément, dans la réalité concrète les deux aspects — brachysémie et brachylogie — sont trop solidaires pour se concevoir séparément.
Les principaux indices de la brachysémie sont la difficulté des substitutions partielles et, corrélativement, la facilité des substitutions totales. Ainsi bon marché est partiellement figé, car d’une part il est difficile de substituer mauvais marché, etc., et d’autre part il devient d’autant plus facile de substituer des synonymes (économique, etc.) ou des contraires (cher, etc.).
De même, la facilité de déterminer globalement et la difficulté de déterminer partiellement, sont aussi des indices corrélatifs. Dans des exemples populaires tels que : c’est plus bon marché, une marchandise plus bon marché qu’une autre, trop de bonne heure (Joran n° 289), le qualificatif s’applique à l’ensemble du bloc (au lieu de meilleur marché, de trop bonne heure).
Dans tous ces exemples, l’incohérence et le pléonasme sous roche ne percent qu’à l’analyse, et c’est précisément l’oubli du sens des éléments constitutifs du syntagme qui rend ces fautes concevables.
L’accord fautif peut être également un indice de brachysémie. Dans une phrase comme : elle a l’air méchante, l’accord, aujourd’hui toléré, signale le figement de avoir l’air en un verbe transitif d’inhérence : « elle paraît méchante ». Cf. Ces deux choses n’ont rien de comparables (n’avoir rien de > « n’être nullement »). Inversement, le non-accord des éléments bloqués sert à son tour d’indice : Elle s’est fait fort de réussir.
Bien que le figement ne soit pas directement un procédé, mais un processus, la finalité y a son mot à dire, car ce processus dans l’ensemble ne s’attaque pas à n’importe quels syntagmes, mais de préférence à ceux qui pour une raison 111ou pour une autre sont difficilement analysables, donc déficitaires.
La condition essentielle qui domine toute brachysémie est en effet, nous le savons déjà, l’incompréhension plus ou moins forte des éléments. Cette incompréhension se produit notamment lorsque l’invariabilité est en défaut, c.à.d. lorsque la mémoire ne parvient pas à rattacher les éléments du syntagme au reste du système, puisque l’entendeur tend toujours à interpréter les syntagmes en les ramenant à l’usage le plus communément reçu.
Le figement, considéré de ce point de vue, constitue donc un cas limite de la finalité (sélection par élimination des inaptes). Il s’attaque de préférence aux formes fossiles, qui, ne se laissant pas rattacher au reste du système, sont difficilement analysables. Exemple : Cette information s’est avérée inexacte (l’alternance vrai/ver- est un défi à la mémoire).
Le figement bloque naturellement de même manière les syntagmes qui résistent à l’analyse par le fait qu’ils sont empruntés à une langue étrangère : bifteck de veau (← beef-steak « grillade de bœuf ») ; five o’clock à toute heure, etc.
Après ce regard jeté sur la Brachysémie, ou brièveté sémantique, nous allons considérer la Brachylogie proprement dite, ou brièveté formelle, qui peut être obtenue à l’aide de deux procédés principaux : la représentation et l’ellipse.
B) Représentation
Au lieu d’énoncer les mots et les syntagmes tout au long de la chaîne parlée, l’esprit cherche sans cesse à les représenter à l’aide de signes plus brefs et plus maniables.
Le cas classique de la représentation est fourni par les pronoms. La grammaire traditionnelle désigne sous ce terme « un mot qui tient la place du nom » : Pierre est parti, mais il reviendra. M. Brunot a élargi d’une manière heureuse cette conception étymologique du pro-nom. « Le mot pronom, comme il a été employé, donne des idées fausses. On l’a appliqué à des mots qui remplacent tout autre chose que des noms. Ils représentent des adjectifs : belle, elle l’est ; le savant que vous êtes ; des verbes : allez-y, il le faut ; des idées entières : elle défit sa chevelure, et cela avec la simplicité d’une enfant ; je bois de l’eau, ce qui me réussit très bien. Il faudrait donc distinguer des pronoms, des proadjectifs, des proverbes, des prophrases. Pour éviter ces mots équivoques ou barbares, nous dirons représentants… » (PL 173).
Il convient d’ajouter que ces divisions établies d’après la catégorie du signe représenté — représentation du nom, de l’adjectif, du verbe, de la phrase, etc. — sont surtout formelles. Si au contraire on se place au point de vue du fonctionnement, la première constatation montre que la représentation peut mettre en jeu deux sortes de rapports fort différents quoique parallèles ; selon que le signe représenté 113se trouve logé dans la mémoire ou dans la chaîne parlée même, nous parlerons de représentation mémorielle ou de représentation discursive.
Or la représentation telle qu’elle est définie et exemplifiée par M. Brunot ne s’applique qu’aux rapports discursifs ; les représentants qu’il étudie sont des anaphoriques (annonces et reprises) : Pierre est arrivé, je l’ai vu ; Elle l’a manqué, son train.
Mais il est intéressant de constater d’autre part que les nominaux de M. Brunot ne sont pas autre chose qu’un cas de représentation mémorielle. « A côté des noms véritables, il y a des noms ou des expressions qui ont été généralement classées soit parmi les noms, soit parmi les pronoms, parce qu’on répugnait à changer le nombre des « parties du discours ». De toutes provenances, ces mots ne sont pas arrivés à avoir tous les mêmes caractères ; il est cependant nécessaire de les réunir, et il m’a paru que le nom d’expressions nominales ou de nominaux leur convenait assez bien, car, on le verra par la suite, ils se rapprochent des noms sans se confondre avec eux… » (PL 63). Exemples : moi, nous, lui ; quelqu’un, quelque chose, rien, tout, cela ; etc. etc.
M. Brunot a d’ailleurs signalé les fréquents échanges qui se produisent entre représentants et nominaux : « … La plupart des représentants peuvent devenir des nominaux. Une femme fait des reproches à son mari : Tu ne travailles pas, tu es toujours à causer avec celui-ci, avec celui-là, avec l’un, avec l’autre. » (PL 63-4). Cela revient à dire qu’un signe qui représente normalement un autre signe agencé dans la chaîne parlée, peut occasionnellement servir à représenter un signe logé dans la mémoire.
1) Représentation mémorielle
Il va sans dire que ce terme de nominal — parallèlement au pronom, qui ne représente pas exclusivement un nom mais peut remplacer tour à tour un adjectif, un verbe, une phrase, etc. — devra lui aussi être élargi.
Ainsi l’infinitif n’est pas autre chose que le représentant 114d’un verbe conjugué et par conséquent d’une proposition : Il est temps de partir (Z Il est temps que nous partions), Je veux mourir (Z *Je veux que je meure), v. De Boer, Revue de Lingu. romane, 3, 307.
Nous indiquons ci-dessous quelques types qui intéressent particulièrement le français avancé.
Les mêmes procédés de représentation s’appliquent aux temps. Bien que le passé simple ait disparu à peu près complètement de la langue parlée, les agences de presse et les journaux le conservent soigneusement, pour faire l’économie de la forme composée : Il débarqua (Z il a débarqué).
La langue moderne aime à abréger les relatives (Legrand, Stylistique française, 113-40, indique les procédés corrects qui permettent de se passer du relatif). « En vertu du moindre effort à faire, on abrège des locutions : une pièce mouvementée, pour : une pièce qui a du mouvement ; un style imagé, pour : un style qui a des images ; un événement sensationnel, pour : qui fait sensation. » (Vincent XXIV). Le sens actuel de conséquent (« important », ex. une ville conséquente, une affaire conséquente) s’explique par le fait que cet adjectif représente Une expression plus longue : de conséquence.116
Le participe présent de relation a pour fonction de représenter les relatives qui ont un autre sujet que l’antécédent : un café chantant (Z où l’on chante), un thé dansant (Z où l’on danse). Cf. un quartier commerçant, une rue passante, un parquet glissant, un sol roulant, W. C. payants, etc.
De telles phrases, est-il besoin de le dire, ne sont équivoques qu’à la réflexion ; leur rôle est de représenter des circonstancielles qu’il serait trop long d’énoncer explicitement. D’ailleurs, cette syntaxe rejoint celle en usage autrefois, telle qu’elle s’est conservée dans quelques proverbes : L’appétit vient en mangeant, La fortune vient en dormant.
Nous avons vu ailleurs comment le français avancé se débarrasse, s’il y a lieu, de certaines de ces équivoques (type : Passe le journal pour moi lire).
Mots par initiales. — L’usage d’abréger les syntagmes en les représentant par les initiales des mots qui les composent, est aujourd’hui très étendu, mais ces créations n’ont le plus souvent qu’un caractère local et éphémère : erpéiste (partisan de la Représentation Proportionnelle) ; le Bite (Bureau International du Travail), etc.
2) Représentation discursive
Par la représentation discursive, un signe plus court ou plus maniable reprend ou anticipe un autre signe qui figure dans la chaîne du discours : Pierre est parti, mais il reviendra, La maison de Jean est plus petite que celle de Pierre.
Au lieu de donner une étude complète de ces anaphoriques — il, elle, ça, le ou pop. y, dont, en, où, etc. — on se contentera de citer deux ou trois faits qui intéressent le français avancé.
Que sert correctement à reprendre certaines conjonctions 119dont la répétition ferait longueur : Si vous travaillez et que quelqu’un vient vous déranger ; Quand on travaille et que quelqu’un vient vous déranger ; Quand je me repose ou que je dors. Cet emploi si commode est étendu à d’autres conjonctions, où il passe pour incorrect : C’est pourquoi…, et que… (Martinon II 402 n).
La langue familière emploie si pour reprendre est-ce que : Est-ce que tu restes ou si tu pars ?
L’emploi de faire comme anaphorique du verbe est classique, mais on ne le tolère pas toujours. « Un des pires abus du verbe faire consiste à l’employer à la place d’un autre verbe » (Albalat, Comment il ne faut pas écrire, 49) : Je le reconnus mieux que je n’avais fait sa femme (A. Hermant). Dans la langue parlée d’aujourd’hui, cet usage se limite à l’emploi de faire avec le. Tandis que la langue écrite tolère un exemple du type : Le pire est que nous ne pouvons soupçonner Joubert d’aucune ironie, comme nous faisons notre bon maître Anatole France (A. Hermant : D’Harvé PM § 795 A), la langue parlée aurait comme nous le faisons de…
Cas limites. — Entre représentations mémorielle et discursive, il n’y a pas toujours de limite nette. Ainsi les prophrases qui servent de réponses (Oui, Non, Volontiers, etc.) supposent la combinaison d’un élément donné dans la question avec un autre élément logé dans la mémoire (affirmation, négation, acquiescement, etc.) : Est-ce que Pierre est rentré ? Oui (Z P. est rentré) ; Non (Z P. n’est pas rentré) ; Voulez-vous du thé ? Volontiers (Z J’en veux bien).
C) Ellipse
Au lieu de représenter l’élément dont on veut faire l’économie, on peut aussi le passer sous silence. C’est ce qu’on appelle communément l’ellipse.
Comme nous l’avons fait pour la représentation, nous distinguerons du point de vue du fonctionnement deux sortes d’ellipses : l’ellipse mémorielle et l’ellipse discursive.
L’ellipse mémorielle consiste à sous-entendre un élément qui doit être suppléé par la mémoire : un documentaire 120(Z un film documentaire), tandis que l’ellipse discursive est l’anticipation ou la reprise d’un élément donné dans le discours : illustrations dans et hors texte (Z dans texte) ; les pommes cueillies et les tombées (Z et les pommes tombées).
Terminologie. — La terminologie grammaticale n’est pas fixée. Tandis que M. Nyrop (V § 14 sv) appelle l’ellipse mémorielle ellipse proprement dite, M. Bally (Copule zéro) voudrait réserver le terme d’ellipse à la seule ellipse du discours. — Nous nous conformerons à l’usage le plus communément reçu en gardant le mot d’ellipse comme terme générique, pour désigner le phénomène dans son ensemble. On peut réserver le terme de sous-entente à l’ellipse mémorielle et celui d’haplologie (non répétition) à l’ellipse discursive.
1) Ellipse mémorielle
Selon que l’élément ellipse est grammatical ou seulement phonique, c.à.d. selon qu’il est porteur ou non d’une signification immédiate, nous parlerons de sous-entente ou d’amuissement. En principe, il n’y a pas de fossé entre ces deux procédés, qui se laissent rattacher au même besoin.
a) Sous-entente.
On distingue généralement la sous-entente du déterminé, celle du déterminant et celle du signe de rapport chargé de relier le déterminé et le déterminant. Il est difficile de dire dans chaque cas pourquoi c’est l’une ou l’autre de ces trois possibilités qui l’emporte ; tout au plus peut-on supposer à première vue que la sous-entente du déterminé (sujet, etc.) et celle du signe de rapport (verbe transitif, copule, préposition, conjonction) sont plus fréquentes que celle du déterminant. « Le langage est presque toujours très elliptique : ce qui est sous-entendu, ce n’est pas l’accessoire et l’accidentel [prédicat, déterminant], qui ne se laisseraient pas deviner ; mais ce qui est si essentiel qu’on ne manquera pas de le suppléer [sujet, déterminé, signe de rapport] ». (Goblot § 96).
La liste ci-après énumère les principaux cas de sous-entente que présente le français avancé.121
Sujet :
Regrette, n’ai plus. — Bien fâché, n’y pouvons rien. — Monsieur X ? Connais pas.
Les lettres populaires : Les jours sont durs et voudrais bien que…
Voudrais bien de tes nouvelles, suis toujours ici, te prie… Hier sommes allés… Aujourd’hui avons reçu… (= Prein).
Journaux intimes : Aujourd’hui dîné chez X… Rentré tard… etc.
Sujet impersonnel. : Là-bas faut que vous alliez. — Ya un bureau de poste à côté.
Substantif déterminé :
On vous le fournira fin (du mois) courant.
L’épreuve du kilomètre (avec départ) lancé.
Vente pour cas (de force) majeur(e), Départ pour cause d’occupation (par force) majeure (Vittoz 92).
Transit par (chemin de) fer entre la Suisse et les ports français.
Faubourg (Saint)-Antoine (B).
Chaussures extra en (cuir) double veau.
Subordonnante (sujet + signe de rapport) :
Vous avez volé ça : : J’ai volé ça ? (Vous prétendez que, Vous dites que…).
Où veux-tu aller ? : : Où je veux aller ? (Tu demandes où…).
Il est déjà venu ? : : S’il est déjà venu ? (Vous demandes si…).
Que si, Que oui, Que non (Je vous dis que…).
Dans leur maison, pas un seul tapis.
Quand il y a divergence, permis à chacun de faire à sa guise.
Tu iras à tel et tel endroit : : Entendu.
J’essayerai de le faire : : Trop tard maintenant.
Qui, quand, comment, où (c’est) ça ?
Subordonnante dans une circonstancielle :
Donc c’est entendu : si beau je viens, si pluie je reste.
Le cortège aura lieu pluie ou pas pluie.
Besoin ou pas besoin, je te défends de l’acheter.
Son œuvre, commencée alors que jeune étudiant.
Aussitôt que lavé et nourri à l’hôtel, il alla… (Nyrop V § 17).
Bien que déprimées, elles sourirent jusqu’à la fin (ib.).
J’ai acheté ce cheval, quoique un peu cher (ib.).
Celui qui aime les primitifs parce que primitifs (ib.).
Le commandant E., bon catholique, puisque zouave du pape, mais déplorable Français (ib.).
Nous espérons que ces indications vous faciliteront pour faire les recherches, c’est pourquoi aussitôt reçu nous nous empressons de vous les communiquer (APG).
Nous croyons, ainsi que ses camarades le disent, que malgré blessé, il aura pu être fait prisonnier (id.).
La neige fait son apparition sur les montagnes avoisinantes, et dès une couche suffisante, nous pourrons bientôt voir les nombreux fervents des « planches » s’adonner à leur sport favori (Godet c).122
Qui est, etc. :
Par divers renseignements recueillis, j’apprends que tous ceux morts sur le champ de bataille ont pu être enterrés (APG).
Cette revue dépassera en gaîté celle montée à pareille époque l’année dernière ; Ceux donnés par la nature (Joran n° 54).
Paul, (qui est de) retour de Pans, m’a annonce cette nouvelle (Vincent 152-3).
Que (+ régime) :
Tu veux je vienne ? Faut je m’en alle ? Il a dit i viendrait (viendra, veut venir). Je veux pas tous ces types i soyent toujours à me courir (B 142).
Il nous a dit comme blessure il avait reçu une balle dans le dos, traversé sa cartouchière et sorti par devant (APG).
Tu hécrira si tu veux au dépôt pour il manvoi un paquet de fait [= d’effets] de soldat (Prein 76).
Cf. Je languis (d’être) à l’année prochaine (Plud’hun 71).
Préposition d’inhérence (+ prédicatif) :
Une dissolution du Reichstag est considérée impossible par tous les milieux politiques ; M. C. considérerait excessive la réduction projetée du programme naval ; On le considère très habile (Martinon II 497).
Nos prix déjà connus excessivement bas ne seront rien à côté de… (réclame).
L’écueil à éviter, c’est que les personnages inventés par l’auteur n’apparaissent plutôt des représentations d’idées abstraites que des êtres bien vivants.
Préposition :
Le fils Dupont, la fille Durand (Joran n° 134).
Voyez caisse ! Voyez terrasse ! Voyez guichet 5 !
Mallette placage, doublure fantaisie, coloris mode, modèle luxe, cousu main, etc.
Œuf coque, œuf plat, fine Maison (B 167).
La partie texte, fer, maçonnerie, etc.
Le facteur temps, argent, etc.
La question approvisionnement, ravitaillement, etc.
Le trafic marchandises, le mouvement marchandises du PLM, les chiffres de la circulation voyageurs, etc.
Préposition composée > simple :
C’est en face la Sorbonne ; Continental Hôtel, face les Bains.
Le pavillon est placé hors la vue des promeneurs.
Au point de vue enseignement ; Placez-vous au point de vue relief ; Au point de vue formation de l’infanterie (Thérive NL 10. 4. 26).
Rapport à ces nuages-là, il va pleuvoir.
Jusque deux heures, Jusque maintenant, Jusque la Madeleine.
Crainte de vous nuire, qu’on ne vous nuise (Vincent 47-8).
Je vous l’apporte d’ici la semaine prochaine.
Cause départ ; Cause santé (annonces).
On vous le fournira courant avril.
C’est vis-à-vis l’église ; Vis-à-vis la porte de gauche.
Près le pont ; Près la porte Maillot.123
Déterminant :
Rompez ! (les rangs).
Allons, ouvre ! (la porte).
Aujourd’hui, tout le monde veut avoir sa voiture (automobile).
Le garçon n’annonce pas : un café, deux cafés, mais : Versez pour un, pour deux, etc. (B 167). — Versez, au premier !
La copie (ci-)incluse (Martinon II 477 n).
Un essuie(-mains) (B).
Avoir le dernier (mot).
A la première belle (occasion).
b) Amuissement.
Il n’y a pas de fossé véritable entre l’ellipse proprement grammaticale ou sous-entente, dans laquelle le signe passé sous silence est toujours accompagné d’une signification distincte, et l’ellipse phonique ou amuissement. Par ce dernier terme, nous désignons tous les cas d’ellipse mémorielle qui intéressent le signe — phonèmes, syllabes, groupes de syllabes — à l’exclusion de la signification.
2) Ellipse discursive (haplologie)
Pris dans un sens plus large, le terme d’haplologie peut aisément servir à désigner l’ellipse discursive en général, c.à.d. toute non-répétition (h. progressive) ou non-anticipation (h. régressive), en contact ou à distance, sous une forme identique ou approchante, d’un simple phonème, d’une syllabe ou d’un mot.
Cette extension du terme d’haplologie est conforme aux faits. Livrées à elles-mêmes, les langues manifestent une répulsion plus ou moins vive pour la répétition fortuite des phonèmes, des syllabes et des mots ; et cette répulsion est un des cas où l’instinct collectif semble d’accord avec la grammaire impérative : tous les écoliers de France et de Navarre connaissent la règle qui interdit les répétitions de mots. 128Seulement, la tendance spontanée porte sur les phonèmes isolés et les syllabes autant que sur les mots entiers, et en contact comme à distance.
Après avoir énuméré quelques variétés d’haplologie verbale et d’haplologie syllabique, il nous reste à examiner l’haplologie phonique. Entre cette dernière et les autres, il n’y a qu’une question de degré : Qu’est-ce que c’est que ça ? > kèksèksa. > kèsèsa ; Qu’est-ce que ça fait ? > kèksafè > kèsafè.
La même réluctance pour la répétition fortuite explique la suppression d’un grand nombre de liaisons : Un attenta(t) affreux, po(t) à tabac, to(t) ou tard, aussitô(t) après, bientô(t) après, est-ce que vous ire(z) aux eaux, etc. etc. On voit donc que l’haplologie va jusqu’à l’emporter sur la tendance, si forte par ailleurs, à réduire l’hiatus.
La question de l’e muet intervient également ici. On sait le sort que réserve à cet ə le français avancé ; la langue correcte même n’admet pas sa répétition dans une suite de deux ou plusieurs syllabes, et la « loi des trois consonnes » pourrait s’appeler tout aussi bien la « loi des deux voyelles ». 129Exemples : *ça nə mə fait rien, *veux-tu tə ləver, *on sə dəmande, *il restə dəbout, *tu mə rəssembles, *vous rədəvənez jeune, *on mə lə donne, *si jə lə savais. — A plus forte raison, la répétition multipliée de la même voyelle entraîne une bouillie imprononçable : *jə nə mə lə rappelle pas (d’où : je ne m’en rappelle pas), *jə nə tə lə rəfuse pas (d’où pop. je t’y refuse pas), *jə nə tə lə rədəmanderai pas, etc.
Cette tendance brachylogique est si forte qu’elle s’étend même aux cas où il n’y a pas répétition d’un e muet : atlier, dmain, rnoncer (Plud’hun 16), amner, enlver ; lmarchand n’avait pas ça ; du 60 à l’heure qu’i f’saient !
Ce point de phonologie est très important ; le parler populaire amène ainsi le français à connaître des consonnes à fonction vocalique (r l m n voyelles) telles qu’en possède l’allemand et telles qu’elles existaient probablement en indoeuropéen. Le français y avait répugné jusqu’à présent.
Les abréviations sémantiques et formelles étudiées dans ce chapitre montrent que si le français était, sur ce point, livré à lui-même, il ne tarderait pas à devenir une langue monosyllabisante ou monosyllabique du type de l’anglais ou du chinois, avec tous les avantages et inconvénients qui s’y rattachent. Nous avons signalé les multiples dangers d’homophonie qui résultent de la marche vers le monosyllabisme, et nous renvoyons à la loi que nous avions formulée : la différenciation est fonction de la brièveté.130
Chapitre IV Le besoin d’invariabilité
Bally LV 205 sv ; Bull. Soc. Lingu., 23, 119 n.
Bergson, Evolution créatrice, 171 sv.
Nyrop III § 638 sv. (Dérivation impropre).
Sechehaye, Structure logique de la phrase, 102 sv.
Langues où l’invariabilité du signe est particulièrement avancée : l’anglais, et surtout le chinois.
C’est un philosophe, M. Bergson, qui a le mieux aperçu le principe qui constitue le trait essentiel du langage humain, la mobilité du signe :
« Les sociétés d’insectes ont sans doute un langage, et ce langage doit être adapté, comme celui de l’homme, aux nécessités de la vie en commun. Il fait qu’une action commune devient possible. Mais ces nécessités de l’action commune ne sont pas du tout les mêmes pour une fourmilière et pour une société humaine. Dans les sociétés d’insectes, il y a généralement polymorphisme, la division du travail est naturelle, et chaque individu est rivé par sa structure à la fonction qu’il accomplit. En tout cas, ces sociétés reposent sur l’instinct, et par conséquent sur certaines actions ou fabrications qui sont plus ou moins liées à la forme des organes. Si donc les fourmis, par exemple, ont un langage, les signes qui composent ce langage doivent être en nombre bien déterminé, et chacun d’eux rester invariablement attaché, une fois l’espèce constituée, à un certain objet ou à une certaine opération. Le signe est adhérent à la chose signifiée. Au contraire, dans une société humaine, la fabrication et l’action sont de forme variable, et, de plus, chaque individu doit apprendre son rôle, 131n’y étant pas prédestiné par sa structure. Il faut donc un langage qui permette, à tout instant, de passer de ce qu’on sait à ce qu’on ignore. Il faut un langage dont les signes — qui ne peuvent pas être en nombre infini — soient extensibles à une infinité de choses. Cette tendance du signe à se transporter d’un objet à un autre est caractéristique du langage humain. On l’observe chez le petit [172] enfant, du jour où il commence à parler. Tout de suite, et naturellement, il étend le sens des mots qu’il apprend, profitant du rapprochement le plus accidentel ou de la plus lointaine analogie pour détacher et transporter ailleurs le signe qu’on avait attaché devant lui à un objet […]. Ce qui caractérise les signes du langage humain, ce n’est pas tant leur généralité que leur mobilité. Le signe instinctif est un signe adhérent, le signe intelligent est un signe mobile. » (Evolution créatrice, 171-2).
Le même problème peut être posé en d’autres termes. L’opposition bergsonienne du signe adhérent et du signe mobile correspond à l’opposition faite par F. de Saussure entre le symbole et le signe arbitraire (CLG 103) : Le symbole a pour caractère de n’être jamais tout à fait arbitraire ; il y a un rudiment de lien naturel entre le signe et la signification. Autrement dit, le signe adhère à la signification. Le symbole de la justice, la balance, ne pourrait pas être remplacé par n’importe quoi, un char par exemple. — Le signe arbitraire, au contraire, est immotivé, c.à.d. que rien ne le rattache naturellement à la signification (= signe mobile).
Il est aisé de voir pourquoi le signe linguistique est mobile. Logiquement, il faudrait qu’à chaque signe corresponde 1 signification. C’est là le point de vue du signe adhérent ou du symbole, et c’est bien à peu près ce que l’on constate dans les langues dites primitives, qui consacrent un signe spécial à chaque signification particulière mais n’ont pas de termes pour rendre les idées abstraites. Il en résulte une multiplication des signes à l’infini, et un effort de mémoire inouï. Le besoin d’économie pousse le langage à remplacer la multiplicité des signes particuliers par des signes mobiles pouvant traduire tour à tour un grand nombre de significations distinctes. Cette généralisation ne s’arrête pas au signe générique (ex. arbre, maison, véhicule, colis, etc.) ; elle va jusqu’au signe catégoriel (signes désignant le concept de chose, d’être, de qualité, d’action, etc.).132
Dans le camp des logiciens et des psychologues aussi bien que dans celui des linguistes, on a abandonné de plus en plus la croyance au parallélisme psycho-linguistique, pour reconnaître l’alogisme des catégories grammaticales. Les « parties du discours » sont loin d’être un simple décalque des catégories de la pensée ; les correspondances établies entre le Substantif et la « substance », l’Adjectif et la « qualité », l’Adverbe et la « manière », le Verbe et le « procès », la Préposition et la « relation », etc., ne conviennent que trop souvent aux manuels de grammaire et de logique à l’ancienne mode. Un substantif, par exemple, n’est pas rivé à la notion de « substance », il peut supporter une idée de « qualité » (ex. la beauté) ou de procès (la venue) ; un adjectif peut contenir une idée de « substance » (la production livresque de l’Allemagne), un verbe une idée de « qualité » (rougir), etc.
Dès qu’on pénètre dans la réalité du langage vivant pour observer sur le vif le déroulement des phrases dans la parole, on voit bien vite combien est risquée la tentative d’établir un parallélisme rigide entre les cadres de la pensée et les moules de la grammaire. Le besoin de disposer de signes mobiles et maniables tend au contraire à permettre qu’une seule et même catégorie grammaticale supporte tour à tour des valeurs et catégories de pensée différentes.
Le problème de la traduction, dont la théorie pourrait tenir en quelques lignes, montre très bien la différence entre les deux ordres de faits. La traduction « littérale » .consiste à traduire à l’aide des mêmes catégories grammaticales, mais aux dépens de l’identité sémantique ; exemple : zuletzt ging sie nach Hause zurück > finalement elle retourna chez elle. La traduction « libre » cherche à obtenir l’identité sémantique aux dépens de l’identité des catégories grammaticales : elle finit par retourner chez elle.
La croyance au parallélisme psycho-linguistique donne lieu à des erreurs fréquentes ; parce que des signes sont identiques de forme, on croit qu’ils appartiennent nécessairement à la même catégorie. Le mélange du substantif et de l’adjectif en une catégorie unique est un exemple de cette erreur : « Substantifs et adjectifs échangent leurs rôles dans toutes 133les langues ; grammaticalement il n’y a pas entre eux de limite tranchée. On peut les réunir tous deux dans une catégorie unique : celle du nom. » (Vendryes, Langage, 138). Ou bien, parce que dans une langue le pronom possessif est interchangeable avec le pronom personnel (ex. ma venue = je viens), on appellera cette langue une langue à « conjugaison possessive » ; parce que dans une langue le nom est interchangeable avec le verbe (jap. la neige tombe = la chute de la neigé), on appellera cette langue une langue à « conjugaison nominale », etc. etc. Autrement dit, on déduit faussement de l’identité des signes celle des significations, sans se douter que le besoin d’économie n’efface les différences formelles superflues qu’en gardant strictement la différence des fonctions.
Historique. — Le parallélisme psycho-linguistique est soutenu par le logicien Keynes et par l’école de linguistes qui va de Humboldt et Steinthal jusqu’à Wundt et Cassirer. Ont réagi : chez les logiciens, Goblot (§ 96 et passim) ; chez les linguistes : H. Paul, Marty, Jespersen, et l’école de Saussure. Cf. 0. Funke, Studien zur Geschichte der Sprachphilosopie, Bern 1928.
Cette mobilité du signe dépend non seulement de l’arbitraire du signe par rapport à la signification, mais bien plus encore de celui de la signification, c.à.d. de la pensée, par rapport à la réalité pensée. De même que le langage n’est pas un simple décalque de la pensée, notre pensée, elle non plus, n’est pas un simple décalque du donné, c.à.d. des perceptions qui nous viennent du monde extérieur et de nos sensations du monde subjectif (v. Bally LV 148-9 ; Contrainte sociale : Revue Intern. de Soc, 35, 218 sv).
Il est aisé aussi de voir pourquoi la pensée est mobile par rapport à la réalité pensée. Les faits que nous percevons et sentons ne sont toujours que singuliers, individuels, détaillés. Pour les « penser », le besoin d’économie nous pousse à simplifier la multiplicité du perçu, à la classer en un certain nombre de groupes et de sous-groupes. La pensée élabore la variété formidable du donné en y substituant des représentations 134génériques : le concept est une signification générique, c.à.d. une signification interchangeable d’une signification particulière à une autre (le concept « maison », par exemple, peut se substituer à tour de rôle à un nombre énorme de perceptions de maisons singulières, aucune n’étant identique à l’autre ; v. Sapir, Language, II-2).
Le passage de la réalité au langage suppose donc un double décalage, entre la réalité et la pensée d’abord, ensuite entre la pensée et le langage. De ces deux arbitraires, seul le second intéresse directement la linguistique, le premier ressortit à la psychologie.
Nous insistons sur ce dernier point, parce qu’on a cherché à transporter dans le domaine du langage des distinctions qui n’appartiennent ni à la langue ni à la pensée. Ainsi celle proposée par Brentano et Marty entre les prédicats (et les déterminants) qui enrichissent leur sujet (leur déterminé) et ceux qui le modifient (v. Brentano, Psychologie, II 62 n) ; ex. Pierre est savant (enrichissement du sujet) / Pierre est mort (modification du sujet). La pensée et le langage sont indifférents à cette distinction, qui n’appartient qu’à la réalité. « Quand nous disons l’enfant devient homme, gardons-nous de trop approfondir le sens littéral de l’expression. Nous trouverions que, lorsque nous posons le sujet enfant, l’attribut homme ne lui convient pas encore, et que, lorsque nous énonçons l’attribut homme, il ne s’applique déjà plus au sujet enfant. La réalité, qui est la « transition » de l’enfance à l’âge mûr, nous a glissé entre les doigts […] La vérité est que, si le langage [et la pensée] se moulait ici sur le réel, nous ne dirions pas l’enfant devient homme, mais il y a devenir de l’enfant à l’homme. Dans la première proposition, devient est un verbe à sens indéterminé, destiné à masquer l’absurdité où l’on tombe en attribuant l’état homme au sujet enfant. » (Bergson, Evolution créatrice, 338).
Comme nous l’avons indiqué plus haut, le besoin d’économie pousse le langage et la pensée à escamoter tout détaillage superflu, toute distinction qui n’est pas nécessaire à la compréhension. Même pour le professeur qui enseigne dans ses livres et de sa chaire que la terre tourne autour du soleil, 135il est plus commode dans la vie quotidienne de dire et de penser « le soleil se lève, le soleil se couche », etc.
Le défaut de correspondance, dû à la mobilité du signe, entre catégories grammaticales et catégories de pensée a conduit quelques savants à une conclusion que l’on pourrait appeler défaitiste. Puisque les catégories grammaticales ont un caractère aussi nettement trompeur, à quoi bon les étudier et pourquoi ne pas les laisser en dehors même de la recherche scientifique ? « Après épreuve, après des années passées à chercher la solution du problème, j’ai été amené à penser qu’aucune retouche à l’ancien plan ne pouvait suffire, qu’aucun reclassement des phénomènes grammaticaux ne saurait échapper aux défauts inhérents à la classification d’Aristote. Les parties du discours ont fait leur temps. C’est une scolastique qui doit à son tour disparaître. » (Brunot, Revue universitaire, 29, 166 ; v. dans le même sens, Sapir, Language, 125).
Il n’en est pas moins vrai que les catégories grammaticales, loin d’être une invention d’Aristote, sont réellement conçues comme telles par les sujets parlants, en vertu des rapports de forme et de fonction qui servent à classer les signes entre eux dans la mémoire et dans le discours.
La sociologie livre ici un parallèle frappant. Le cas du linguiste qui voudrait étudier le langage sans tenir compte des institutions grammaticales ressemble à celui du sociologue qui ferait fi des institutions de la société — Etat, Administration, Parlement, Partis, Armée, Droit, Mariage, Eglise, etc. etc. — sous prétexte que ce sont là des cadres imparfaits et trompeurs (ce qu’ils sont en effet).
Or cette mobilité du signe, cette faculté de pouvoir être transposé d’une valeur sémantique ou d’une catégorie grammaticale à l’autre, au lieu de faire le désespoir du linguiste, sont précisément ce qui devrait l’intéresser le plus. « Si la langue fait passer si aisément les signes d’une catégorie dans une autre, c’est par un ensemble de procédés transpositifs qu’elle met au service de la parole, et qui prouvent par contrecoup la réalité des catégories entre lesquelles se fait le passage. 136Mais la transposition n’a jamais été l’objet d’une étude méthodique [v. aujourd’hui Sechehaye, Structure logique de la phrase, 102 sv] ; elle plonge pourtant très avant dans le mécanisme de la langue, et souvent la manière dont un idiome opère ces échanges fonctionnels suffit à le caractériser. » (Bally, Bull. Soc. Lingu., 23, 119 n).
L’arbitraire du signe, et la mobilité qu’il permet, étant admis en principe, il faut bien reconnaître qu’en pratique cette mobilité est chose toute relative. La faculté de transposer un signe d’une valeur sémantique ou d’une catégorie grammaticale à l’autre peut être plus ou moins aisée ou difficile selon le degré d’invariabilité du signe
La variabilité du signe apparaît sous des formes très diverses. La variation peut être régulière ; ainsi le radical des verbes de la 2e conjugaison est variable, mais il se modifie en vertu d’une alternance régulière qui vaut pour l’ensemble des verbes de cette conjugaison (je fini-s / nous finiss-ons, etc.). La variation peut être partiellement ou totalement irrégulière ; dans ce dernier cas, on parlera de supplétion (ex. je vais, tu vas, nous all-ons, j’i-rai). La séquence peut être également variable ou invariable ; le dérivé compte-rendu jure avec le verbe composé dont il est tiré (rendre compte).
Le même problème peut se poser sur le plan du discours. Les diverses significations n’ont pas toujours une expression distincte, mais peuvent être exprimées cumulativement, pléonastiquement ou discontinûment. Leur, du, au, dont, etc., sont des signes mixtes cumulant deux ou plusieurs fonctions (leur « à eux », du « de le », au « à le », dont « que de lui », etc.), l’accord oblige au contraire à exprimer plusieurs fois ce qui n’est pensé qu’une fois (belle petite chatte blanche), et la discontinuité détruit la succession logique des éléments : les langues slaves de civilisation.
Le fait que le signe est obligé, en vertu des rapports qui le lient à d’autres signes logés dans la mémoire ou dans le discours, de changer constamment de forme, nécessite de la part des sujets parlants et entendants un effort supplémentaire 137de mémoire et d’attention. Le besoin d’invariabilité, un des plus impérieux du langage, tend à toujours conserver à un signe, en dépit des rapports mémoriels et discursifs qu’il soutient avec le reste du système, la même forme afin d’alléger autant que possible l’effort de mémoire et d’attention à fournir. Le moindre effort de mémoire est la raison d’être du signe mobile et invariable.
La marche des langues de grande communication vers l’invariabilité de plus en plus forte des pièces du système a été soulignée par divers auteurs. M. Bally a signalé et esquissé le problème en se plaçant au point de vue de la transposition, et a consacré quelques pages à montrer « l’interchangeabilité toujours plus aisée des fonctions avec un minimum de changement des signes ; les mots, parties de mots, membres de phrases et phrases entières qui sont appelés à d’autres fonctions que celle qui leur est habituelle, assument leur nouveau rôle sans modifier leur forme, ou en la modifiant très peu. Le phénomène se vérifie, par exemple, lorsqu’un verbe peut être indifféremment transitif ou intransitif (cf. anglais he stops a watch et the watch stops), quand un verbe devient, dans les mêmes conditions, un substantif (to stop, a stop) ou un élément de composé (a stop watch). Il suffit de comparer des passages semblables en grec et en latin pour voir que dans ces langues la transposition est fortement caractérisée, et par conséquent plus difficile (grec γαμέο « épouser » et γαμίζω « faire épouser », ἵππος, τρέφω et ἱπποτρόφος « qui nourrit des chevaux », etc.). Même constatation dans le régime de la phrase : c’est par des modifications toujours plus légères qu’une proposition indépendante peut devenir terme d’une phrase, ou phrase subordonnée (cf. d’une part latin erras et puto te errare, d’autre part anglais You are wrong et I think you are wrong). » (Bally LV 205-6).
Nous étudierons dans ce chapitre comment le besoin d’invariabilité, en réduisant les modifications formelles à un minimum, cherche à rendre la transposition linguistique 138aussi aisée que possible. Nous distinguerons trois types de transposition : la transposition sémantique, la transposition syntagmatique et la transposition phonique.
La transposition sémantique est le passage d’une valeur sémantique à l’autre. Par exemple, le passage d’une personne à l’autre (je/tu/il ; moi/toi/lui) est une transposition sémantique ; de même, le passage d’un nombre à l’autre (je/nous ; tu/vous ; il/ils).
La transposition syntagmatique est le passage d’une catégorie syntagmatique à l’autre. Par exemple, le passage du sujet à l’objet (je/me ; tu/le ; il/le ; ils/les) est une transposition syntagmatique ; de même, le passage de la syntagmatique libre (syntaxe) à la syntagmatique plus ou moins condensée (morphologie), par exemple la transformation d’un prédicat en un déterminant (la maison est à moi > ma maison) ou celle d’une phrase en un substantif abstrait (la rosé est belle > la beauté de la rosé), et ainsi de suite.
La transposition phonique est le passage d’une sous-unité à une unité, et inversement. Ainsi je et moi, tu et toi, il et lui, ils et eux, ne sont pas interchangeables ; nous, vous, elle, au contraire sont invariables à ce point de vue : ils peuvent fonctionner tantôt comme sous-unités (nous-allons, vous-allez, elles-vont) tantôt comme unités (nous, nous-allons ; vous, vous-allez ; elles, elles-vont).
Nous étudierons donc successivement : les transpositions sémantiques, abstraction faite de toute transposition syntagmatique ou phonique ; les transpositions syntagmatiques, abstraction faite de toute transposition sémantique ou phonique ; les transpositions phoniques, abstraction faite de toute transposition sémantique ou syntagmatique — en examinant chaque fois comment le besoin d’invariabilité cherche à rendre le passage aussi aisé que possible.
A) Transposition sémantique
La langue familière et la langue populaire aiment à se servir d’expressions vagues, dès que la compréhension n’exige pas de termes plus précis ; elles se dispensent de marquer par des termes spéciaux toutes les différences de signification. Il 139suffit, pour se rendre compte de ce fait, de comparer le vocabulaire journalier avec la terminologie technique et scientifique. Les langues spéciales tendent à restreindre l’extension sémantique des signes qu’elles emploient, les langues de grande communication tendent à la généraliser. Cette généralisation du signe comporte diverses variétés, telles que le signe générique, le signe indifférent, la figure effacée, la fausse figure.
Le signe générique — appelé aussi signe passe-partout ou signe à tout faire, par exemple homme, chose, faire, etc. — est un signe interchangeable d’une signification particulière à l’autre à l’intérieur d’une catégorie grammaticale donnée. Un mot comme véhicule peut fonctionner tour à tour à la place de char, voiture, camion, roulotte, auto, wagon, etc. ; le colis désignera selon l’occurence un paquet, une caisse, un panier, une valise, un ballot, et ainsi de suite. Parallèlement, dans le domaine du verbe la copule (par exemple être, avoir, devenir, faire) n’est pas autre chose qu’un verbe transitif générique.
Les grammairiens qui opèrent avec des jugements de valeur appellent le signe générique un terme « vague » et parlent de « confusions », d’« ignorance », etc. Comme nous l’avons signalé dans l’Introduction déjà pour la notion de l’oubli, le vague, la confusion et l’ignorance peuvent avoir leur raison d’être ; elles servent inconsciemment le besoin d’invariabilité. La fonction économique du signe générique est évidente : il dispense la mémoire de retenir une foule de signes particuliers dont l’emploi serait superflu, et forme ainsi la contre-partie, dans le domaine des associations de mémoire, de ce que nous avons appelé la brièveté sémantique.
Les signes indifférents (dans le jargon : voces mediæ) réalisent l’interchangeabilité des contraires, en permettant de faire l’économie des antonymes. Ainsi sentir est un verbe indifférent, parce qu’il permet de marquer aussi bien un procès qui part du sujet qu’un procès qui va vers lui : Tu sens comme ça sent ? Beaucoup de mots peuvent être pris indifféremment en bonne ou en mauvaise part (fr. av. grâce à cet échec, commettre un acte héroïque, jouir d’une mauvaise réputation, risquer de réussir, etc.) ; v. Nyrop, IV § 199 sv.140
La transposition sémantique ne doit pas être confondue avec la figure. Cette dernière, dont il sera reparlé, est un procédé expressif obtenu par l’association voulue de deux valeurs, la valeur première (ou sens propre) et la dérivée (ou sens figuré) ; la transposition sémantique pure postule au contraire l’oubli ou le refoulement du sens premier. Commettre des vers est une figure plaisante, dont l’expressivité repose sur le rappel de la valeur proprement péjorative du verbe commettre (commettre un crime, un pécher) ; commettre un acte héroïque est une simple transposition, rendue possible par l’oubli du sens premier.
On voit bien par là comment le point de vue descriptif (statique ou historique) et le point de vue fonctionnel diffèrent. Le premier se contente de signaler des « extensions de sens » et les conditions où elles se produisent. Le second va plus loin ; il considère ces extensions sémantiques comme des procédés dont il s’agit de rechercher la ou les fonctions. La transposition sémantique a pour fonction de faciliter l’effort de mémoire à fournir ; la figure, de satisfaire le besoin d’expressivité.
Cette distinction établie, il faut avouer qu’en pratique il peut être difficile de savoir si l’on se trouve en présence d’une transposition pure ou d’une figure. Il importe cependant de bien les délimiter, au moins en théorie.
Et d’abord, au point de vue évolutif, il y a souvent passage de l’une à l’autre, dans ce sens qu’une figure qui a commencé par répondre au besoin d’expressivité peut s’effacer, changer de fonction et verser finalement dans le domaine de la simple transposition. Le cas est banal ; il n’est plus question de métaphore, quand on parle du pied d’une table, ou d’une feuille de papier.
Les valeurs sémantiques que le langage est appelé à exprimer se classent en un certain nombre de catégories fondamentales dont la liste est difficile à dresser. Le lecteur ne trouvera pas, dans les rubriques rangées ci-après, une Table des Valeurs complète et détaillée. On se contentera de quelques points de vue, d’après les matériaux qu’offre le français avancé.
1) La substance et ses déterminations
Un substantif peut accroître ainsi le nombre de ses emplois jusqu’à devenir un signe générique. « J’écoute parfois une jeune personne qui gagne sa vie en cousant. Tout en cousant, elle parle, mais elle n’invente pas de mots ; au contraire, elle les supprime presque tous. Un seul vocable lui suffit à désigner cent objets. Elle dit : chose, machin, truc, et 142ces mots représentent presque toute la nature, telle du moins qu’elle l’aperçoit de ses yeux… Un jour, quelqu’un lui riposta : Mais quelle chose, quel machin, quel truc ? — Eh bien quoi ! dit la midinette agacée, vous ne comprenez donc pas le français ? Et cette jeune fille prenait sincèrement en pitié l’interlocuteur qui avait besoin d’un mot pour désigner chaque chose et chaque machin. » (J. Lefranc, Tribune de Genève, 28. 9. 26). D’autres mots, comme fourbi, bricole, etc., remplissent la même fonction.
On remarquera que les pronoms sont tous des signes génériques ; leur fonction est non seulement de remplacer un signe long par un signe plus court (économie discursive), mais encore de pouvoir se substituer à n’importe quel signe à l’intérieur d’une catégorie donnée (économie mémorielle). Dans bien des cas d’ailleurs, le signe générique fonctionne comme pronom ; ainsi ce qui est remplacé par chose qui : II n’a pas réussi, chose qui m’étonne beaucoup.
Il est intéressant d’examiner comment le français avancé cherche à supprimer les barrières formelles qui séparent les déterminations inhérentes à la substance.
La différenciation des êtres animés et des choses inanimées, qui a joué un grand rôle dans le passé des langues indoeuropéennes, semble perdre de son importance peu à peu. Le neutre, signe de l’inanimé (opposé à l’animé : masculin ou féminin), a disparu des langues les plus évoluées ; le français ne le conserve guère qu’à l’état de survivance (cf. pis, opposé à pire ; ceci et cela, opposés à celui-ci/celui-là et celle-ci/celle-là ; quoi, opposé à qui ; quelque chose opposé à quelqu’un, etc.).
Dans la langue familière, le générique chose est employé comme nominal pour désigner une personne déterminée, et s’oppose donc à quelqu’un : C’est Chose qui a sonné.
Le genre masculin ou féminin, en tant que répondant à une différence de sexe, est trop important pour être escamoté. Même les langues qui n’ont ni masculin ni féminin, comme le chinois et le japonais, et celles qui ont perdu le genre, comme l’anglais, disposent de procédés spéciaux pour marquer la différence. Le français actuel, il est vrai, présente des cas où la différence de genre est supprimée par nécessité — un professeur, un écrivain, un maître de conférences, un docteur, un auteur, etc. en parlant de femmes — mais ces exemples constituent plutôt une gêne.
La différence entre les trois personnes (je, tu, lui) n’est pas marquée formellement par toutes les langues ; le chinois et le japonais notamment, sauf en cas d’emphase, laissent toujours à la situation ou au contexte le soin de déterminer la personne. Les langues indo-européennes n’en sont pas encore là ; on y remarque toutefois la tendance à se passer de l’expression précise de la personne lorsqu’elle est superflue.
En français, on « remplace très fréquemment tous les autres pronoms, même dans la langue parlée. C’est ainsi qu’on dit volontiers on pensera à vous pour je penserai à vous, qu’on s’en aille pour va-t-en ou allez-vous-en, on m’a vu pour il ou elle m’a vu ou ils ou elles m’ont vu, où va-t-on pour allons-nous, etc. » (Martinon II 258). Le grammairien hollandais 146Robert (104-15) a réuni une riche collection d’exemples de cette tendance de on à servir de pronom personnel mobile.
Le grand avantage de ce on mobile est de réaliser, outre l’interchangeabilité des personnes, celle des genres et des nombres. Il remplit d’autres fonctions encore ; il évite par exemple la répétition fortuite des mêmes syllabes : nous, nous nous amusons > nous on s’amuse. Et surtout, il permet de faire l’économie de la terminaison verbale : nous nous amusons > on s’amuse.
Les formes du singulier sont plus rares, mais elles existent : Je s‘arrête, je s‘en fous, tu se feras bousiller (B III-2), Je s‘ai trompé, tu s‘en vas, je se fous de tout ça (B 133).
On peut ramener au même besoin la tendance à invariabiliser le pronom possessif (il leur est défendu de donner de ses nouvelles : APG), ainsi que le possessif nominalisé (c’est une bien grande peine pour nous d’être sans nouvelles des siens : id.).
2) Espace et temps
Il arrive souvent qu’un même signe puisse s’appliquer tour à tour à une notion d’espace ou de temps.
Une préposition spatiale, par exemple, est étendue au temps : aux environs de Pâques, de 8 heures ; d’ici là « jusqu’alors » ; je vois ça d’ici « d’avance », etc.
Ce classement est général et abstrait ; nous n’indiquons ci-dessous que quelques-uns des faits qui s’y rapportent.
Le français est très pauvre en matière de démonstratifs, et les traducteurs sont obligés de rendre indirectement des nuances comme hic, iste, ille, is. Il ne connaît plus que deux séries, la série en -i (ici, voici, ceci, celui-ci, cette maison-ci) et celle en -à (là, voilà, cela, celui-là, cette maison-là). Le français avancé semble devoir éliminer peu à peu la série 148en -i, mais sans pour cela abandonner la différence, qui est exprimée dès lors par la situation (gestes, etc.) ou le contexte : Laquelle vous voulez ? celle-là ou celle-là ? Cf. Voilà ce que j’avais à vous dire, Voilà ce que j’ai à vous dire. Ici tend à se faire remplacer par là, et là (sens premier) par là-bas (ici/là > là/là-bas).
Dans l’histoire des langues, les signes qui marquent le lieu (verbes locatifs, prépositions locatives) et ceux qui marquent le mouvement (verbes directifs, prépositions directives) s’échangent fréquemment. En général, c’est le sens locatif qui est étendu au directif.
3) Quantité et qualité
La distinction formelle du singulier et du pluriel n’appartient pas à toutes les langues ; beaucoup — par exemple le chinois et le japonais — s’en passent aisément, laissant à la situation ou au contexte le soin de déterminer la différence.150
La différence traditionnelle que fait la langue entre objets « comptables » (ex. 30 personnes) ou non (ex. un certain nombre de gens) se trouve quelquefois effacée formellement : Il faut avoir pitié des personnes, Il ne faut pas médire des personnes (Martinon II 20).
De même, la différence entre le singulier et le collectif n’est pas toujours rendue formellement : Manger un raisin (« une grappe ») ; Quand la feuille vient, quand vous voyez la feuille (« le feuillage, la verdure »).
Même échange entre la manière, ou qualité d’un procès, et le temps : Les tombes trop vite creusées de nos soldats (Godet XIII), Je suis venu trop vite (id. XIV), Elle s’est mariée trop vite (ib.).151
Enfin, les diverses catégories de la qualité sont échangeables, dans ce sens qu’un signe qui s’applique à tel ou tel aspect de la qualité est étendu à d’autres cas : Un enfant plus vieux qu’un autre (Martinon II 585) ; Elle est petite « mince » (B) ; et ainsi de suite.
4) Transitivité : inhérence et relation
L’inhérence est un rapport de transitivité intrinsèque, par exemple entre une substance et sa qualité (une rosé jolie), un procès et sa manière (il chante joliment), une substance et une substance dans l’état (Pierre est avocat) ou dans le temps (l’enfant devient homme). La relation est un rapport de transitivité extrinsèque entre deux substances, qui sont conçues par conséquent comme extérieures l’une à l’autre : Pierre frappe Paul, la maison du jardinier, etc. Cf. Sechehaye, Structure logique de la phrase, 54 sv, 66 sv.
L’inhérence et la relation, qui sont des catégories sémantiques, ne doivent pas être confondues avec les procédés grammaticaux de l’accord et de la rection, bien que dans un très grand nombre de cas ces deux couples soient synonymes. Dans le tour une boucherie chevaline, l’adjectif est accordé (procédé grammatical), mais le rapport sémantique est un rapport de relation (boucherie où l’on vend du cheval).
Il va sans dire que, comme la transposition peut se déployer dans plusieurs directions, ce qui est invariabilité dans un sens peut être variabilité dans l’autre. Ainsi la transposition sémantique d’un adjectif d’inhérence en un adjectif de relation peut être un déficit pour la transposition syntagmatique : il devient d’autant plus difficile de passer de la syntagmatique libre (syntaxe) à la syntagmatique condensée (il est prisonnier en Allemagne / prisonnier allemand).
Un autre cas d’interchangeabilité entre inhérence et relation est constitué par le passage de la préposition d’inhérence comme dans le domaine de la relation : Cet article est mauvais comme style ; Je vais bien comme santé et comme position (Martinon II 497 n).
5) Corrélation
La relation, qui est le rapport entre deux substances conçues comme extérieures l’une à l’autre, ne doit pas être confondue avec la corrélation. Cette dernière se développe 153toujours, directement ou indirectement, entre deux jugements.
Les rapports entre jugements peuvent être très variés. Des idées comme parce que, puisque, pour que, au point que, etc., trouvent leur expression dans la plupart des langues, et là encore le besoin d’invariabilité cherchera à rendre ces rapports à l’aide de procédés aussi simples que possible. Un même terme, par exemple, servira à l’expression de la causalité et de la finalité (J’espère que vos recherches ont eu un but « un résultat » : APG), et ainsi de suite.
Plus généralement la langue parlée, dans tous les idiomes, tend à exprimer la corrélation par la juxtaposition pure et simple des phrases, laissant au contexte et à la situation 154(gestes, mimique) le soin de faire les distinctions utiles : Il est venu (,) j’étais malade ; Je parlais (,) il n’avait pas fini ; Dépêche-toi (,) ça presse ; Elle est vilaine (,) ça fait honte. Ce procédé atteint son plus haut degré dans une langue comme le chinois parlé, où une suite de quelques mots, par exemple tʿā laî wò kʿiü (lui venir moi partir), peut traduire les corrélations les plus diverses : S’il vient, je pars ; Je partirai quand il viendra ; Il vient ou je pars ; Il vient et je pars, etc.
Parmi les divers cas de corrélation, le rapport de comparaison mérite d’être examiné à part. La comparaison n’est pas une simple relation entre substances ; on peut comparer des qualités (Elle est plus grande que lui) et des manières (Elle joue mieux que lui). En réalité ce rapport, malgré la forme plus ou moins condensée que le langage en donne, est toujours contracté entre des jugements.
La comparaison peut aussi porter sur les jugements de nombre (ordinalité) et de temps (temps relatifs).
L’ordinalité n’est autre chose que la numération comparée. Tandis que un homme, deux hommes, trois hommes, etc., répondent à de simples jugements de nombre, le premier, le deuxième, le troisième, etc., supposent la comparaison de tels jugements.
En face de la série compacte des ordinaux en -ième, premier et second sont irréguliers : un/premier, deux/second. Le français avancé abandonne second au profit de deuxième ; dans la mesure où second continue à exister, l’ancienne différence second « de deux seulement » / deuxième « de plusieurs » disparaît et fait place à une nouvelle : second « import relevé »/ deuxième « import commun ». Premier est remplacé par unième (le unième, la unième : B).
En outre, le substantif numéro peut fonctionner comme signe de l’ordinalité : le numéro un « le premier », la ligne numéro cinq « la cinquième ligne », et réalise ainsi avantageusement l’interchangeabilité entre le signe notionnel (substantif numéro) et le signe catégoriel (préformante numéro).
Enfin, l’ellipse permet d’atteindre l’interchangeabilité complète entre cardinal et ordinal : le un « le premier », le deux « le deuxième », le trois, etc.
On peut distinguer les mêmes trois traitements quand il s’agit de transformer l’interrogatif combien en un ordinal : 1. ça fait la combientième tourte qui vient nous barber ? (B 98) ; 2. le numéro combien ? ; 3. on est le combien aujourd’hui ? le combien es-tu ? la combien es-tu ? (Martinon II 503).
La comparaison des temps peut se marquer soit par des adverbes (avant / en même temps / après) ou des conjonctions (avant que, etc.), soit par des temps relatifs, marquant l’antériorité, la simultanéité ou la postériorité.
6) Modalité
La modalité est l’attitude adoptée par le sujet à l’égard de l’énoncé. On peut distinguer une modalité plus ou moins intellectuelle, par exemple l’affirmation et la négation, ou la détermination et l’indétermination, et une modalité plus ou moins affective : l’interrogation, l’ordre (impératif, vocatif), l’évaluation (péjoratif / laudatif), etc.
Comme pour la comparaison, le français présente des cas de supplétion entre affirmation et négation : bon/mauvais, joli/vilain, une fois/jamais, quelqu’un/personne, cher/bon marché, pareil/différent, etc. Le français avancé transforme ces couples en oppositions régulières : mauvais > pas bon, vilain > pas joli, jamais > pas une fois, personne > pas un, différent > pas pareil, etc. Le même passage se remarque pour les verbes : savoir / ignorer > ne pas savoir.
Dans la langue parlée, la phrase interrogative semble aujourd’hui, de par le pullulement des formes concurrentes, extraordinairement compliquée : Qui est-ce qui est venu ? Qui c’est qui est venu ? Qui c’est-i qui est venu ? Qui que c’est qui est venu ? etc. Si la phrase interrogative traverse une crise, tout ce désarroi s’explique cependant par les essais multiples que tente le langage avancé pour supprimer l’inversion, c.à.d. pour obtenir la même séquence que dans la phrase affirmative (affirmative = interrogative).
Ce type d’interrogation est le plus avancé de tous, mais en général il frappe peu, et de fait grammairiens et linguistes n’en parlent guère (v. M. Boulenger, Figaro, 7. 7. 28). Les évolutions les plus profondes se consomment parfois sans révolution apparente.
Si l’on fait abstraction de l’élément non-articulatoire, il suffit d’ailleurs de l’intonation pour obtenir l’interchangeabilité 159complète entre affirmation et négation : Elle vient = Elle vient ? La langue parlée possède aujourd’hui des signes qui peuvent être, selon l’intonation, affirmatifs ou interrogatifs (Parce que = Parce que ? ; A cause de = A cause ? ; Comme ça — Comme ça ? ; Ainsi = Ainsi ?), et qui remplacent heureusement l’ancien type supplétif : Parce que / Pourquoi ? ; A cause de / Pourquoi ?
On peut appliquer aux sujets qui parlent et écrivent le français avancé — en somme à chacun de nous lorsqu’il ne se surveille pas — ce passage d’un grammairien concernant le langage écolier : « Ecoutez-le parler et dressez l’inventaire de tous les mots qu’il emploie. A peine atteindrez-vous à un total de deux cents. Ce lexique rudimentaire lui suffit à la rigueur pour se faire comprendre, pour exprimer en gros toutes ses idées. A chaque moment reviennent sur ses lèvres ou même sous sa plume les termes les plus incolores et les 160plus vagues, être, avoir, faire, dire, mettre, pouvoir, vouloir, chose, homme, gens, ceci, cela, qui, que, quand, beaucoup, très, fort, toujours, souvent, tout à fait, etc. » (Legrand, Stylistique Française, V).
En résumé, le besoin d’invariabilité, en cherchant à faciliter la transposition des signes d’une valeur sémantique à l’autre, diminue le nombre des signes existants et travaille donc pour la « pauvreté du vocabulaire ». L’idéal de l’économie linguistique est en effet de restreindre le nombre des formes et en même temps d’accroître leur sphère d’emploi. Inversement, le besoin de différenciation cherche sans cesse à augmenter le nombre des formes existantes et à spécialiser leur usage. Ainsi, la pauvreté ou la richesse du vocabulaire ne font que refléter l’antinomie de deux besoins fondamentaux : le besoin de différenciation et le besoin d’invariabilité (économie mémorielle). Selon la langue considérée, selon le compartiment de la grammaire qui est envisagé, selon l’étage social, c’est l’un ou l’autre de ces deux besoins qui l’emportera.
B) Transposition syntagmatique
Tout syntagme suppose un rapport de transitivité, c.à.d. un terme déterminé et un terme déterminant reliés par un signe de rapport (explicite ou non). Qu’il s’agisse de linguistique statique ou de linguistique évolutive, la base de toute syntagmatique est la phrase, c.à.d. le rapport sujet (déterminé) + verbe (signe de rapport) + prédicat (déterminant). Les autres syntagmes dérivent, statiquement aussi bien qu’historiquement, de ce rapport primaire, par tout un jeu de transpositions que nous allons étudier.
1) Prédication (la phrase indépendante)
La fonction primaire du verbe est de servir de signe de rapport entre le sujet et le prédicat. Mais en dehors de ce rôle transitif, le verbe peut assumer d’autres fonctions encore : celle de prédicat, exprimée par le radical (ex. domus 161uac-at « la maison est vide ») ; celle de sujet, exprimée dans la terminaison (ex. uaca-t « elle est vide »).
Le besoin d’invariabilité exige : 1. que ces divers éléments soient exprimés distinctement et non en cumul ; 2. qu’ils soient invariables les uns à l’égard des autres ; 3. qu’ils se suivent dans un ordre constant et qui réponde à celui des significations.
a) Le sujet.
L’évolution des langues indo-européennes de l’antiquité à nos jours, est marquée par le passage graduel de la séquence régressive (prédicat + verbe + sujet) à la séquence progressive (sujet + verbe + prédicat). Le verbe latin, par exemple, où la personne, c.à.d. le sujet, est représentée par la terminaison, appartient au type régressif : canta-t « chante-il », qui répond à son tour à la phrase régressive : Canta(t) Petrus.
Le passage à la séquence progressive dans le régime de la phrase (Cantat Petrus → Pierre chante), a entraîné le même renversement dans l’ordre des éléments de la molécule : cant-o → je-chante, canta-t → il-chante, etc. Et la précession du sujet dans la molécule verbale (je-chante, tu-chantes, il-chante, etc.) provoque par ricochet l’élimination des terminaisons personnelles du verbe ; ces terminaisons, là où elles existent encore, sont en effet contraires à l’ordre progressif des éléments de la phrase : le besoin d’invariabilité exige que la séquence reste la même dans la phrase (Pierre chante) et dans la molécule (il-chante).
Cette élimination des anciennes terminaisons personnelles du verbe, désormais inutiles et irrégulières, s’opère par amuïssement (ex. nous, nous chantons > nous, on chante) ou par figement. Les deux phénomènes sont plus ou moins solidaires ; les terminaisons verbales se conservent à la faveur de la tradition, c.à.d. de la force d’inertie du matériel linguistique existant, mais le fait qu’elles ne sont plus « pensées » les transforme en poids mort et favorise souvent leur chute.
b) Le prédicat.
Accord et invariabilité répondent à des principes contraires ; le besoin d’invariabilité exige que le prédicat reste invariable par rapport au sujet.
Dans la phrase, le français ne fait pas de différence formelle entre le sujet et l’objet (prédicat de relation) : Pierre me voit = Je vois Pierre ; la langue moderne ne connaît donc plus de cas-sujet et de cas-régime morphologiques. Mais il n’en est pas de même pour la molécule : Il me voit / je le vois ; je le vois / il me voit. A l’exception de nous et de vous, qui peuvent servir indifféremment comme sujets ou objets, les pronoms personnels sont rigoureusement distingués par la forme : je/me, tu/le, il/le, ils/les. Dans ce domaine l’évolution est particulièrement lente, et l’exemple suivant n’est peut-être que dialectal : Vous mavé parlé de Pheulipp mais je vous dit ci vous chicanne de tros vous navé que lui envoyé promené (Bret. : Prein 69).
On trouve aussi : Il lui zy donne, Il leur zy donne, Faites-moi zy savoir, etc. Mais la solution radicale est : Il lui donne ça, Il leur donne ça, Faites-moi savoir ça, Lui dites pas ça !, etc.
c) Tendance au verbe à radical invariable.
Dans tous les verbes français irréguliers et dans tous les verbes autres que ceux de la première conjugaison, le radical est obligé de varier en fonction des déterminations de personne, de nombre, de temps et de mode qui l’accompagnent : nous faisons / vous faites ; il vient / ils viennent ; elle coud / elle cousait / elle coudra ; il peut / qu’il puisse. Aussi a-t-on proposé de distinguer entre la conjugaison vivante, formée par les verbes de la première conjugaison, et la conjugaison morte, comprenant tous les autres ; mais il ne faut pas être trop absolu, car seuls les syntagmes que la conscience linguistique ne reconnaît plus ou ne sait plus analyser peuvent être dits morts : souloir, tistre, issir sont des verbes morts.
La variabilité du radical comporte des degrés. Dans les verbes de la 2e, de la 3e et de la 4e conjugaison, les formes du radical sont variables, mais prévisibles ; ainsi nous finissons entraîne tu finis, que vous finissiez, etc., autrement dit les correspondances traditionnelles et conventionnelles permettent de dérouler sûrement toute la conjugaison, même si tel verbe en -ir n’a jamais été appris par un sujet parlant. La régularité des formules favorise donc l’effort de mémoire à fournir pour retrouver les diverses formes. C’est ce qui fait que ces verbes, malgré leur productivité réduite, résistent mieux que les irréguliers à l’action du besoin d’invariabilité.
Il n’est pas exagéré de prétendre que la grande majorité des fautes de conjugaison est dictée par le besoin d’unifier le radical du verbe ; il faut que ce dernier reste inchangé en dépit de toutes les déterminations de personne, de nombre, de temps et de mode qui l’atteignent. Cela revient à dire que le français tend à ramener tous ses verbes à la première conjugaison.167
Une étude complète des unifications analogiques à l’aide desquelles le français avancé cherche à réaliser l’invariabilité du radical — effort qui se poursuit depuis des siècles — dépasserait les dimensions d’un simple paragraphe. Mais le lecteur saura ajouter de son gré à nos cadres une multitude d’exemples.
La grammaire traditionnelle distingue un certain nombre de « temps primitifs » à partir desquels les formes de la conjugaison se groupent en séries de formes prévisibles. Ainsi l’Indicatif présent servirait de point de départ à l’imparfait, au subjonctif présent, à l’impératif, et au participe présent (j’aime : j’aim-ais, que j’aime, aime !, aim-ant) ; l’Infinitif commanderait le futur et le conditionnel (aimer : j’aimer-ai, j’aimer-ais) ; le Passé simple formerait le subjonctif imparfait (j’aimai : que j’aima-sse) et le Participe passé les temps composés.
Or, toutes les fautes de conjugaison semblent se laisser ramener à ceci : le français moderne tend à ne plus reconnaître qu’un seul radical invariable comme base sur laquelle viennent se greffer directement tous les temps. Quelle est cette base ? Là où le verbe appartient à la première conjugaison, le radical ressort de la simple comparaison des formes, de sorte qu’il n’est dès lors plus possible de parler d’un thème donné, par exemple l’indicatif présent, ou le participe présent, ou l’infinitif, dont seraient tirées les autres formes.
Mais il n’en va pas de même lorsque le verbe appartient à une conjugaison autre que la première ou lorsqu’il est 168irrégulier, c.à.d. là où le radical est obligé de varier d’un temps ou d’un groupe de temps à l’autre. En cas d’unification, on tend alors à partir du radical tel qu’il se présente dans une forme de conjugaison donnée, pour l’étendre analogiquement aux autres formes. Et ce radical-étalon n’est pas emprunté au petit bonheur à n’importe quelle forme : on peut poser comme principe d’explication que dans le 99% des cas d’unification c’est le radical du pluriel de l’indicatif présent — donc en général (mais pas toujours) le radical élargi — qui est transporté analogiquement au reste de la conjugaison.
Quelques exemples nous éclaireront. Le présent de défaillir (je défaus !) est refait sur le pluriel : nous défaill-ons, ils défaill-ent (elle défaille entre ses bras, Joran n° 88). De même pour mouvoir (je mouve, tu mouves, etc., B 132) et boire (nous boiv-ons, vous boiv-ez, formes rares). Faisez, disez et leurs dérivés, qui sont refaits sur la première du pluriel, n’appartiennent pas seulement au langage enfantin : Ceux qui satisfaisent à ces conditions (Godet XLVI).
L’imparfait, là où il est aberrant, se remodèle sur le présent : j’acquiers, ils acquièrent > j’acquiér-ais.
Enfin, tout cela s’applique naturellement aussi au conditionnel : je voudrais que vous m’écrive-riez le plus vite possible (lettre, Van Der Molen 57).
Le participe passé, et dans la langue écrite le passé simple, tendent, là où ils étaient formés sur un thème spécial, à se greffer directement sur le radical invariable du présent pluriel : les moutons ont paiss-é (Vincent 118) ; pouvoir fait quelquefois pouv-u et mourir mour-u (B 132). On rencontre dans la langue écrite : je riai, je concluai, les fièvres s’étaient résolvées, son appréhension se dissolva, ils se dissolvèrent ; un accueil aussi chaleureux que celui que nous recevâmes (Godet CVII), etc. Il y a là une masse de fautes, plus ou moins éphémères sans doute, mais qui ne se font pas n’importe comment.
Les tentatives d’unification de la conjugaison, dont nous avons donné quelques exemples caractéristiques, signalent une tendance qui se dessine nettement : effacer tout ce qui pourrait rappeler la répartition des radicaux entré plusieurs « temps primitifs » ou « bases » ou « thèmes de flexion » — pour ne laisser subsister qu’un radical unique et invariable, accommodable à n’importe quelle détermination de personne, de nombre, de temps ou de mode.
d) Tendance au verbe à radical interchangeable.
Ces dénominatifs ont de plus l’avantage de faire système avec les adjectifs de procès, les adjectifs de relation et les adjectifs potentiels correspondants : sélectif = sélectionnel = sélectionnable, etc.173
Les verbes décompositifs sont formés à partir de substantifs composés : circonstances atténuantes > circonstancier avec atténuation « accorder les c. a. » (Thérive NL 30.7. 27) ; court-circuit > court-circuiter (Lancelot 24. 3. 28) ; gelée blanche > geler blanc (Nyrop V § 110) ; répétition générale > répéter généralement ; vice-président > vice-présider (Thérive NL 31. 10. 25).
e) Tendance au verbe analytique et progressif.
Il faut ajouter que le verbe français héréditaire ne répond plus à l’analyse actuelle des termes dans la phrase, selon l’ordre sujet + signe de rapport + prédicat, Ou bien le signe de rapport et le prédicat sont confondus en un signe indécomposable (craindre « avoir peur », recourir « avoir recours », répondre « faire réponse »), ou bien, lorsque les éléments sont reconnaissables, leur séquence est archaïque (grand-ir « devenir grand », vieil-ir « devenir vieux », etc., banal-iser « rendre banal »).
Ces exemples, peu corrects mais courants, montrent que les groupes être + substantif, avoir + substantif, faire + substantif sont conçus comme des ensembles, modifiés globalement par l’adverbe. La même remarque s’applique aux fautes de si : J’avais si faim (Z une telle faim) et de beaucoup : J’ai beaucoup faim, Cela m’a fait beaucoup plaisir (Z grand faim, grand plaisir), qui achèvent de signaler la cohésion de ces syntagmes.
C’est d’ailleurs la même tendance au verbe analytique et progressif qui commande l’emploi de la formule être + adjectif transitif, si fréquente dans le français cursif et courant : Cet homme est représentatif de son époque (Z représente), cette lettre est symbolique de son état d’esprit (Z symbolise).
2) Condensation (phrase > mot, syntaxe > morphologie)
Logiquement, c.à.d. si le langage était rivé à la pensée, toute phrase se résumerait dans un rapport unique de sujet à prédicat. En réalité, une seule et même phrase peut, à l’aide de condensations variées, porter l’expression de ce rapport au multiple. Ainsi le verbe réciproque permet de condenser au moins deux phrases : Pierre et Paul se battent = Pierre bat Paul, et Paul bat Pierre. La comparaison porte toujours sur deux jugements, mais le langage peut résumer ce rapport en une phrase unique : Pierre est plus grand que Paul = Pierre a telle grandeur, Paul a telle grandeur, le rapport de grandeur de l’un à l’autre est tel. Dans tout le domaine du langage, le besoin d’économie remplace la série monotone de phrases simples alignées bout à bout, par des ensembles complexes dans lesquels les propositions sont subordonnées les unes aux autres pour former des phrases uniques.
La condensation a pour fonction de transposer une phrase en un membre de phrase, qui peut fonctionner dès lors à son tour comme terme dans une phrase complexe. 175Exemple : la rose est rouge > la rose rouge ; la phrase ainsi transposée en membre de phrase fonctionne à son tour comme sujet dans une phrase plus complexe : la rose rouge s’est ouverte, etc.
La condensation comporte naturellement des degrés variés, que nous examinerons. Mais on peut poser dès le début un trait commun à l’ensemble de la syntagmatique : le caractère dichotomique de tout syntagme. Précisément parce que toute syntagmatique se ramène, statiquement aussi bien qu’historiquement, au rapport initial de sujet à prédicat, les syntagmes, quel que soit leur degré de condensation, s’analysent toujours de deux en deux. Il y a toujours un terme déterminé, un terme déterminant, et un signe de rapport qui les relie ; le déterminé est un sujet ou un sujet, condensé, le déterminant un prédicat ou un prédicat condensé, le signe de rapport un verbe transitif ou un verbe transitif condensé. Exemple : la femme a le panier > la femme qui a le panier > la femme avec le panier > la femme au panier. Cet exemple provisoire montre que la préposition a pour fonction de condenser un verbe transitif, et que le régime de la préposition n’est autre chose que l’objet condensé de ce verbe. Nous dirons en résumé : Rien n’est dans les syntagmes étroits qui ne soit d’abord dans la phrase, rien n’est dans la morphologie qui ne soit d’abord dans la syntaxe.
Ce passage de la phrase au mot sera considéré, dans les pages qui suivent, du point de vue statique et notamment sous l’angle du besoin d’invariabilité ; ce dernier demande que la condensation s’effectue avec le minimum de changements dans la forme et dans la séquence des éléments.
Dans la forme. — L’idéal serait que le même élément puisse fonctionner dans la syntagmatique libre et dans la syntagmatique condensée. Cf. un homme politique (un politicien), une étoffe genre bleu (bleuâtre), la partie machines (la machinerie), manière d’agir (agissement), le fait de diminuer (la diminution), etc.
Dans la séquence. — Si l’on ne considère que le français traditionnel, il y a divergence séquentielle, sur la plupart des points, entre syntagmatique libre (syntaxe) et syntagmatique 176condensée (morphologie) : Cet homme fait de la politique > un politic-ien ; cette partie comprend les machines > la partie qui comprend les machines > la machine-rie, etc. Le français avancé cherche à établir au contraire le parallélisme sujet + prédicat > sujet condensé + prédicat condensé. Cf. un homme politique, la partie machines, etc.
L’interchangeabilité séquentielle peut être obscurcie par plusieurs faits. C’est par exemple l’intervention d’un autre besoin, comme en anglais ou en chinois, où le besoin de clarté oblige à différencier par la séquence la phrase et le groupe nominal : the man is great, chin. jên tá / the great man, chin. tá jên. Mais c’est aussi le fait que les diverses parties d’un système linguistique n’évoluent pas avec la même rapidité. Quand une langue adopte un nouveau type de séquence — et l’on sait que l’évolution de l’indo-européen aux principales langues modernes est en partie dominée par le passage de la séquence régressive (prédicat + sujet) à la séquence progressive (sujet + prédicat) — elle l’introduit d’abord dans la syntagmatique libre, et c’est ensuite seulement que le besoin d’invariabilité l’étend graduellement aux éléments de phrase condensés. Il en résulte que dans une langue donnée la morphologie peut être en retard sur la syntaxe : beaucoup de syntagmes du français traditionnel reflètent un type de phrase qui devait être celui de l’indo-européen.
a) Le subordinatif.
La préposition, avons-nous dit, est un verbe transitif condensé. Quelques distinctions sont à faire.
De même que le signe de rapport reliant le sujet et le prédicat peut être plus ou moins différencié (verbe transitif) ou générique (copule), la préposition reflétera à son tour cette différence ; il y a des prépositions plus ou moins « pleines » ou « vides » (cf. possédant, pourvu de, ayant, avec, à).
En outre, le signe transitif condensé, que nous appellerons désormais d’une manière générale le subordinatif, varie selon la nature de son régime : suivi d’un substantif ou d’un adjectif, le subordinatif est une préposition (après son départ) ; 177suivi d’une proposition, il se mue en conjonction (après qu’il est parti).
Si la préposition est bien un verbe transitif condensé, le besoin d’invariabilité exigerait que le passage de l’un à l’autre puisse s’accomplir avec le minimum de changements dans la forme et dans la séquence. Mais dans nos langues indo-européennes où le verbe et la préposition sont généralement séparés par une barrière formelle rigide, cette exigence ne se réalise que fort imparfaitement. Commencerions-nous à douter de la solidité de notre hypothèse ? L’exemple du chinois parlé, qui représente à peu près l’idéal de ce qu’une langue peut atteindre dans ce domaine, est là pour nous rassurer. La grande majorité des prépositions chinoises courantes (plus d’une cinquantaine) sont interchangeables avec le verbe correspondant. Selon le rôle qui leur est assigné dans la phrase, elles fonctionnent tantôt comme des verbes transitifs tantôt comme des prépositions : yèu « avoir, avec, à » ; yóṅ « se servir de, au moyen de » ; pì « comparer, comparativement à », ; taí « remplacer, à la place de » ; wàṅ « aller, vers (ad) » ; etc..
A défaut d’une solution aussi idéale, trouverait-on en français des cas montrant au moins la tendance à garder le contact entre la préposition et le verbe ? Les procédés traditionnels sont le participe présent (votre réclamation concernant la livraison), le pronom relatif (votre réclamation qui concerne…), l’adverbe transitif (il a agi inconsciemment de son acte) ou une préposition composée. Le rôle principal de cette dernière est de garder le contact avec le signe plein : à partir de, à cause de (= ayant pour cause), etc. Et de fait le sort de la préposition composée est lié à celui du verbe ou du substantif (verbalisé) correspondant. Ainsi fin dans la langue parlée ayant cédé la place à but, le lien entre fin et à fin de s’est effacé : le passage de fin à but entraîne celui de afin de à dans le but de (qqf. à but de).
Subordinatifs d’inhérence. — Si le subordinatif condense un transitif (verbe ou copule), il doit y avoir, parallèlement à la distinction entre transitifs de relation et transitifs d’inhérence (ex. être, se trouver, sembler, paraître, devenir), des subordinatifs 178de relation et d’inhérence. On aurait tort de croire que les prépositions et les conjonctions servent exclusivement à l’expression du rapport de relation. Cf. une chambre de libre (< qui est libre) ; on l’a engagé comme contremaître ; il a fait cela comme je le voulais ; il parle en connaisseur ; le vin s’est changé en vinaigre, etc.
Prépositions et postpositions. — Le besoin d’interchangeabilité (entre le v. transitif et le subordinatif) porte non seulement sur la forme mais encore sur la séquence. Si le v. transitif d’une part, le subordinatif de l’autre, sont parallèles, il en résulte une loi importante : Dans la mesure où l’interchangeabilité séquentielle est respectée, les langues à phrase progressive (v. transitif + prédicat) sont des langues à prépositions (et à conjonctions préposées), les langues à phrase régressive (prédicat + v. transitif) des langues à postpositions (et à conjonctions postposées).
Cette loi semble se vérifier grosso modo. La plupart des langues à verbe médial (l. européennes, l. bantoues, chinois, etc.) sont des langues à prépositions. L’hindoustani, le japonais et les langues turco-mongoles au contraire, où le verbe transitif est postposé au prédicat et termine la phrase, sont des langues à postpositions.
Un autre parallélisme, qui ne se vérifie en général qu’à très longue échéance, est celui entre le verbe postposé et la flexion terminale d’une part, le verbe préposé et la flexion initiale de l’autre. En effet, de même que le verbe transitif se joint à son prédicat en un groupe plus ou moins serré (domus uac-at, la maison est-vide), le subordinatif fait corps avec son régime (groupe prépositionnel ou postpositionnel : il travaille avec-moi, me-cum laborat). De là à l’affixation (préposition > préformante ; postposition > postformante), il n y a qu’une question de plus ou de moins. Le japonais et l’hindoustani d’un côté, le français et l’anglais de l’autre, fournissent l’exemple de langues dont l’évolution est arrivée à l’étape qui précède la flexion terminale, respectivement la flexion initiale.
On sait qu’un très grand nombre de langues indo-européennes ont perdu ou sont en train de perdre la flexion terminale héritée de l’indo-européen, et qu’elles l’ont remplacée, ou sont en train de le faire, par l’usage de prépositions. Le français a perdu la flexion casuelle. Deux théories se sont heurtées et se heurtent encore pour expliquer ce changement de front.
Les uns prétendent que c’est l’usure phonique (débilité des finales) qui a provoqué, par réaction, le développement des prépositions destinées à suppléer les terminaisons déficientes. Or il est remarquable que dans les états de langue les plus anciens, où le passage du type de phrase régressif (prédicat + verbe transitif) au type progressif (verbe transitif + prédicat) ne s’était sans doute pas encore opéré, les particules ajoutées aux cas débiles ou équivoques n’ont pas été des prépositions mais des postpositions 179(ci. le -ā renforçant les locatifs sanscrits et iraniens ; le -de du directif ajouté à l’accusatif grec : πόλιν-δε « ad urbem »).
D’autres prétendent que c’est au contraire la création des prépositions et la fixation de la séquence sujet + verbe + prédicat (servant de signe) qui a fait disparaître les terminaisons casuelles désormais inutiles (Sechehaye, Programme et Méth. de la Lingu. Théorique, 175 sv ; Horn, Sprachkörper u. -funktion, 112).
Il semble que l’élimination des terminaisons casuelles et la création des prépositions soient en gros des faits concomitants entre lesquels on ne peut voir ni dans un sens ni dans l’autre un rapport historique de cause à effet, mais que l’une et l’autre se laissent ramener à un seul principe : le passage de la séquence régressive (prédicat + verbe) à la séquence progressive (verbe + prédicat). La nouvelle séquence des éléments de la phrase a rendu archaïques les subordinatifs postposés (postpositions et terminaisons) et provoqué la création de subordinatifs préposés (répondant aux verbes préposés), en même temps que les postpositions disparaissaient et que les terminaisons casuelles se dévaluaient et tombaient à leur tour.
Il faut noter à part le cas, assez rare, où la conjonction est transposée en préposition à la suite d’une ellipse (mémorielle ou discursive) : Elle a été opérée quand moi « quand j’ai été opéré » > « en même temps que moi ».
Le subordinatif devant un infinitif est une préposition : le traitement de cette dernière est varié : Tantôt elle est rapprochée de la conjonction (avant de venir × avant qu’il vienne > avant que de venir), tantôt elle est solidaire de la préposition suivie d’un substantif (à force de travail > à force de travailler), tantôt elle manque (à cause de /… ; tout au plus a-t-on avec le passé : il a été puni pour avoir désobéi).
b) Les déterminants du substantif.
Le besoin d’invariabilité demande : 1. que le prédicat ne change pas de forme en devenant déterminant (exemple négatif : cette maison est ici > cette maison-ci) ; 2. que le verbe transitif ne change pas de forme en devenant subordinatif (ex. négatif : avoir du courage> courag-eux) ; 3. que la place du subordinatif (avant ou après le déterminant) corresponde à celle du verbe transitif (avant ou après le prédicat) (ex. négatif : faire impression > impression-nant).
Une phrase indépendante peut être transposée en un déterminant à l’aide de deux procédés : la proposition participiale (type ancien) et la relative (type moderne). Exemples : Il apporte le pain > Le garçon apportant le pain est arrivé, ou : Le garçon qui apporte le pain est arrivé. On aperçoit aisément la différence de séquence entre la participiale et la relative : apportant / qui apporte ; la première répond au type régressif (déterminant + subordinatif), la seconde au type progressif fsubordinatif + déterminant). Et de fait la proposition participiale a aujourd’hui un import écrit et archaïque ; le type vraiment moderne est la relative. On remarquera que pour transposer une phrase en un déterminant de verbe, le français n’a pas encore dépassé le stade de la proposition participiale (gérondif français) : le garçon est arrivé en apportant le pain (le nouveau type serait : *le garçon est arrivé qu’il apportait le pain).
Dans les propositions relatives « réfléchies », c.à.d. dans les phrases où le substantif que la relative détermine est en même temps l’objet du verbe de la relative (ex. la lettre que j’ai écrite), les grammairiens, à la suite d’un usage ancien, ont établi la règle que le participe passé doit s’accorder avec cet objet (la lettre qu’il a écrite).
On a beaucoup ferraillé sur ce problème, qui est en somme très simple. L’accord du participe passé est au fond un procédé de conformisme grammatical, qu’on peut mettre sur le même plan que la concordance des modes (Je veux qu’il 182vienne) et la concordance des temps (Je croyais que Genève était une belle ville). Seulement, et voilà le point important, l’accord n’est nullement indispensable à l’intelligence de la phrase, et le besoin d’invariabilité, qui exige que la transposition s’effectue avec le minimum de changements formels, cherche naturellement à se défaire de ces procédés qui augmentent inutilement l’effort de mémoire à fournir : Je veux qu’il vient, Je croyais que Genève est une belle ville, La lettre qu’il a écrit.
Que la suppression de cet accord s’imposera tôt ou tard, les faits qui le montrent ne sont plus à compter. Pour ne pas dire ou écrire : la peine qu’on a pris, la boîte qu’elle a ouvert, après toutes les injures qu’on s’est dit, les conséquences qu’il a craint, la personne que j’ai plaint, la récompense qu’il a promis, etc. etc., il faut savoir aujourd’hui d’avance, et uniquement en vertu des règles enseignées à l’école et dans les livres, que de tels tours sont incorrects.
On sait d’autre part que là où l’accord n’est marqué que par une particularité phonique — la longueur de la finale (la lettre qu’il m’a adressée, la lettre que j’ai reçue) — la langue parlée, à Paris tout au moins, n’allonge plus guère cette finale : la lettre qu’il m’a adressé, la lettre que j’ai reçu.
Une autre entrave au besoin d’invariabilité est dans la séquence. La proposition relative correcte présente des cas où le verbe, contrairement au type de séquence établi dans la phrase indépendante, précède son sujet, notamment lorsque ce dernier forme un groupe assez long : les gares que traverse la ligne directe de Paris à Lyon. Le français avancé tend à écarter cette survivance ; il ne dira jamais, par exemple : les propos que tiennent tous ces gens-là, ni guère : le travail que fait votre ami.
Le traitement du pronom relatif dans le langage populaire mérite une étude spéciale. Le français traditionnel n’a pas de pronom relatif invariable, applicable indifféremment à tous les cas, mais il est obligé de se servir de signes distincts, qui varient en fonction de leur contexte : la chose dont j’ai besoin / la rue où l’accident a eu lieu / l’homme qui est venu / 183le monsieur que j’ai vu / une chose à laquelle il faut faire attention, etc. Dans chacun de ces cas, le pronom relatif est obligé de changer de forme en fonction de la phrase qu’il est chargé de transposer en déterminant.
Dans certains cas, ce que s’est installé par assimilation au que de l’objet direct, grâce au caractère locutionnel du groupe auquel il se rapporte : une chose que j’ai peur (× que je crains), une chose qu’il faut faire attention (× qu’il faut remarquer). Mais cette explication n’a qu’une valeur limitée ; la généralisation du que répond au besoin de disposer d’un instrument invariable remplaçant tous les autres relatifs.
Mais la création et l’extension de ce que invariable ne satisfait pas encore pleinement le besoin d’interchangeabilité. Les matériaux que livre sur cette question le français avancé ont une portée plus étendue ; la définition et l’existence mêmes du pronom relatif sont en jeu.
On remarquera tout d’abord ce fait significatif que le pronom relatif n’est pas un rouage indispensable au fonctionnement du langage. Sans parler des langues où le relatif peut être sous-entendu (angl. the man I saw yesterday ; there is a man wishes to speak with you), certains idiomes, tels que le chinois et le japonais, ne le connaissent même pas.
C’est que le pronom relatif, par sa constitution, est contraire au besoin d’invariabilité. D’une part, en effet, il suppose le cumul d’un subordinatif (que) avec un pronom qui représente l’antécédent à un certain cas ; exemples : l’homme dont je n’ai pas de nouvelles « que (je n’ai pas de nouvelles) de lui » ; la maison où il habite « que (il) y (habite) » ; la femme qui est venue « que-elle (est venue) ». Ainsi donc, un seul et même signe tantôt a sa forme indépendante (de lui, y, elle), tantôt est logé par cumul dans ûri autre signe (dont, où, qui). Il y a cependant des cas où le relatif est bien un syntagme : lequel, duquel, auquel, à quoi, etc. ; même alors, il est contraire au besoin d’invariabilité. Car d’autre part il entrave l’interchangeabilité séquentielle entre la phrase 186indépendante et la proposition relative : l’homme dont (duquel, de qui) je n’ai pas de nouvelles / je n’ai pas de nouvelles de lui ; la maison où (dans laquelle) il habite / il y habite.
Après avoir signalé le décumul du pronom relatif aux cas obliques, nous allons constater la même tendance dans le traitement des cas directs. On aurait tort, par exemple, de parler de pléonasmes à propos de phrases du genre : C’est des types que le malheur des autres les amuse, Ceux que ça les intéresse pas n’ont qu’à s’en aller ; Vos enfants que j’ai toujours bien hâte de les voir (Prein 29). — Que doit être interprété ici non pas comme un accusatif (lat. quos), mais comme une simple conjonction vide. Sans doute, ces exemples sont empruntés à un étage de la langue taxé de trivial ; mais qui pourrait se vanter de ne jamais commettre de ces fautes, dans le parler déboutonné de tous les jours ? Et le type répond à une tendance si profonde qu’il vient s’introduire subrepticement jusque dans la prose de quelques grands écrivains : II est certaines choses que, une fois que nous les avons sues, nous les savons toujours (Malherbe, Stapfer 59) ; Sous ce nom, difficile à porter, et qu’il fallait tant d’espoirs pour oser le prendre, il a conquis la faveur de l’univers (Valéry, disc. de réception à l’Acad.).187
On voit nettement que le décumul du relatif et le libre échange entre l’indépendante et la relative se conditionnent réciproquement.
On notera aussi l’interprétation de qui par qu’il : Le vase qu’il est sur le piano, C’est eux qu’ils sont les riches (B 103), Le voilà qu’il s’amène (Joran n° 22). Ce décumul de qui en qu’il est notamment une des causes de l’ll redoublé, si caractéristique du langage populaire : Celui qui ll’a paumé, Celui qui ll’a fait venir (B 110) ; le découpage est en réalité : Celui qu’il l’a paumé, Celui qu’il l’a fait venir.
On sait d’autre part que la langue familière et surtout la langue populaire omettent souvent l’l : i vient. Il est donc permis de supposer que la conscience linguistique, là où la langue écrite découpe : C’est lui qui vient, analyse en réalité : C’est lui qu’i vient, Je les ai entendus qu’i discutaient, Je les ai vus qu’i venaient. La fausse liaison dans : Ils sont là qui-z-attendent, peut s’expliquer par le décumul : Ils sont là qu’i(l)s attendent.
Ce décumul en qu’il impersonnel est artificiel dans la mesure même où le il impersonnel est devenu artificiel en 189face de cela (ça) : Il m’ennuie de… > Ce qu’il m’ennuie, c’est de…
Ces exemples de dont, où et qui n’ont sans doute pas grand avenir, à côté de l’extension universelle du que. Ils montrent du moins les tâtonnements qui accompagnent d’ordinaire l’installation définitive d’un nouveau type.
Si les idées émises dans ces pages sont conformes à la réalité, le cas du pronom relatif est un bel exemple de la manière dont une tendance — ici le besoin d’invariabilité — en arrive à ses fins à travers une série de petits faits particuliers, dont chacun pris isolément reste inexplicable tant que tous n’ont pas été rattachés à un principe un. La suppression du pronom relatif est un moment de l’évolution irrésistible qui entraîne le français vers le libre échange des signes et des syntagmes d’une fonction à l’autre.
L’adjectif traditionnel peut être variable en genre et en nombre (un homme veuf / une femme veuve ; un effort moral / des efforts moraux), et par la liaison (vieux mur / vieil arbre).
L’adjectif en français avancé marche par des voies diverses vers l’idéal de l’invariabilité.
Un certain nombre d’adjectifs se terminant par c ou j sont invariables, qu’ils soient prédicats ou déterminants : une femme maladif, une balle explosif, une boisson sec, une 191femme veuf (B 94). Cette tendance se manifeste aussi pour d’autres espèces (ex. une femme perdue, Martinon II 270 n), notamment pour le type en -al/aux ; le français semble se montrer de plus en plus réfractaire au pluriel en -aux : v. D’Harvé PB § 156 (de banals parfums, des experts médicals, etc.).
La tendance à la non-liaison est tout aussi accusée : un gran artiste, un vieu arbre, un gro achat, un beau édifice, un nouveau immeuble, etc. Le besoin d’invariabilité l’emporte ici sur la répulsion du français traditionnel contre l’hiatus. Ce dernier n’est d’ailleurs que théorique : « A la vérité, en français il y a toujours liaison ; seulement, dans un cas comme celui-ci, la liaison n’est plus consonantique, elle est vocalique. » (Grammont, Prononc. fr., 136). La « liaison vocalique » ou « prononciation liante » représente donc un compromis entre le besoin d’invariabilité et la tendance à éviter l’hiatus.
La tendance à l’invariabilité de l’adjectif se manifeste aussi dans la réluctance du français avancé à décomposer les finales nasales : un bon (bõn) auteur, en plein (plẽn) air, etc. (bõ = bõn, plẽ = plẽn, au lieu de bõ / bòn, plẽ / plèn).
Il ne suffit pas que l’adjectif soit invariable par rapport à son entourage dans la chaîne parlée. Si l’adjectif déterminant est bien un prédicat condensé, il faut qu’il soit interchangeable avec ce dernier, et cette interchangeabilité doit porter aussi bien sur la forme que sur la séquence.
Beaucoup de langues, en effet, différencient le prédicat (ex. la rosé est rouge) et le prédicat condensé (la rosé rouge) l’un de l’autre, soit par la forme, à l’aide de terminaisons spéciales, soit par la séquence (anglais, chinois).
La place mobile de l’adjectif français, que tout le monde a signalée et décrite, sert à des fins toutes différentes. L’adjectif normal tend à être postposé (la rosé rouge, un brouillard épais, etc.), conformément à la séquence sujet + prédicat (la rosé est rouge, le brouillard est épais). Cette tendance est très forte ; même dans des combinaisons qui paraissaient se figer, le français cherche à supprimer l’antéposition de l’adjectif : la fois prochaine, la fois dernière (× la semaine prochaine, dernière), d’un accord commun (Vittoz 87), s’arrêter à un terme moyen (ib.), etc.192
L’adjectif préposé, au contraire, quand il n’est pas un simple préfixe (tit’fille, tit’maison, etc.), est considéré comme une inversion expressive : un épais brouillard, une verte prairie, une colossale entreprise, etc.
De même que tout prédicat est lié à son sujet par un verbe transitif, tout déterminant est lié à son déterminé par un subordinatif (verbe transitif condensé), exprimé ou non. Tel est le cas pour la préposition de chargée de former le lien entre un substantif actualisé et son prédicatif : une chambre est libre > une chambre qui est libre > une chambre de libre.
Les adjectifs tirés de substantifs marquent la même tendance à préposer le subordinatif : une femme en pleurs (Z éplorée ; type intermédiaire : épleurée, faute fréquente), un arbre en fleurs (fleuri), etc.
Particulièrement intéressants sont les cas où un suffixe 193semi-concret (ex. -âtre, -oïde) fait place à une préformante tirée directement du substantif, réalisant ainsi l’interchangeabilité séquentielle et formelle : une couleur genre bleu (Z bleuâtre), une teinte genre rouge (Z rouge-âtre), une forme genre œuf (Z ov-oïde), une courbe genre ellipse (Z ellips-oïde), etc.
Les adjectifs qualificatifs, qui sont des déterminants d’inhérence, doivent être distingués des compléments de relation. Tandis que les premiers remontent à un prédicat d’inhérence (la rosé est rouge > la rosé rouge), les seconds condensent un prédicat de relation (objet) ; ex. il commande le navire > le commandant du navire.
Le complément de relation (ou génitif objectif) est donc au prédicat de relation (ou : objet direct ou indirect, accusatif ou datif) ce que le déterminant d’inhérence (adjectif qualificatif, etc.) est au prédicat d’inhérence. Dans les deux cas, le besoin d’invariabilité demande que la séquence reste la même : le brouillard est épais > le brouillard épais ; il commande le navire > le commandant du navire ; le livre est à Pierre > le livre de Pierre.
Le même rapport vaut pour les langues en général, et pour leur histoire. Dans la mesure où l’interchangeabilité séquentielle entre phrase et membre de phrase est respectée, les langues à objet postposé sont des langues à complément de relation postposé, et inversement les langues qui comme l’hindoustani, le japonais et les langues turco-mongoles, préposent l’objet au verbe transitif, préposent aussi le complément de relation au substantif déterminé (et sont par conséquent aussi des langues à postpositions). De même, si l’on se place sur le terrain historique, l’évolution du génitif préposé (en indo-européen et en latin) au génitif postposé (l. romanes) apparaît en résumé comme le retentissement, sur la syntagmatique condensée, de l’évolution de la séquence accusatif + verbe transitif (en indo-européen et en lat.) à la séquence inverse : verbe transitif + accusatif.
Contradictions. — a) Cette théorie est en contradiction avec celle du P. W. Schmidt (Sprachfamilien u. -kreise der Erde, 194491-4), qui explique le passage du génitif préposé au génitif postposé, et en même temps le passage de la flexion terminale aux prépositions, par l’intervention d’un facteur externe : le contact avec des langues non indo-européennes. — La linguistique fonctionnelle, sans rejeter en principe l’explication externe, ne la fait intervenir qu’après avoir épuisé les possibilités d’explication par le fonctionnement même du système et par les besoins qui le commandent.
b) Lorsque l’interchangeabilité séquentielle est en défaut, c’est qu’elle est contrecarrée par la tradition (« puissance du matériel linguistique existant »), ou par l’action d’autres besoins, notamment du besoin de clarté. Un facteur important, dans ce dernier cas, est la prédominance de l’emploi de subordinatifs formels (désinences, prépositions, etc.) ou de la juxtaposition pure ; cette dernière pousse l’anglais à différencier par la séquence la phrase (my father is good) et le groupe nominal (my good father), tendance qui devient règle absolue en chinois (sujet + prédicat / adjectif ou complément de relation + substantif).
Mais l’idéal linguistique serait d’obtenir non seulement l’interchangeabilité séquentielle, mais encore l’interchangeabilité formelle entre l’objet et le complément de relation. C’est ce que réalisent certaines langues, sous leur forme parlée plus ou moins populaire (latin de Plaute, bas-latin, etc.) : Quid tibi nos tactio ‘st ? Quid tibi hanc curatio ‘st rem ? Iusta orator « celui qui demande des choses justes » ; Peccatorum ueniam promittor « celui qui promet la grâce des pécheurs », etc. (v. Vendryes, Lang., 150-1). Cf. : J’ai fait des demandes aux Commandants les Dépôts et le 3e Corps, il m’a été répondu présumé en bonne santé (APG).
Quant à l’objet indirect (datif), le type le canif à Pierre (< le canif est à Pierre) est dès longtemps attesté. C’est la même tendance à unifier la rection qui crée la construction si fréquente aujourd’hui : l’élection au Conseil National (Plud’hun 64), les contrevenants au présent arrêté, un adhérent à la Société (Joran n° 3), les morts pour la patrie.
Les adjectifs de relation, qui sont une autre manière de condenser le prédicat de relation (un témoin qui l’a vu de ses yeux > un témoin oculaire ; un concours qui a lieu sur route > un concours routier), intéressent la langue cursive. 195La langue parlée ne les favorise pas, car ils contrarient le besoin d’invariabilité.
D’une part, en effet, le passage du mot « populaire » au mot « savant » que nécessite la création de l’adjectif de relation, est souvent très abrupt : œil / témoin oculaire, sucre / teneur saccharine de la betterave, coupon / impôt cédulaire, poumon / pulmonaire, etc. D’autre part, l’adjectif de relation s’écarte presque toujours de la séquence des éléments de la phrase : le concours a lieu sur une route / routier.
En outre, la langue parlée tend, ici comme pour les adjectifs d’inhérence, à remplacer les suffixes par des prépositions, afin de ne pas changer de séquence dans le passage du prédicat de relation au complément. Les exemples de cette transformation ne sont d’ailleurs guère incorrects : un concours sur route (Z routier), des soldats à casques (Z casqués), un homme à courage (Z courageux), un voyage sur mer (Z maritime), par air (Z aérien), etc. Néanmoins, l’évolution est capitale.
Le déterminatif cumule un actualisateur (article) avec un déterminant (adjectif) de manière à former un signe unique, c.à.d. un syntagme non-analysable dans sa forme. Exemples : mon chapeau « le chapeau de moi », quatre personnes « des personnes au nombre de quatre », cette maison « la maison qui est là, » etc.
c) Les déterminants du verbe.
C’est à l’aide du gérondif que le français condense une phrase en une proposition déterminant le verbe : Il courait > Il est arrivé en courant. Un autre procédé est la proposition circonstancielle, introduite par une conjonction : Il est arrivé en même temps qu’il courait, pendant qu’il courait. Le gérondif et la proposition circonstancielle, qui déterminent le verbe, sont parallèles à la proposition relative qui détermine le substantif. Comme pour cette dernière, le besoin d’interchangeabilité cherche à rendre aussi aisée que possible la transformation de la phrase en une circonstancielle, et entre ainsi en conflit avec les exigences du conformisme grammatical, qui demande au contraire que le verbe varie en fonction de la conjonction qui le régit (cf. l’imparfait après si, le subjonctif après certaines conjonctions, etc.). On ne fera ici qu’effleurer ce vaste sujet.
L’imparfait après si est un procédé de conformisme inutile à l’intelligence de la phrase, et qui entrave l’interchangeabilité entre l’indépendante et la subordonnée. En même temps, il empêche l’expression du mode quand ce dernier demande à être exprimé ; dans ce cas, le langage populaire se sert du conditionnel d’éventualité, absolument comme dans la phrase indépendante : Je pourrais peut-être le voir > Si je pourrais peut-être le voir (Z Je pourrais peut-être le voir/ Si je pouvais…).
La conjonction peut être également obligée de varier, en fonction de son entourage : Quand (kã) je suis venu / Quand (kãt) il est venu. Le français populaire, poussé également par le besoin dé conservation des monosyllabes, unifie par la forme longue dans les deux cas : Quand’ je suis venu, Quand’ nous sommes venus, Quand’ je te dis que ce n’est pas vrai !
Les adverbes relatifs (conj. + adv. cumulés) sont parallèles aux pronoms relatifs. On commence à rencontrer, dans la langue parlée, des cas de décumul qui rappellent ceux du pronom relatif : Je serai parti quand vous viendrez > 200Je serai parti que vous viendrez alors ; Juste au moment où il sortait de chez lui, la lettre est arrivée > Juste qu’il sortait de chez lui à ce moment, la lettre est arrivée ; Il est parti sans qu’on sache pourquoi > Il est parti qu’on ne sait pas pourquoi.
L’adverbe est à la proposition circonstancielle ce que l’adjectif est à la proposition relative. Par métaphore, on peut dire que la fonction de la proposition relative est de condenser une phrase indépendante en un adjectif, tandis que celle de la circonstancielle est de condenser une ndépendante en un adverbe.
Les règles de séquence sont aussi parallèles. De même que le prédicat est postposé à son sujet, la relative et la circonstancielle sont postposées à leur déterminé ; le type régressif latin et pré-latin a été abandonné (filium amans pater → le père qui aime son fils) ; la circonstancielle placée avant le verbe est aujourd’hui désuète et littéraire, sauf dans les constructions absolues : Pour vivre, il faut travailler.
La place de l’adjectif déterminant le substantif et celle de l’adverbe déterminant le verbe, sont soumises au même sort. L’adverbe français tend à être postposé : Tu es maboule un peu ! On m’a dit même qu’il avait été transporté dans une ferme (APG), Je renouvelle aujourd’hui ma demande faite le g octobre, dont nous n’avions eu pas de réponse (id.), etc.
En raison de la même tendance, le subordinatif chargé de former l’adverbe et de le relier au verbe viendra se substituer en tant que « préformante » aux suffixes traditionnels. En effet, la plupart des adverbes de manière de la grammaire courante étant au fond des adverbes d’inhérence, ayant pour base la copule être, la place du suffixe -ment jure avec celle de la copule devant son prédicat : être joli / joli-ment. De là divers types nouveaux en voie de formation eu de développement.
On a cité comme remplaçants éventuels des adverbes en -ment « des formations telles que marcher d’un pas tranquille, d’un pied rapide, parler à voix basse, crier à tue-tête, etc. » (Bally LV 75). Le renversement de la séquence est frappant : claire-ment > d’une manière claire. Le type semble avoir pour le moment un import « écrit », mais il répond à la courbe d’évolution de la langue et il suffirait qu’un ou deux exemples se généralisent pour qu’on obtienne ainsi un préfixe de manière : d’un air…, d’un ton…, d’une manière…, d’une façon…
Parmi les types moins concrets, et par conséquent plus généraux, citons la préformante en, qui fournit des adverbes à peu près corrects : en héros (héroïquement), en douce (doucement), en moins fort, en grand, en clair, etc., et par extension en tête-à-tête et en sous-main (Lancelot 21. 7. 28). La préposition pour forme également des adverbes : pour sûr (sûrement).
Les circonstanciels et adverbes de relation condensent des prédicats de relation pour en faire des déterminants de verbes. Ainsi les adverbes de lieu et de temps sont des adverbes de relation ; on peut toujours leur substituer un verbe suivi d’un prédicat de relation ou une préposition de relation suivie de son régime : ailleurs « à un autre endroit », ici « à cet endroit », toujours « à chaque instant », etc. C’est surtout la préposition à qui sert à former les adverbes de relation : Vendre en ayant des pertes > avec des pertes > avec perte > à perte ; fermer avec une clef > à clef ; à deux mains, à quatre pattes, etc. Ce type est entièrement correct.
d) Adjectif = adverbe.
e) Déterminants affixés.
A un degré de condensation ultérieur, le déterminant est affixé à son déterminé de manière à former avec lui plus ou moins un seul mot : très-grand, si-joli, in-connu, etc. Le besoin d’invariabilité demande naturellement que le passage du déterminant lâche au déterminant étroit s’effectue avec le minimum de changements dans la forme et dans la séquence des éléments.
Le français avancé présente des cas où un adverbe lâche est employé comme adverbe serré (Ici joint quelques timbres pour la réponse, Ici joint vous trouverez dix francs, APG), et inversement un adverbe serré (adverbe de déterminant) comme un adverbe lâche : On a très applaudi sa causerie. Je me suis très amusé ; Tu t’ennuies si de ne pas avoir de mes nouvelles (Prein 75).
Le traitement des préfixes négatifs doit être mentionné à part. Le préfixe traditionnel in- contrecarre de diverses manières le besoin d’invariabilité. D’abord, il est obligé de varier en fonction de l’initiale du mot : in-capable, im’-mangeable, in’-négociable, il-lassable, ir-remplaçable.
La langue populaire, où le besoin d’interchangeabilité prévaut, réagit en généralisant l’une des deux négations, ordinairement l’adverbe libre. Ce type d’unification, que n’ignorent pas les autres langues, est absolument courant dans le français familier et populaire : un homme pas content, un élève pas attentif, une fille pas adroite, etc.
Il ne faut pas oublier que ces schèmes n’ont qu’une valeur théorique, car à mesure que l’on descend dans la morphologie l’invariabilité devient de plus en plus difficile.
f) La substantivation.
Tout syntagme peut être condensé en un substantif : être blanc > la blancheur, marcher > la marche, faire de la politique > un politicien, beau > le beau, etc. Cette fonction que le substantif a de condenser les syntagmes, est essentiellement économique ; la concrétisation et l’abstraction facilitent la manipulation des signes. Mais il faut naturellement que la substantivation, pour être économique, puisse jouer avec le minimum de changements dans la forme et la séquence des éléments.
Nous examinerons successivement le substantif réel, désignant un être ou une chose, et le substantif abstrait.
Tandis que le radical du verbe, en français traditionnel, est obligé de fortement varier, le radical du substantif, plus évolué, est devenu à peu près invariable. Il résiste encore à l’invariabilité dans certains cas, notamment par le nombre et le genre, mais il s’agit là de survivances : cheval / chevaux, fou / folle, etc. Malheureusement, l’élimination de ces vestiges est extrêmement lente ; les formes divergentes se disputent pour servir de modèle à l’analogie (bals, chacals, régals, mais : bateau, chapeau, seau), et les fautes actuelles dues au besoin d’unifier le radical appartiennent à plusieurs types. Ainsi l’on trouve non seulement des amirals, des caporals, élever des bétails, et même : des journals, des œils, mais encore un bestiau, un animau, un hopitau, etc.
Le pluriel des monosyllabes est soumis à un traitement conséquent : le français avancé adopte dans tous les cas la forme à consonne finale prononcée (un œuf = des œuf’, un bœuf = des bœuf’, un os = des os’) ; le besoin d’invariabilité 207marche ici de pair avec le besoin de différencier les monosyllabes en les étoffant.
Qu’il s’agisse du nombre ou du genre, le français tend donc à abandonner les vieilles différences formelles (cheval / chevaux, fou / folle), pour marquer les idées de détermination en dehors du radical.
En français traditionnel, les pronoms également sont souvent obligés de varier en fonction de leur entourage ; tel est le cas pour le pronom ça : Regardez-ça / ce n’est pas vrai / c’est vrai. Le français avancé cherche à le maintenir invariable : On verra voir si ça est vrai, ça (B 153) ; ça n’est pas vrai ; ça n’est pas ça ; c’est pourquoi faire, ça qu’il a derrière ?
Les substantifs composés et dérivés ont pour fonction de condenser une phrase en un substantif : il fait de la politique > un politicien, il cultive la terre > un cultivateur, le pot est pour le lait > le pot à lait, ce timbre sert de réclame > un timbre-réclame, etc. Pour rendre aussi aisé que possible le passage de la phrase au composé ou au dérivé, il est clair que le besoin d’invariabilité cherchera à réaliser, d’une manière plus ou moins approchante, l’identité formelle et séquentielle de l’une à l’autre.
En outre, puisque le point de départ des composés et des dérivés est la phrase, la séquence sujet + prédicat devrait, en vertu du besoin d’invariabilité, fournir l’ordre radical + affixe (postfixe ou postverbe). Nous avons donné plus haut quelques exemples de cette tendance : progresser > marcher en avant, rétrograder > marcher en arrière, poursuivre > courir après, etc. ; roue avant, roue arrière, centre demi, etc.208
La langue cursive s’est créé un type qui permet l’interchangeabilité entre syntagmatique libre ou étroite : les produits miniers méditerranéens, la science chimique allemande, le mouvement poétique moderne, etc. (v. Thérive FLM 109 sv). Il ne s’agit pas là d’adjectifs accumulés, mais de groupes nominaux (substantif + adjectif) fonctionnant comme des composés qualifiés en bloc par un adjectif suivant, et ainsi de suite. Par exemple, un groupe comme des théories sociologiques révolutionnaires s’analyse en un composé (théories sociologiques) suivi d’un adjectif qui le qualifie globalement. De la sorte, un même syntagme peut fonctionner tantôt comme un groupe syntaxique (les langues isolantes, all. die isolierenden Sprachen) tantôt comme un composé (les langues isolantes monosyllabiques, all. die einsilbigen Isoliersprachen).
Les substantifs décompositifs sont formés à partir de substantifs composés ; ce sont des dérivés de composés : linguistique générale > linguiste général ; statistique du travail > statisticien du travail ; pomme à couteau > pommier à couteau ; accident du travail > accidenté du travail ; médaille militaire > médaillé militaire, etc. Ces formations sont caractérisées formellement par le fait que le substantivateur est infixé dans le syntagme (statisticien du travail, médaillé militaire) ; mais le langage populaire tend à supprimer les discontinuités qui se présentent dans l’agencement des signes : chemin-de-ferr-ier (Z cheminot).209
Le substantif abstrait, au lieu de désigner une chose ou un être réels, a pour fonction de condenser une phrase en une entité fictive : la mort « le fait de mourir », la beauté « le fait d’être beau », le professorat « le fait d’être professeur », etc.
Ce procédé favorise éminemment la maniabilité des pièces du système. Le fait n’est pas une chose, ni un être, mais un condensé de phrase construit par le langage ; il n’existe pas tout fait dans la nature : ce sont les sujets pensants et parlants qui le créent pour des raisons de commodité.
Mais cette économie est soumise à des limites ; en français, le substantif abstrait héréditaire pèche doublement — par la forme et par la séquence — contre le besoin d’invariabilité.
Le problème se présente sous beaucoup d’autres faces encore. Ainsi il comporte un aspect phonique : babil est prononcé babiy pour garder contact avec le verbe dont il est tiré. D’autre part, le substantif abstrait héréditaire, pour être compris, suppose souvent la connaissance d’un verbe qui n’existe pas dans la langue même : acception ← lat. accipere, médication ← lat. medicare, etc. ; le français avancé refait ces substantifs à partir de bases connues : dans l’acceptation défavorable du terme, médicamentation, etc.210
Le préfixe comme le suffixe peut être obligé de varier en fonction du radical : enflammer / inflammation, d’où : inflammation (Joran n° 165). « La plupart de nos suffixes ont peu de valeur intrinsèque ; il en est même qui sont interchangeables, sinon au regard du linguiste, du moins dans la pratique : et les étrangers ne sont pas seuls à hésiter sur tel mot qui peut se terminer en age, en erie, en ement, en ité, en ion, en ure… » (Vittoz 55). Et de fait, qui n’a entendu parler de la conformité (Z conformation) d’un objet, de la dentition (Z denture) d’une personne, etc. ?
Le substantif abstrait traditionnel, avons-nous dit, pèche contre l’interchangeabilité par la forme et par la séquence. Par la séquence : l’abstracteur — c’est ainsi qu’on peut appeler le signe chargé de condenser la phrase en un substantif abstrait — est en effet un suffixe (beau-té, professor-at, ven-ue, etc.)
Les propositions qui périphrasent le substantif abstrait sont seules conformes à la séquence actuelle des éléments de la phrase : le fait d’être beau, le fait d’être professeur, le fait d’être venu, ou : de venir, etc. L’abstracteur peut naturellement être plus ou moins générique ou spécialisé ; cf. ac-tion / agisse-ment, le fait d’agir / la manière d’agir (« le fait d’agir ainsi »).
La proposition substantive est en effet l’équivalent moderne du substantif abstrait héréditaire ; elle suppose, explicitement ou à l’état latent : 1. un abstracteur ; 2. un subordinatif (que + proposition fléchie, de + proposition infinitive) ; 3. une proposition, à verbe fléchi ou non.
La linguistique fonctionnelle semble ainsi pouvoir résoudre, par l’étude du langage spontané contemporain, un problème qui était réservé jusqu’ici à la linguistique de musée : l’antériorité historique du substantif abstrait ou de la proposition substantive. Au point de vue du chargement de séquence, le remplacement graduel des substantifs abstraits héréditaires par des propositions substantives peut d’ailleurs être mis en parallèle avec le passage de la proposition participiale traditionnelle à la relative moderne : ex. la préparation du pain > le fait de préparer le pain = le boulanger 211préparant le pain > qui prépare le pain. Il s’agit là, comme pour tant de choses dans le langage, d’une évolution longue et lente, où le remplaçant et le remplacé coexistent pendant des siècles.
La présence de l’abstracteur est d’ailleurs normale dans le domaine des conjonctions de subordination, car chacune au fond transforme son régime en un substantif abstrait : Elle est fâchée de ce qu’il est parti = du fait qu’il est parti = de son départ ; cf. à ce que = au fait que, en ce que = dans le fait que, etc.
On remarquera — nous insistons sur ce point que les manuels ignorent — le parallélisme des subordinatifs de et que, chargés de relier l’abstracteur à la proposition qu’il substantive : Je promets que je viendrai demain = je promets de venir demain (théoriquement : le fait que, le fait de). La seule différence est d’ordre normatif ; le que est obligatoire, tandis que le de n’est pas encore toléré devant tous les infinitifs.
L’infinitif précédé de de a été condamné par divers grammairiens. « Si l’infinitif-su jet est parfaitement admissible et s’il est excellent de dire : Pleurer est lâche, Faire sa soumission eût été logique, nous ne conseillerons jamais d’écrire : De pleurer est lâche, De faire sa soumission eût été logique, D’aller à pied est hygiénique » (Albalat, Comment il ne faut pas écrire, 41-2). Cette tournure rejoint pourtant l’usage classique, et répond à la tendance profonde de marquer explicitement les rapports grammaticaux.
Par ricochet, ce de s’étend aux prépositions, à commencer par pour : C’est pour de rire (Joran n° 84), et plus explicitement : Je pense toujours à vous tous pour ça de travailler les chevaux enfin faites votre mieux (Prein 68).
Note. — Le parallélisme des subordinatifs de et que est d’ordre général ; on en trouve l’équivalence dans d’autres langues : all. dass — zu ; angl. that = -ing, etc.
3) Transposition linéaire
Les types transpositifs étudiés dans les pages qui précèdent sont des procédés permettant de condenser la densité des syntagmes. La transposition linéaire consiste à modifier l’étendue ou la direction syntagmatiques des éléments agencés, leur densité et leur signification étant censées rester les mêmes.
a) Changements d’étendue : élargissement et rétrécissement.
Tout verbe intransitif, c.à.d. tout verbe fonctionnant comme prédicat, peut être élargi en admettant un prédicat à sa suite, c.à.d. en devenant à son tour un signe de-rapport ou verbe transitif ; ex. le troupeau sort > on sort le troupeau. Inversement, tout verbe transitif peut être rétréci en un verbe intransitif absolu, par l’ellipse (mémorielle ou discursive) de son prédicat ; ex. il boit du vin > il boit.
Le verbe intransitif absolu diffère du verbe intransitif neutre par le fait que ce dernier constitue toujours plus ou moins un syntagme dans lequel le rapport de copule à prédicat n’est pas analysable par la forme. Exemples : vivre « être en vie », exister « être là, être qch. », évoluer « devenir qch. », agir « faire qch. », etc. etc. Dans le domaine de la syntagmatique étroite, nous verrons que les adverbes synthétiques sont parallèles au verbe neutre (ensuite « après ça », néanmoins « malgré ça », ainsi « comme ça », etc.) et les adverbes absolus parallèles au verbe absolu (après « après ça », malgré « malgré ça », avant « avant ça », etc.).
Essence et existence. — Les discussions des scolastiques et des modernes sur la différence entre essence et existence ou entre 214être et exister (v. Lalande 217, 222, 228), ne sont qu’un problème de langage projeté dans la philosophie. Il s’agit simplement de la distinction entre le verbe transitif (Dieu est grand), le verbe intransitif absolu (Dieu est « existe » ; Je pense donc je suis « existe ») et le verbe intransitif neutre (Dieu existe). De même : devenir / évoluer « devenir qch. » ; avoir / posséder « avoir qch. » ; faire / agir « faire qch. ».
Le même mécanisme d’élargissement ou de rétrécissement peut s’observer dans le domaine de la syntagmatique condensée. De même que tout verbe intransitif peut devenir transitif par l’adjonction d’un prédicat, tout déterminant (adjectif ou adverbe) peut devenir à son tour, par addition d’un complément, un subordinatif ; inversement, tout subordinatrf peut, par ellipse (mémorielle ou discursive) de son régime, fonctionner comme un déterminant.
Le français traditionnel possède tout un stock d’adverbes et de prépositions qui diffèrent par la forme : à / y « à qch., à un endroit », après / ensuite « après cela », dans / dedans « dans cela », de / en « de qch., de qn. », sur / dessus « sur qch. », etc. etc. Dans une langue à interchangeabilité suffisamment développée, on verrait le même signe fonctionner tour à tour comme préposition ou comme adverbe (cf. certains emplois de of « de = en » et de to « à = y » en anglais).
Les grammairiens qui combattent ces adverbes font souvent intervenir l’argument du « germanisme » (Est-ce que vous venez avec ? < Kommen Sie mit ?, etc.) ; mais il s’agit bien plutôt de coïncidences, car le besoin d’unifier la préposition et l’adverbe est commun à toutes les langues.
Le passage de la conjonction à l’adverbe n’est pas aussi fréquent : Il est venu quand même (l. familière, Z tout de même, néanmoins) ; Pourquoi est-ce qu’il n’est pas venu ? Parce que.
Les cas d’élargissement ou de rétrécissement syntagmatiques étudiés jusqu’à présent portent sur l’échange entre un signe de rapport (verbe transitif, subordinatif) et un terme (prédicat, déterminant). Une étude complète du sujet devrait tenir compte d’autres cas encore ; le plus important est l’interchangeabilité entre le substantif et l’adjectif, ou d’une manière plus générale entre le déterminé et le déterminant.
Tout déterminant peut être transformé en un déterminé par l’ellipse de ce dernier, qui est pour ainsi dire absorbé par son déterminant. Exemples : un (homme) politique éminent, un (soldat) porte-drapeau, le vrai (Z ce qui est vrai), surveiller le mental d’un malade (Z l’état mental), la ligne des avants 218(Z des joueurs avants), etc. Ces quelques exemples montrent qu’en réalité ce n’est pas l’article, malgré l’opinion vulgaire, qui substantive le déterminant ; il ne le fait que par ricochet, en signalant le substantif sous roche.
Il s’agit là du type latin bien connu Post urbem conditam « après la fondation de la ville ». Cf. aussi : Ce succès fort modeste ne l’a pas empêché de continuer ; On a fêté les cinquante ans de la société X (Z le cinquantenaire), etc.
Il y a également substantivation lorsque le déterminatif chaque est suivi d’un groupe déterminant + déterminé : Chaque dix minutes « chaque intervalle de… », chaque vingt mètres « chaque espace de… », etc.
Ces nominalisés, comme les substantivés examinés plus haut, servent simultanément le besoin de brièveté et le besoin d’interchangeabilité, le même signe pouvant fonctionner soit comme un déterminant ou par ellipse comme un substantif, soit comme un déterminatif ou par ellipse comme un nominal.
On pourrait comparer les changements d’étendue étudiés dans ce paragraphe, à l’élasticité physique : un seul et même syntagme se distend et se resserre à tour de rôle ; et mieux encore à la contractilité physiologique, en vertu de laquelle la substance organisée se raccourcit dans un sens pour augmenter de dimension dans un autre et vice-versa : le syntagme qui se rétrécit formellement s’enrichit sémantiquement (par absorption de l’ellipse), et inversement le syntagme qui s’élargit formellement s’appauvrit sémantiquement.220
b) Changements de direction : Conversion.
Un autre type de transposition linéaire contribue également à accroître la maniabilité des signes. Nous désignerons sous le terme de conversion l’ensemble des transpositions qui supposent un changement de direction entre les signes agencés, notamment entre le sujet et le prédicat.
Le passif n’est pas une catégorie sémantique. C’est un simple instrument syntagmatique servant à transposer l’objet en sujet, la signification de la phrase étant censée rester la même : Pierre bat Paul Z Paul est battu par Pierre.
Ici comme ailleurs le phénomène de la supplétion induit en erreur. On prétend par exemple que le verbe avoir n’a pas de passif (Brunot PL 362) ; mais si en effet le passif formel du verbe avoir est inusité ou en tout cas artificiel (être eu par…), c’est qu’en réalité il y a supplétion. Le véritable passif du verbe avoir est, au fond, le tour être à : Pierre a le livre Z le livre est à Pierre. Il y’a cependant une nuance : avoir est généralement suivi d’un régime indéterminé (Pierre a un livre), tandis que être à demande un sujet déterminé (le livre est à Pierre). Nous retrouverons ce « décalage logique » a propos de l’impersonnel : les dieux existent Z il y a des dieux.
Le passif en se, qui constitue un gallicisme admis aujourd’hui par la plupart des grammairiens (la maison se construit, cela ne se refuse pas, etc.), n’est pas l’équivalent exact du passif traditionnel ; il sert à convertir un actif à sujet indéterminé : les maçons bâtissent la maison Z la maison est bâtie par les maçons ; mais : on bâtit la maison Z la maison se bâtit, on dit ça Z ça se dit, on le saurait Z ça se saurait, etc.
Au lieu du passif en se, il arrive que la langue moderne se serve directement de la forme active : les meilleures voitures graissent à la Kervoline, l’huile qui s’impose (Z on graisse…) ; ce corsage boutonne par derrière (Z on boutonne…). Cette tournure, qui réalise l’interchangeabilité complète, 221rejoint le type anglais : the book reads well « l’ouvrage se lit aisément », qui sert également à convertir le sujet indéfini.
La confusion formelle de l’agent et de l’objet 2 favorise évidemment l’économie, mais il ne semble pas qu’elle constitue un échange naturel pour le langage : l’agent et l’objet 2 ne sont pas des catégories grammaticales complémentaires.
Il est naturel de retrouver la distinction entre actif et passif dans le domaine de la syntagmatique condensée : une mère soignant ses enfants Z une mère soignée par ses enfants. Mais au passé la différence est surtout écrite : ayant soigné Z (ayant été) soignée par ses enfants.
Le passif à agent indéterminé peut être condensé dans un participe présent : On tache facilement cette étoffe Z Cette étoffe se tache facilement > Une étoffe tachante. Ce type est très employé (une couleur tachante, voyante, salissante, etc.) et n’entraîne guère d’équivoques.222
Le passif 2 sert à convertir l’objet 2 (datif) en un sujet. On a souvent nié l’existence d’un passif de l’objet indirect. Ici encore, c’est le défaut d’interchangeabilité qui cache la réalité du phénomène : Pierre a donné une pomme à la jeune fille Z La jeune fille a reçu (ou : a été gratinée d’) une pomme de Pierre. Dans certaines langues, le verbe actif et le passif 2 sont à peu près interchangeables ; cf. chinois maì « acheter » Z maí « vendre » et, sans différence de ton : tsié « emprunter » Z « prêter ». Cet idéal se réalise rarement dans nos langues ; cf. le propriétaire a loué l’appartement au locataire Z le locataire a loué l’appartement au propriétaire.
En anglais, la forme du passif 1 sert à exprimer également le passif 2 : The boy promised an apple to the girl Z The girl was promised an apple from the boy ; The boy showed the gentleman the way Z The gentleman was shown the way from the boy.
Ces tournures, correctes ou non, permettent au français de transposer assez facilement l’objet 2 en sujet, et doivent donc être mises à l’actif de l’interchangeabilité.
L’échange entre objet 1 (accusatif) et objet 2 (datif) est lié de près au problème du passif 2. Exemple (avec verbe non-interchangeable) : Il lui a donné une montre Z Il l’a gratifié d’une montre. Là encore, l’interchangeabilité est 223chose toute relative, selon les langues. L’allemand possède dans le préfixe be- un transpositeur assez régulier : Er hat ihm eine Uhr geschenkt Z Er hat ihn mit einer Uhr beschenkt, qui lui permet en même temps d’avoir un passif 2 : Er ist mit einer Uhr beschenkt worden.
Il est curieux de constater que la conversion de l’actif en passif ne peut se faire qu’avec les verbes de relation. Pourquoi n’y aurait-il pas aussi un passif de l’inhérence ? Or le rôle du verbe dit impersonnel est précisément de convertir un prédicat d’inhérence en un sujet : Une maison est là Z Il y a une maison, Quelqu’un est-il ici ? Z Y a-t-il quelqu’un ici ? De l’argent m’est nécessaire Z Il me faut de l’argent, Une parole imprudente vous a échappé Z Il vous a échappé une parole imprudente, Mentir est honteux Z Il est honteux de mentir, Vivre n’est plus possible Z Il n’y a plus à vivre, etc.
Selon la curieuse distribution signalée à propos de la conversion du verbe avoir (Pierre a un livre Z le livre est à Pierre), on dit : la neige tombe, mais : il tombe de la neige, Dieu existe Z il y a un Dieu, etc. Ce décalage logique ne doit pas masquer la véritable fonction de l’impersonnel, qui est d’être le passif de l’inhérence.
Nous n’avons cité dans ces pages que les principaux types de conversion. Signalons pour terminer, la conversion du complément de relation en un sujet : Ses cheveux sont 224foncés Z Il a les cheveux foncés, Ton estomac est faible Z Tu as l’estomac faible, etc.
Le type des adjectifs en de (rouge de teint, belle de taille, faible d’estomac, pauvre d’esprit, etc.), qui semble être une innovation de la fin du XIXe siècle (D’Harvé PB § 45, suppl. § 222), permet de convertir une relation possessive : Elle a le teint joli Z Elle est jolie de teint. Ce type est absolument courant et, bien que la littérature l’affectionne, n’a rien de particulièrement littéraire ; cf. Quand on est bas de vue, dit le cycliste, on porte des lunettes (Trib. de police, G.). On remarquera, si l’on tient compte de l’ensemble, qu’entre les deux termes de la transposition il n’y a pas de véritable différence sémantique (teint joli « inhérence » > joli de teint « relation ») ; elle est compensée par le passage inverse de avoir à être (« relation > « inhérence »).
Suppléments
Après avoir étudié les principaux types de transposition grammaticale, nous indiquerons ici les directions dans lesquelles le problème de la transposition peut être élargi encore.
La coordination est un rapport de sujet à prédicat entre deux phrases indépendantes ou leurs équivalents (termes coordonnés), tandis que la subordination ne forme au contraire un rapport de sujet à prédicat qu’entre les parties d’une seule 225et même phrase. Le critère de la différence entre subordination et coordination réside donc dans la portée des signes, l’élément subordonné ne portant jamais que sur une partie de la phrase, tandis que l’élément coordonné s’applique toujours à une phrase entière. Exemple : Je suis resté chez moi parce qu’il pleut (parce qu’il pleut ne porte que sur le verbe : rester parce qu’il pleut = subordination) / Je suis resté chez moi, car il pleut (car il pleut porte sur l’ensemble de la phrase précédente = coordination).
Le rapport de coordination n’est pas autre chose qu’une sorte d’élargissement de la subordination et l’on peut retrouver dans celle-ci, transportés sur une autre échelle, les principaux mécanismes transpositifs valables pour la subordination ; condensation, transitivation, etc.
La coordonnée-prédicat, ou prédicat psychologique, peut être définie comme un prédicat dont le sujet est une phrase indépendante : Il est parti, c’est malheureux. Par condensation, ce prédicat peut être logé dans un adverbe (« adverbe de phrase ») : Il est parti, malheureusement — adverbe séparé de son déterminé par une pause marquant qu’il porte sur la phrase entière.
Le coordinatif, ou conjonction de coordination, a pour fonction de relier deux coordonnées sujet et prédicat l’une de l’autre. Le coordinatif peut être latent, c.à.d. un signe zéro ou sous-entendu. Dans les coordinations du type Il est parti (,) malheureusement, c’est la pause qui remplit l’office de coordinatif. Pour expliquer la formation du coordinatif explicite et pour comprendre son rôle, il faut faire appel aux notions de condensation et de transitivation.
La formation du coordinatif par transitivation d’une prophrase constitue un cas limite : Ils sont jaloux, pire, ils s’en veulent à mort ; Il ne veut pas se repentir, bien plus, il récidive ; cf. lat. magis → mais. L’adverbe de phrase étant lui-même une prophrase, les deux cas sont au fond identiques.
Le fait que la coordonnée, en français héréditaire, doit subir une inversion, est au fond un de ces nombreux exemples de conformisme grammatical que nous avons signalés dans les parties précédentes du livre : le signe est obligé de varier en fonction du rapport grammatical qui le lie au reste de la chaîne parlée. La lutte contre l’inversion n’est ici qu’un épisode du conflit qui met aux prises le conformisme et le besoin d’invariabilité.
Les phrases coordonnées peuvent être condensées d’une manière plus ou moins étroite en termes coordonnés. Il y a par exemple des groupes coordinatifs (Pierre et Paul sont partis ; Il a examiné, fouillé et retourné tous les tiroirs), des substantifs coordinatifs (père et mère), des adjectifs coordinatifs (rouge-blanc-bleu ; franco-suisse), des ordinaux coordinatifs (le un deux et troisième jours de novembre ; c’est la cinq ou sixième fois qu’il recommence), etc.
Comme on le voit, la coordination asymétrique est fréquente dans le langage courant et cursif de nos jours ; mais il va sans dire qu’on en trouve des exemples tout au long de l’histoire du français.
Quant à l’échange entre subordination et coordination, il est relativement aisé. En principe, le français permet de transformer au moyen d’une simple pause n’importe quel adverbe de verbe en un adverbe de phrase : Il est parti rapidement (subordination) > Il est parti (,) rapidement (coordination). Parallèlement, toute conjonction de subordination peut être transposée en une conjonction de coordination au moyen d’une pause précédente : Il est parti parce que vous l’avez voulu > Il est parti (,) parce que vous l’avez voulu (on voit pourquoi car tend à disparaître de la langue parlée). Dans la langue écrite, la pause qui permet cette transposition est 229signalée soit par une virgule soit par un point (procédé de style) : Il est parti. Rapidement | Il est parti. Parce que vous l’avez voulu.
Transposition discursive. — La transposition telle que nous l’avons étudiée, et telle qu’on la rencontre ordinairement, est un procédé d’ordre mémoriel ; la catégorie de base n’est pas énoncée précédemment dans le discours, mais se trouve logée dans la mémoire. Il y a des cas cependant où le point de départ est dans la chaîne parlée même et vient à être transposé, à l’aide d’une représentation ou d’une ellipse discursives, dans une autre catégorie. Voici quelques exemples de cette curieuse alliance entre la brièveté et l’interchangeabilité.
Considérée du point de vue normatif, la transposition discursive choque en général comme une incorrection des plus grossières. Les gens bien parlants ont de la peine à admettre ce double rôle accordé simultanément à un seul et même signe. Mais du point de vue fonctionnel on aurait tort de voir un fait pathologique dans cette alliance de la brièveté et de l’invariabilité, qui constitue au contraire un des points culminants de l’économie linguistique
Transposition phonique. — Le problème de la transposition comprend tout un aspect phonique, qu’une étude plus complète que la nôtre ne devrait pas négliger. Il s’agit notamment de l’échange entre unités et sous-unités ; selon les cas, le passage de l’une de ces catégories phoniques à l’autre peut supposer un changement de forme ou non : moi / je, toi / tu, lui / il, eux / ils, soi / se, quoi / que, etc. ; mais : 231nous = nous (ex. nous, nous nous amusons), vous = vous (ex. vous, vous vous amusez). On voit que nous et vous, au rebours des autres pronoms, peuvent fonctionner correctement tantôt comme unités tantôt comme sous-unités.
Le français avancé présente des exemples montrant le besoin de supprimer la barrière formelle entre unité et sous-unité : Dépêche-te ! Le passage inverse est plus fréquent ; ainsi dans le type : Je ne sais pas quoi faire, Il ne savait pas quoi répondre, le quoi — normalement une unité — fonctionne en qualité de sous-unité (quoi = quoi, au lieu de quoi / que).
Transposition interlingue. — L’emprunt de mot, et le calque ou emprunt de syntagme, ne sont pas autre chose que des transpositions de langue à langue. D’un point de vue large, on pourrait appeler soit l’emprunt une transposition interlingue, soit la transposition (sémantique ou syntagmatique) un emprunt intralague. Car le besoin d’invariabilité tend non seulement à faciliter le passage des signes d’une catégorie à l’autre à l’intérieur d’une même langue, mais encore à permettre leur passage invariable d’une langue à l’autre : immense sujet, dont nous ne faisons qu’indiquer le principe, et la place dans l’ensemble.
Dans le domaine de la transposition intralingue, le besoin d’économie cherche à créer des signes invariables et mobiles, c.à.d. interchangeables d’une case de l’échiquier à l’autre. Dès lors que l’on considère l’ensemble des langues de grande communication comme un tout unique — et cette considération, au train dont va la civilisation moderne, semble devoir s’avérer — on peut s’attendre à une marche parallèle vers l’invariabilité d’une langue à l’autre : les emprunts et les calques, si fréquents dans les langues modernes (européennes ou non), marquent la préoccupation de créer un vocabulaire de caractère international, formé de signes internationaux.232
Chapitre V Le besoin d’expressivité
Les besoins étudiés dans les chapitres qui précèdent peuvent tous se grouper plus ou moins sous un chef unique : le besoin de communication. Les signes qui servent à la communication doivent être assimilés les uns aux autres et classés en catégories, en même temps ceux qui ne sont pas du même ordre doivent pouvoir être aisément distingués lés uns des autres ; en outre, ils doivent être économiques, c.à.d. brefs et invariables. Mais « la pensée tend vers l’expression intégrale, personnelle, affective ; la langue cherche à communiquer la pensée vite et clairement : elle ne peut donc la rendre que dans ses traits généraux en la dépersonnalisant, en l’objectivant. Plus les échanges se multiplient, plus la communication travaille à l’encontre de l’expression personnelle. » (Bally LV 148).
Examiné du point de vue de l’évolution, le langage présente un passage incessant du signe expressif au signe arbitraire. C’est ce qu’on pourrait appeler la loi de l’usure : plus le signe est employé fréquemment, plus les impressions qui se rattachent à sa forme et à sa signification s’émoussent. Du point de vue statique et fonctionnel, cette évolution est contre-balancée par un passage en sens inverse : plus le signe s’use, plus le besoin d’expressivité cherche à le renouveler, sémantiquement et formellement.233
Bally, Traité de Stylistique Française, 19213.
Bally, Mécanisme de l’expressivité linguistique (LV 139 sv).
Lorck, Die Erlebte Rede, 1921.
Ogden and Richards, The Meaning of Meaning, 19272, chap. VII : The Meaning of Beauty.
Paulhan, La double fonction du langage (Rev. Philos., 1927, 22 sv).
Terminologie. — L’antinomie entre la communication et l’expressivité est bien connue, mais la terminologie diffère d’auteur à auteur : Verstandesrede/Phantasierede (Lorck), langage-signe/ langage-suggestion (Paulhan), symbolic/evocative (Ogden and Richards), etc. — Nous opposerons le signe arbitraire et le signe expressif.
Le besoin d’expressivité n’est pas un besoin simple ; il comporte de multiples aspects. D’une manière générale, on peut distinguer le besoin d’agir sur l’interlocuteur et le besoin de le ménager, c.à.d. le langage actif et le langage passif. Le langage actif embrasse surtout les divers procédés dus à l’exagération ; le langage passif comprend les expressions qui tendent à atténuer la pensée ou le sentiment, les euphémismes, les signes de politesse, etc. Une autre opposition est celle qu’on peut faire entre l’expressivité du langage populaire et celle de la langue littéraire ; leurs procédés sont parallèles, de ce point de vue, et se laissent ramener au même besoin général. — Il va sans dire que dans ce chapitre, qui ne doit constituer qu’une première approximation, on n’insistera qu’incidemment sur ces divers aspects sous lesquels le besoin d’expressivité peut se présenter ; on s’attachera à considérer le phénomène dans sa généralité.
Quand on définit la stylistique comme l’étude du langage affectif, on entend par là d’une manière générale l’étude des sentiments, des émotions, des volontés qui se dégagent des faits de langage. Mais cette affectivité peut être de deux 235espèces. Elle est fortuite lorsqu’elle est dégagée uniquement, et à l’insu du parleur ou malgré lui, par la situation. Ainsi les faits d’évocation de milieux (tels que la prononciation d’un étranger, les termes d’argot échappés accidentellement à un homme de bonne société, la lecture d’un exploit d’huissier, etc.) rentrent souvent dans cette catégorie. L’affectivité par la situation doit être nettement séparée de l’expressivité ; cette dernière, c’est l’affectivité que le parleur cherche à transmettre à son interlocuteur d’une manière plus ou moins volontaire. Tandis que l’affectivité, fortuite, ne relève que de la causalité, l’expressivité suppose au contraire un acte de finalité, c.à.d. un rapport de moyen à fin (de procédé à besoin). La linguistique fonctionnelle ne peut naturellement s’occuper que de cette dernière, qui seule répond à la finalité du signe : le langage simplement affectif n’est pas un langage.
La même opposition peut être formulée en d’autres termes, plus généraux : tout ce qui est affectif n’est qu’un processus, tout ce qui est expressif au contraire est un procédé. La création même du langage — création qu’il ne faut pas chercher à surprendre dans la nuit lointaine des origines mais dans le fonctionnement quotidien de la langue d’aujourd’hui — n’est pas autre chose que le passage du processus au procédé. Un phénomène reste un simple processus fortuit tant qu’il n’a pas été mis, par un acte de volonté du sujet parlant, au service d’un besoin donné. C’est ce qu’a clairement vu M. Grammont à propos des combinaisons de sons expressives : « … Un moyen d’expression n’est jamais expressif qu’en puissance, et ne devient impressif que si l’idée le lui permet et le met en évidence. Sans l’idée qui le féconde et le vivifie, le moyen matériel n’est qu’une possibilité irréalisée. » (Vers fr., 31-2 ; v. Bally LV 277). Ainsi tictac et tinter sont expressifs, tactique et teinter, composés des mêmes phonèmes, ne le sont pas.
La même distinction s’applique naturellement aussi aux oppositions sémantiques. Pour qu’une opposition de ce genre soit expressive, il faut qu’elle réponde à l’intention du sujet parlant d’être expressif, sinon elle reste un pur processus (à moins de correspondre à un autre besoin). Ainsi, parmi les exemples de figures que donne la rhétorique, beaucoup 236ne sont pas des procédés expressifs ou ne le sont plus : une voile (bateau), le pied d’une table, les bras d’un fauteuil, etc.. sont aujourd’hui de simples transpositions (« fausses figures »).
Comment définir le procédé expressif ? On sait que d’après la théorie de Saussure le langage est constitué par un système d’oppositions, c.à.d. d’identités et de différences. Or le besoin d’expressivité tend constamment à remplacer les oppositions usuelles, à mesure qu’elles deviennent automatiques et arbitraires, par des oppositions neuves, chargées par leur imprévu de mettre en éveil l’attention de l’interlocuteur et de faire jaillir chez lui un minimum au moins de conscience. Ces oppositions inédites qui font l’essence du procédé expressif, peuvent atteindre aussi bien la signification que la forme des signes. En résumé, les faits qui constituent le langage expressif peuvent être considérés comme un ensemble de déformations plus ou moins fortes et plus ou moins conscientes que le parleur fait subir au système normal de la langue ; il n’y a donc pas deux grammaires, une grammaire intellectuelle et une grammaire expressive (v. Sechehaye, Structure logique de la phrase, 212).
L’essence de l’expressivité est de jouer avec la norme — sémantique ou formelle — exigée par la logique ou la grammaire normatives. Quand on dit d’un homme : c’est un chiffon, on remplace la notion de qualité demandée par la logique (« il est mou ») par celle de substance ; mais si l’on dit de lui : c’est un ramolo, au lieu de : c’est un ramolli, on ne heurte plus la norme de la signification mais celle du signe.
Les grammairiens protestent souvent contre l’« illogisme » de certaines tournures. Exemple : « Promettre, comme espérer, suppose l’avenir. On ne dira donc pas : Je vous promets qu’il s’est bien amusé ; mais, Je vous assure qu’il s’est bien amusé. Il est vrai que promettre, pour assurer, est une expression familière, citée par l’Académie et employée par de bons auteurs. Elle n’en reste pas moins illogique, promettre signifiant faire une promesse. » (Vincent 141-2). En réalité, promettre pour assurer est une figure, et rejeter une figure comme 237illogique, c’est rejeter toute figure, car toute figure est illogique par définition.
Parleur et entendeur ne sont naturellement pas dupes de ces illogismes et de ces agrammatismes : le contraste entre la signification logique, c.à.d. conforme à la norme de la logique, et la signification illogique, respectivement entre le signe grammatical, c.à.d. conforme à la norme de la grammaire, et le signe agrammatical, constitue précisément le secret de l’expressivité.
A) Expressivité sémantique (figures)
La transposition sémantique et la figure ne doivent pas être confondues ; elles diffèrent par deux caractères importants.
Dans la figure, les deux valeurs sémantiques, le sens propre et le sens figuré, sont associées l’une à l’autre, et d’une manière plus ou moins implicite. La simple transposition sémantique postule au contraire l’oubli (ou, dans le cas de la « fausse figure », le refoulement) du sens premier. Le pronom on fournit des exemples intéressants des deux emplois. Dans des tournures comme Nous on aime le vin, ou : Venez voir : : C’est bon, on y va, le pronom on est une sorte de pronom personnel interchangeable d’une personne à l’autre, et relève de la transposition plus ou moins pure. Dans d’autres emplois, les valeurs propre et dérivée sont au contraire associées l’une à l’autre et forment figure ; tel est souvent le cas lorsque on est substitué à tu ou à vous : On n’a pas été sage à l’école, on est rentrée tard, on ne fait plus ses devoirs, qu’est-ce que cela veut dire, tout ça ?
En outre, et cela ressort en partie de ce qui vient d’être dit, il faut faire intervenir le facteur téléologique, car tout dépend en effet de l’intention du parleur. Si l’on admet que toute opération linguistique est accompagnée d’un jugement de valeur — généralement inconscient — porté sur elle par le sujet parlant, on peut, de ce point de vue, définir la transposition sémantique comme le déplacement « réel » d’un signe d’une valeur à l’autre, et la figure comme l’interversion 238« irréelle » (ludique) de deux significations. Cette attitude des sujets à l’égard des opérations linguistiques qu’ils effectuent devient d’ailleurs consciente en cas d’équivoque : « Comment entendez-vous cela, au propre ou au figuré ? »
Bref, on transpose par commodité, et d’une manière aussi mécanique que possible : la transposition est un instrument au service de l’automatisme grammatical. Si l’on transfigure, c’est au contraire pour frapper l’attention de l’interlocuteur et la tenir en éveil, ce qui oblige les parleurs à des innovations incessantes et les entendeurs à un effort d’interprétation ininterrompu. Mais on aurait tort, évidemment, de croire que ces procédés sont artificiels, comme si l’étude du langage expressif tenait tout entière dans l’énumération des figures de rhétorique et des recettes de style : ces dernières ne sont que la contre-partie littéraire des figures que crée la langue parlée plus ou moins spontanée.
Selon le besoin à satisfaire, l’expression linguistique des catégories de la pensée peut donc différer du tout au tout. S’agit-il du besoin de différenciation, on exprimera autant que possible les valeurs à l’aide de signes distincts (ex. « homme / bêtes » : cheveux / poils, nez / museau, pied / patte, mourir / crever, etc.). S’agit-il du besoin d’invariabilité, on traduira les valeurs différentes par des signes identiques (ex. le nez d’un chien, le pied d’un animal, etc.). S’agit-il d’être expressif, on intervertira à dessein les valeurs (ex. Enlève tes pattes !, Quel vilain museau il a !, Ah il te caresse le poil ?, On finira par tous crever !, etc.).
Nous essayerons ici de passer en revue les principales espèces d’interversions sémantiques que l’on peut observer dans le français familier et dans le français avancé, en étudiant en même temps leur retentissement sur la grammaire. M. Bally a montré « combien ce côté de la théorie grammaticale est encore peu poussé, et quelle étude féconde s’offre à qui veut raccorder systématiquement la grammaire et la logique, plus exactement : les transpositions grammaticales et les échanges logiques. » (LV 171). Quant au classement des faits, nous garderons les rubriques adoptées pour la Transposition sémantique.239
1) La substance
Nous examinerons d’abord les échanges que le besoin d’expressivité fait subir aux divers s variétés de la substance ; ensuite, nous passerons à l’étude des interversions qui se produisent entre la substance et une autre catégorie.
On emploie aussi, dans l’usage plaisant, l’impersonnel en parlant d’une personne ; exemple : Il fait soif !, à quelqu’un qui boit.
Inversement, la langue a de tout temps, et à tous les étages du langage, personnifié les choses de la nature ; l’animation de la nature est un des procédés les plus courants du langage expressif. La poésie en fait un usage constant, mais le langage populaire ne l’ignore pas non plus (cf. un cadavre pour désigner une bouteille vide, les noms d’animaux donnés aux outils, etc.).
L’interversion des notions d’homme et d’animal alimente la plus grande partie des injures et des expressions fortes de la langue familière et populaire : cochon, vache, chameau, bécasse, corbeau (prêtre), singe (patron), etc. Le procédé s’étend naturellement aussi aux attributs de ces notions : « On entend fréquemment dire cuir ou couenne pour « peau », lard pour « graisse », vêler ou fondre pour « accoucher », etc., avec l’intention évidente de comparer l’homme à la bête. » (B 26). Cf. gueule, museau, faites, poils ; crever, etc.
Le même procédé peut d’ailleurs comporter une valeur caritative, car tout dépend de l’intention du parleur. Certains noms d’animaux semblent particulièrement portés à fournir les termes de l’amitié et de l’amour : mon chien, mon loup, mon rat, mon lapin, ma chatte, mon poulet, etc.240
L’interversion des notions d’homme et de plante fournit et des injures (Vous me prenez pour une poire ; Faire le poireau « attendre longtemps, comme un imbécile ») et des termes caritatifs (mon chou, ma vieille branche, sucer la pomme à qn., etc.).
Beaucoup de termes caritatifs reposent en outre sur l’interversion des sexes. C’est par figure, par exemple, qu’on dira à une personne du sexe féminin : mon petit, mon chéri, mon mignon, etc. Le cas inverse, qui est plus rare, frise le sarcasme Dépêche-toi, ma belle ! De même, on peut substituer un suffixe masculin à un féminin, d’où l’expressivité plus ou moins forte des noms propres féminins en -on : Madelon (Madeleine), Louison (Louise), Margot, Margoton (Marguerite), Jeannot (Jeanne), etc. La même figure joue pour les noms communs en -on, corrects pour la plupart : une bougillon, une demoisillon, une frétillon, une graillon, une grognon, une laideron, une louchon, une souillon, une tâtillon, etc. Toute l’expressivité de ces termes repose sur le chassé-croisé entre féminin et masculin, et c’est dans la mesure où celle-ci s’efface qu’ils tendent à admettre le suffixe féminin : une tatillonne, etc.
Le cas classique dans ce domaine est d’ailleurs la 3e personne de politesse : Madame veut-elle…, Monsieur désire-t-il… Cf. : J’ai déjà eu le plaisir de rencontrer ces dames ; Et ces jeunes gens, ils parlent sport, je parie !, etc.
Enfin, le langage populaire emploie bibi avec la 3e personne quand il s’agit de quelqu’un qui se désigne soi-même : Bibi aime bien le bon vin, C’est pour bibi (B).
Dans la langue écrite, l’interversion se fait entre l’auteur et ses personnages ; mais la racine du procédé — comme d’ailleurs de tout procédé littéraire — doit être cherchée dans l’idiome parlé. C’est là ce qui placera le problème dans 242sa vraie lumière (v. E. Richter, compte-rendu de l’ouvrage de Mlle Lips : Herrig’s Archiv, t. 153, 149 sv).
En français, l’article placé devant un nom propre « caractérise » la personne désignée. Cela peut se faire de différentes manières. Devant un prénom par exemple, l’article donne un ton de familiarité : la Louise, la Jeanne, la Marie, etc. Devant un nom de famille, il exprime généralement le mépris, procédé bien connu des polémistes : le Clemenceau, le Caillaux, le Poincaré, etc., … et des concierges : Voilà encore une lettre pour le Martin. La forte expressivité qui se dégage de cet emploi est due à l’interversion des notions de nom commun et de nom propre, ce dernier étant assimilé par figure à un nom commun. On sait que dans le langage populaire et rural, cet usage de l’article avec un nom propre a perdu en grande partie sa valeur expressive.
Un autre groupe de figures consiste à intervertir la substance avec la qualité, la manière, l’évaluation (mode), etc.
On remarquera que le substantif ainsi transfiguré dans le domaine de la qualité s’accompagne volontiers de l’adverbe tout, à la place de très : un style tout nature, il est tout chose, tout enthousiasme, etc.
Il peut y avoir chassé-croisé entre la transposition de l’adjectif en un substantif et la figure qui prend la substance pour la qualité : Pierre est un timide. Autrement dit, l’adjectif, en même temps qu’il est transposé en substantif, est transfiguré en sens inverse dans le domaine de la qualité. Les exemples de ce type sont multiples, et en général corrects (pendant plus ou moins « écrit » : son étude la préférée, les soldats pour qui la mort est la toujours présente, etc.).