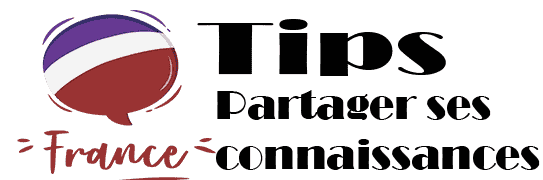La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, qui vise à favoriser la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, a instauré un statut protecteur pour les lanceurs d’alerte et a mis en place une procédure de signalement. Plus récemment, la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 a élargi la définition des lanceurs d’alerte, simplifié les canaux de signalement et étendu la protection contre les représailles à l’entourage du lanceur d’alerte.
Une définition légale du lanceur d’alerte
Selon la loi, un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, de bonne foi et sans contrepartie financière directe, des informations portant sur :
- Un crime ou un délit ;
- Une menace ou un préjudice pour l’intérêt général ;
- Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation liée à un engagement international, à un acte d’une organisation internationale, au droit de l’Union européenne, à la loi ou au règlement.
Il est important de noter que seul le signalement dans le cadre de la procédure d’alerte, distincte du signalement au titre de l’article 40, 2ème alinéa, du Code de procédure pénale, donne droit au régime de protections accordées aux lanceurs d’alerte.
Le Défenseur des droits peut être saisi afin de rendre un avis sur la qualité de lanceur d’alerte d’une personne, en vertu de l’article 35-1 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 modifiée relative au Défenseur des droits.
Cependant, il convient de noter que certaines informations sont exclues du régime d’alerte, notamment celles relevant du secret de la défense nationale, du secret médical, des délibérations judiciaires, de l’enquête ou de l’instruction judiciaires, ainsi que du secret professionnel de l’avocat.
De plus, seules les personnes physiques peuvent être considérées comme des lanceurs d’alerte, excluant ainsi les personnes morales telles que les associations ou les organisations syndicales. Le lanceur d’alerte peut être un salarié du secteur privé, un agent public ou encore un collaborateur extérieur et occasionnel.
Enfin, il est primordial que le lanceur d’alerte agisse de bonne foi, c’est-à-dire qu’il ait eu des “motifs raisonnables de croire” que les informations divulguées étaient nécessaires pour protéger les intérêts en cause.
Depuis le 1er septembre 2022, quelques modifications ont été apportées à la définition du lanceur d’alerte. Le terme “signale ou révèle” a été remplacé par “signale ou divulgue”. De plus, la condition selon laquelle le lanceur d’alerte devait avoir personnellement connaissance des faits qu’il signalait ne s’applique que lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles. Dans un contexte professionnel, le lanceur d’alerte peut désormais signaler des faits qui lui ont simplement été rapportés. Quant à l’exigence de gravité concernant la violation de la loi ou du règlement, ainsi que la menace ou le préjudice pour l’intérêt général, elle a été supprimée. Cette évolution permet également de signaler les tentatives de dissimulation d’une violation.
La procédure d’alerte
Depuis le 1er septembre 2022, le lanceur d’alerte dispose de deux canaux de signalement qu’il peut choisir librement : le signalement interne et le signalement externe. Il n’y a pas de hiérarchie entre ces canaux.
Le lanceur d’alerte peut donc décider d’appliquer directement la procédure externe sans avoir recours préalablement à la procédure interne de signalement. Dans certains cas, il est même autorisé à divulguer publiquement les informations dont il dispose.
Il est important de respecter cette procédure pour bénéficier de la protection accordée au lanceur d’alerte. Auparavant, le lanceur d’alerte devait d’abord signaler les faits en interne à son supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celui-ci. En l’absence de traitement de ces informations dans un délai raisonnable, le lanceur d’alerte pouvait s’adresser à l’autorité judiciaire, administrative ou à l’ordre professionnel concerné. En cas de non-traitement par l’autorité externe dans un délai de trois mois, le lanceur d’alerte était autorisé à rendre public les informations. Cependant, en cas de danger grave et imminent ou de risque de dommages irréversibles, le signalement pouvait être directement porté à la connaissance de l’autorité externe ou rendu public.
- Procédure de signalement interne
Les personnes physiques qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations pouvant faire l’objet d’un signalement interne, peuvent le faire si elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu’elles ne s’exposent pas à un risque de représailles. Cela concerne les membres du personnel, les anciens membres du personnel, les candidats à un emploi au sein de l’entreprise concernée, les collaborateurs extérieurs et occasionnels, ainsi que les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance, les cocontractants et sous-traitants de l’entreprise ou de personnes morales liées à l’entreprise.
Une procédure interne de recueil et de traitement des signalements doit être établie par les entreprises employant au moins 50 salariés, ainsi que par les personnes morales de droit public occupant cet effectif minimum. Cette procédure doit garantir l’intégrité et la confidentialité des informations recueillies. En l’absence d’une telle procédure, le signalement peut être effectué auprès du supérieur hiérarchique direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci. Lorsque les conditions légales sont remplies, l’entreprise assure le traitement du signalement. Depuis le 1er septembre 2022, le règlement intérieur doit également indiquer la procédure applicable au lanceur d’alerte.
Procédure de signalement externe
Le lanceur d’alerte peut adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne, soit directement, à une autorité compétente désignée dans le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022, au Défenseur des droits, ou à l’autorité judiciaire (le procureur de la République).Procédure d’alerte publique
Le lanceur d’alerte peut procéder à une divulgation publique des informations dont il dispose après avoir effectué un signalement externe, qu’il ait préalablement effectué un signalement interne ou non, à condition qu’aucune mesure appropriée n’ait été prise en réponse à ce signalement dans le délai imparti (de trois à six mois selon l’autorité saisie). Cette divulgation publique peut être effectuée en cas de danger grave et imminent, lorsque la saisine d’une autorité compétente représente un risque de représailles ou ne permet pas de remédier efficacement à la situation, ou lorsqu’il existe un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, par exemple en présence d’une situation d’urgence ou d’un risque de préjudice irréversible. Toutefois, c’est au juge de décider si ces conditions sont remplies en cas de contestation.
Les protections accordées aux lanceurs d’alerte
Les lanceurs d’alerte bénéficient de deux types de protections : l’irresponsabilité civile et pénale, ainsi que la prohibition des mesures de représailles.
Irresponsabilité civile et pénale
Le lanceur d’alerte qui signale ou divulgue publiquement des informations n’est pas civilement responsable des dommages causés par ce signalement ou cette divulgation, dès lors qu’il avait des motifs raisonnables de croire, au moment de leur réalisation, que cela était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause. De plus, le lanceur d’alerte bénéficie également de l’irresponsabilité pénale. Ainsi, s’il révèle un secret professionnel protégé par la loi, il n’est pas pénalement responsable dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause et qu’il a respecté les procédures de signalement définies par la loi. De même, le lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou recèle des documents ou tout autre support contenant des informations licitement obtenues et les signale ou divulgue selon la procédure prévue par la loi n’est pas pénalement responsable. Les personnes en lien avec le lanceur d’alerte, telles que les facilitateurs, les personnes physiques en lien avec le lanceur d’alerte et les entités juridiques contrôlées par le lanceur d’alerte, bénéficient de la même irresponsabilité civile et pénale.Prohibition des mesures de représailles
Le lanceur d’alerte ne peut pas être l’objet de mesures de représailles, de menaces ou de tentatives de recours à de telles mesures pour avoir signalé ou divulgué des informations dans le respect des procédures de signalement. Cette protection contre les représailles s’applique également aux personnes physiques et morales en lien avec le lanceur d’alerte. Les mesures de représailles incluent la suspension, la mise à pied, le licenciement, la rétrogradation, le refus de promotion, le transfert de fonctions, le changement de lieu de travail, la réduction de salaire, la suspension de la formation, l’évaluation de performance négative, les mesures disciplinaires, la discrimination, le non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire. Tout acte ou décision correspondant à ces mesures de représailles est nul de plein droit. En cas de litige, le conseil des prud’hommes peut, en plus de toute autre sanction, obliger l’employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié lanceur d’alerte ayant subi des sanctions.
Il est important de souligner que toute personne qui tente d’entraver la transmission d’un signalement peut être condamnée à un an d’emprisonnement et à une amende de 15 000€. De plus, les personnes condamnées pour avoir fait obstacle au signalement des informations par le lanceur d’alerte encourent également une peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée. En cas d’action abusive ou dilatoire à l’encontre d’un lanceur d’alerte, une amende civile de 60 000€ peut être infligée, sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts.
Les lanceurs d’alerte jouent un rôle essentiel dans la détection et la prévention des comportements répréhensibles en entreprise. Grâce à la mise en place de mécanismes protecteurs et d’une procédure de signalement adaptée, les lanceurs d’alerte peuvent contribuer à une meilleure transparence et à l’amélioration de la vie économique.