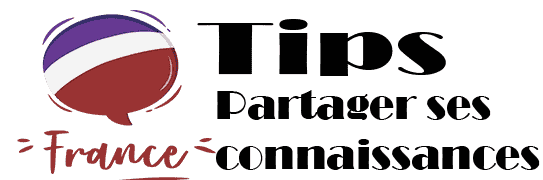Chine-Japon, quelles distinctions ?
Dans le cas des thés verts, les feuilles subissent une faible ou aucune oxydation, contrairement aux thés noirs. Pour empêcher ce processus, les feuilles sont soumises à la chaleur juste après leur cueillette afin d’arrêter l’oxydation enzymatique. Cette étape de dessiccation varie en fonction des techniques utilisées par les deux producteurs historiques de thé.
La méthode chinoise, qui remonte à des millénaires, implique l’utilisation d’un réservoir en métal chauffé sur un feu de bois ou à l’électricité (ou de grands cylindres dans les usines). Cette chaleur sèche permet de préserver les arômes floraux et donne au thé une saveur végétale parfois rehaussée de notes de noisette grillée.
Depuis le XVIe siècle, au Japon, la dessiccation se fait par la vapeur, ce qui permet notamment la création de thés de type Sencha, qui représentent aujourd’hui 70 % de la production japonaise. Cette méthode confère aux thés des arômes soutenus de légumes verts, accompagnés de notes typiques d’iode et de mer. Il est toutefois important de noter que certains thés estampillés “Sencha” ne sont pas originaires du Japon, mais sont produits ailleurs dans le monde selon cette méthode japonaise.
Les critères d’un thé de qualité
Les meilleurs thés de notre sélection proviennent de maisons spécialisées. Ils sont également les plus chers. Le prix ne constitue pas un critère infaillible, et le marketing peut parfois enfler la facture. Cependant, les thés issus de jardins prestigieux sont très coûteux à l’achat, et les maisons de thé réalisent généralement des marges moins importantes sur ces produits que sur les thés courants ou les mélanges aromatisés. Ainsi, un thé vert bon marché a peu de chances d’être de grande qualité. Pour réduire les coûts, certains fabricants mélangent des thés de plusieurs origines (Indonésie, Chine, Kenya…) provenant de productions soumises à des pressions commerciales importantes et de qualité médiocre. Vous le constaterez en ouvrant un sachet : si la mouture est sèche et contient plus de poussière et de brisures de feuilles que de feuilles entières, ce n’est pas bon signe…
Inversement, les thés verts les plus prestigieux sont généralement les thés de printemps. Récoltés à partir de février ou mars en Chine (selon les provinces) et à partir de fin avril au Japon, ils se composent de jeunes bourgeons, les plus tendres et les plus verts, ce qui permet de limiter les résidus de pesticides. Comme l’expliquent Pierre et Florian du Parti du thé, une boutique spécialisée à Paris, ces récoltes ont lieu à une saison optimale pour les théiers, qui ont moins besoin d’intrants chimiques pour les protéger ou les stimuler. Mais attention, tout comme les feuilles prélevées en haut des théiers, leur prix atteint des sommets !
Enfin, bien que le thé vert japonais jouisse d’une plus grande réputation que le thé chinois dans nos latitudes, il existe une gamme allant du meilleur au médiocre dans les deux origines. Il est donc préférable de demander conseil dans une boutique spécialisée pour se familiariser avec ces thés.
Conservation et préparation : les bases d’un bon thé vert !
Le thé vert perd rapidement son arôme, car il s’oxyde très rapidement. En sachet, il se conserve mieux lorsqu’il est emballé individuellement. Qu’il soit en vrac ou ensaché, il doit être conservé à l’abri de la lumière et, si possible, au frais sans humidité. Si vous le placez au réfrigérateur, veillez à le stocker dans une boîte hermétique afin qu’il ne prenne pas les odeurs fortes (oignons, fromages…).
Il est préférable d’éviter l’eau du robinet si elle est riche en calcaire ou en chlore, car ces éléments écrasent les arômes et rendent le thé amer. Il est préférable d’utiliser de l’eau en bouteille, de source ou minérale, peu minéralisée (telle que Mont Roucous ou Volvic…).
Les feuilles de thé doivent également être chauffées à la bonne température pour libérer toute la richesse d’un thé. Les thés verts étant fragiles, ils infusent à une température d’environ 70 à 80 °C, contre 90 °C pour un thé noir. Si vous ne disposez pas d’une bouilloire avec un thermostat, une astuce consiste à porter l’eau à ébullition, puis à y ajouter un quart d’eau froide avant d’y infuser votre thé. Le temps d’infusion est généralement de 1 à 3 minutes pour un thé japonais et de 2 à 4 minutes pour un thé chinois.
Si votre thé est en vrac, différents types de filtres s’offrent à vous : des filtres jetables en papier, des filtres réutilisables en tissu, des boules ou des filtres en métal… Certains experts estiment que ces matériaux peuvent parfois ajouter une légère note à l’infusion, mais cet effet reste minime. Cependant, il est préférable de ne pas utiliser le même filtre réutilisable pour des thés noirs très forts (comme les thés fumés) ou aromatisés et des thés verts. L’essentiel est de choisir un contenant suffisamment spacieux pour permettre aux feuilles de se déployer au contact de l’eau et de libérer toute leur saveur. Pas besoin de bourrer le filtre comme le foyer d’une pipe : l’adage veut qu’on utilise 2 g de thé pour 20 cl d’eau.
Enfin, un thé de qualité doit être bu immédiatement après l’infusion, car son goût se détériore rapidement ! En revanche, les thés de qualité peuvent être infusés plusieurs fois, jusqu’à 3 ou même 4 fois. La seule différence entre les infusions successives réside dans l’extraction de la caféine (ou théine, qui est la même molécule), qui est extraite à plus de 80 % lors de la première infusion.