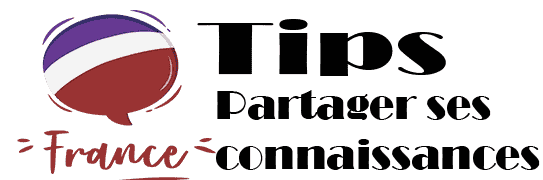Les perturbateurs endocriniens, bien que leur nom puisse sembler barbare, sont un sujet récurrent dans les débats publics. Présents dans de nombreux produits, près des deux tiers des résidus de pesticides détectés dans l’alimentation européenne sont suspectés d’être des perturbateurs endocriniens, selon une enquête menée par l’ONG Générations futures et publiée le mardi 4 septembre.
En décembre, les États membres de l’Union européenne ont finalement adopté de nouveaux critères d’identification pour les perturbateurs endocriniens après un premier veto du Parlement européen, qui les jugeait trop laxistes. Ces substances chimiques, omniprésentes dans l’environnement humain, représentent un enjeu sanitaire majeur pour les années à venir, mais restent mal connues du grand public.
Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ?
Un perturbateur endocrinien (PE) est une substance chimique capable d’interférer avec le système hormonal d’un organisme. Les hormones sont des molécules messagères sécrétées dans le sang par des glandes spécialisées, qui régulent à distance le comportement de certains organes ou tissus. Elles régulent de nombreux aspects de notre corps, tels que la croissance, la puberté, la température corporelle, le métabolisme des graisses, la faim, la satiété, le sommeil, la libido, le niveau d’insuline, le rythme cardiaque, etc.
Les perturbateurs endocriniens agissent en se fixant sur les organes, imitant ainsi certaines propriétés chimiques des hormones. Lorsqu’ils se fixent sur les récepteurs hormonaux d’un organe ou d’un tissu, ils créent un stimulus et modifient leur comportement, même en l’absence de sécrétion hormonale. Les perturbateurs peuvent également bloquer l’action des hormones en se fixant en grand nombre sur les récepteurs qu’elles doivent utiliser.
Où trouve-t-on les perturbateurs endocriniens ?
Parmi les perturbateurs endocriniens, on retrouve des substances produites intentionnellement pour leur effet hormonal, comme les contraceptifs ou les traitements de la stérilité. Ces substances, une fois ingérées, sont partiellement rejetées dans l’urine et les matières fécales, ce qui présente un risque indirect. Elles persistent dans l’environnement pendant de nombreuses années et peuvent être transférées d’un compartiment de l’environnement à un autre (sols, eau, air, etc.), même des années après leur production, selon l’Inserm.
On trouve également des substances, telles que le bisphénol A, dont le but premier n’est pas de produire un effet sur le système endocrinien. Le bisphénol A est présent dans de nombreux produits du quotidien, tels que les emballages alimentaires plastifiés, les lunettes, certains composites dentaires, les tickets thermiques des caisses enregistreuses, les revêtements internes des boîtes de conserve, ainsi que dans certains cosmétiques. Certains pesticides contiennent également des composés dits “organochlorés” tels que le chlordécone ou le DDT, malgré leur interdiction en France.
Les perturbateurs endocriniens sont également présents dans des matières imperméabilisantes, telles que les textiles antitaches, ainsi que dans certains emballages alimentaires cartonnés ou plastifiés. Ils peuvent causer des cancers de la prostate ou de la stérilité. Enfin, certains composés polybromés sont ajoutés à certains produits pour les rendre moins inflammables, tels que les plastiques, les textiles (rideaux, tapis, etc.) ou les équipements électriques. Ces composés peuvent avoir des effets néfastes sur les fonctions hépatiques, thyroïdiennes et œstrogéniques. Certains perturbateurs endocriniens sont également produits naturellement en petites quantités par des plantes, comme les phyto-oestrogènes.
Les êtres humains ne sont pas les seuls à être contaminés par les perturbateurs endocriniens. Des traces de ces substances, provenant des activités humaines, sont régulièrement retrouvées dans des milieux naturels jusqu’ici préservés, tels que les forêts primaires ou les fonds marins profonds. Des quantités importantes de certains perturbateurs endocriniens (comme les PCB et les PDBE) ont été découvertes dans ces milieux.
En 2013, un rapport commun de l’OMS et du PNUE a indiqué que près de 800 produits chimiques étaient connus ou soupçonnés d’interférer avec le système hormonal humain. Seule une faible proportion de ces produits a été testée pour identifier leurs effets sur les organismes vivants.
A quels niveaux d’exposition le risque sanitaire devient-il sérieux ?
Les perturbateurs endocriniens ont la particularité de pouvoir causer des maladies liées au système hormonal, même à de très faibles doses. En effet, la quantité d’hormones sécrétées est généralement faible pour que le système fonctionne efficacement. Les individus sont particulièrement vulnérables aux perturbateurs endocriniens pendant les périodes importantes de développement biologique du corps humain, telles que la gestation ou la puberté.
Certains perturbateurs endocriniens peuvent également avoir des effets transmis entre les générations. Ainsi, l’augmentation des maladies liées au système hormonal observée aujourd’hui peut également être expliquée par une exposition des générations précédentes à ces perturbateurs endocriniens.
De plus, la méthode utilisée pour déterminer les niveaux d’exposition “sûrs” pour les êtres humains s’est révélée inadaptée, d’après le rapport de l’OMS de 2013. Cette méthode suppose qu’il existe un seuil en dessous duquel aucun effet adverse n’est observé et que de faibles doses n’ont aucune conséquence. Or, les recherches menées ces dernières années ont montré qu’un tel seuil n’existe pas nécessairement et que les perturbateurs endocriniens peuvent agir à faible dose.
Plusieurs études ont estimé que le coût sanitaire de l’exposition à ces substances est de 157 milliards d’euros par an en Europe et de 340 milliards de dollars par an aux États-Unis.