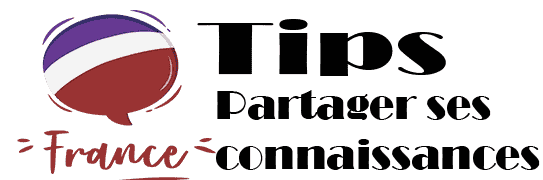Chaque pays a ses légendes. En Grande-Bretagne, Triumph en est une. Michaël Levivier, Zef Enault et Yud Pourdieu Le Coz, experts de longue date dans l’univers de la moto, lui consacrent aujourd’hui un superbe ouvrage richement illustré et écrit avec style et précision. Depuis le début du siècle, le constructeur de motos, notamment connu pour son emblématique modèle Bonneville, incarne une certaine essence de l’esprit anglais à travers le monde. Outre-Manche, les deux-roues sont pris très au sérieux : les constructeurs de motos ont toujours été considérés comme des aristocrates de l’industrie.
Le miracle Triumph
La marque, aujourd’hui centenaire, a pourtant connu des moments difficiles. Au début des années 1980, la Grande-Bretagne assiste, impuissante, à la chute de Triumph face à la déferlante japonaise. En Europe et aux États-Unis, les motos japonaises, fiables et propres, supplantent les engins bruyants et huileux d’origine anglaise. Tout semble perdu pour Triumph à la fin de l’année 1982. Pourtant, en 1983, John Stuart Bloor, un jeune entrepreneur d’à peine quarante ans, rachète la marque. John Bloor n’est pas un novice en affaires. À seulement dix-sept ans, ce fils de mineur, qui a quitté l’école à quinze ans, a construit et vendu sa première maison. Lorsqu’il acquiert la célèbre marque de motos, il est déjà la trente-troisième fortune britannique. John Bloor a fait fortune dans l’immobilier résidentiel et la location d’équipements pour les travaux publics. Il détient également de grandes participations dans l’industrie agroalimentaire ainsi que dans plusieurs concessions automobiles d’une grande marque japonaise.
Un défi industriel relevé en solitaire
John Bloor est un homme d’affaires à l’ancienne, dans le meilleur sens du terme. Il a toujours réinvesti ses bénéfices et a immédiatement injecté près de 80 millions d’euros de l’époque pour redonner vie à Triumph. Près de trente-cinq ans après son acquisition, la marque lui appartient toujours. “Le fait que Triumph appartienne à un seul homme permet de ne pas être à la merci des demandes des actionnaires ou des marchés qui privilégient souvent le court terme. Cela apporte une sérénité et encourage à prendre des risques. Enfin, la taille de l’entreprise et l’absence de barrières entre les différents niveaux de l’organisation donnent l’impression de faire partie d’une grande famille”, souligne avec justesse Jean-Luc Mars, directeur général de Triumph, dans la préface de l’ouvrage.
“Triumph est un défi industriel que John Bloor a souhaité relever seul”, estimait en 1993 François Etterlé, responsable de la filiale française de la marque à l’époque. Seul, mais pas sans l’aide des autres. En effet, l’acquéreur de la vieille dame consulte les “quatre grands” du monde de la moto japonaise : Honda, Kawasaki, Suzuki et Yamaha. Ces quatre “géants” lui réservent un bon accueil. “Nous ne te ferons pas de cadeaux sur le plan commercial, mais nous sommes prêts à t’offrir notre technologie. Nous sommes ravis d’avoir un peu de concurrence”, lui disent les marques japonaises.
La renaissance de Triumph
Triumph va renaître en se basant sur la technologie la plus moderne et en la perfectionnant grâce à ses propres recherches. Pas question de produire de simples copies des motos japonaises. Une usine est construite à Hinckley, près de Birmingham. Elle adopte également une approche à la japonaise : ses 140 employés peuvent produire 15 000 motos par an. La production est très intégrée. L’usine, ravagée quelques années plus tard par un incendie, dispose même de sa propre fonderie. La première moto sort des chaînes de production en février 1991 et est livrée en Allemagne. En 1992, le chiffre d’affaires dépasse déjà les 15 millions d’euros. En juin 1993, Triumph célèbre sa dix-millième moto produite. Aujourd’hui, la marque vend 650 000 machines chaque année.
Triumph mise sur l’originalité. Ses motos sont livrées sans les gadgets superflus qui alourdissent les prix et les poids des machines japonaises. Plus légères, elles gagnent en maniabilité. Même la sonorité de l’échappement est étudiée pour se distinguer de celle des motos japonaises. La plupart des motos nippones coûtent une fortune à réparer : les pièces de carrosserie se brisent au moindre choc et leur remplacement est onéreux. Triumph équipe ses modèles de pièces extérieures résistantes aux petits chocs et plus accessibles en termes de coût de remplacement. Et il le fait savoir à sa clientèle et aux compagnies d’assurance. “John Bloor a mis l’accent sur la fiabilité et la modularité”, estime l’ingénieur Stuart Wood, qui travaille chez Triumph depuis 1987 et est aujourd’hui le plus ancien employé encore en activité.
Triomphant et francophile
Et John Bloor part à la conquête du marché. Plutôt que de s’adresser aux grands concessionnaires multimarques, les “gros matous”, il préfère travailler avec les petits “motocistes” en leur proposant de financer leur stock de pièces détachées. Il est bientôt pris au sérieux. “En France, de nombreux professionnels ont reçu des menaces de rupture de contrat de la part de leurs fournisseurs habituels s’ils représentaient Triumph”, se souvient François Etterlé.
Triumph dispose désormais d’une vaste gamme, dont le cœur est la Bonneville, déclinée en plusieurs versions, dont les dernières en date, la Street Twin et la Bobber. Ses roadsters sportifs Speed et Street Triple, régulièrement améliorés, connaissent également un succès indéniable, tout comme ses trails Tiger. Au milieu des années 2000, sa créativité sans fin le pousse à lancer la Rocket III, une moto équipée d’un énorme moteur trois cylindres de 2,3 litres qui gronde de puissance ! En 2014, il n’hésite pas à aller taquiner Harley-Davidson sur son propre terrain avec la Commander, propulsée par un gros bicylindre de 1 800 cm3 à l’américaine. L’ouvrage présente une galerie complète et richement illustrée de tous les modèles.
Le succès anglais et les échecs français
Les constructeurs français de motos n’ont pas eu la même chance que John Bloor. À la fin des années 1950, la France comptait une trentaine d’entreprises de fabrication de deux-roues. Ces sociétés ont disparu sans laisser de traces ni de souvenir. Voxan, au milieu des années 1990, avait suscité de grands espoirs avec ses motos très originales. Mais faute de stratégie et de fonds propres, l’entreprise a été liquidée dix ans plus tard. Les tentatives françaises de relancer l’industrie de la moto se sont toutes soldées par des échecs. Au début des années 1970, Motobécane a échoué à produire une mauvaise copie des motos Kawasaki à trois cylindres, une moto de 350 cm3 mal conçue et fragile. L’entreprise, en faillite depuis 1983, a été reprise par Yamaha. Ironie du sort, la marque japonaise fabrique aujourd’hui certains de ses modèles sur le site de Motobécane (devenue MBK). Dans les années 1980, MF (Moto Française) et BFG (qui a cessé ses activités en 1992) ont connu des échecs encore plus cuisants. Leurs motos, conçues à partir de lourdes mécaniques automobiles, étaient de véritables caricatures de BMW. Invendables, sauf pour les pouvoirs publics, qui les ont largement subventionnées. Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, c’est la tradition et l’initiative privée qui ont permis la renaissance de Triumph, une marque que tout le monde pensait condamnée.
“Triumph, l’art motocycliste anglais” par Michaël Levivier, Zef Enault et Yud Pourdieu Le Coz, publié aux Éditions E/P/A, est un ouvrage complet de 240 pages, disponible au prix de 35 euros.